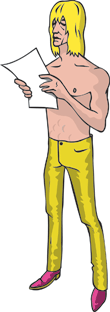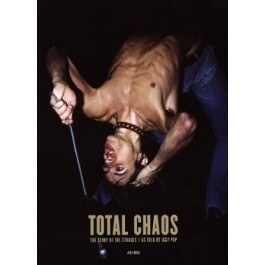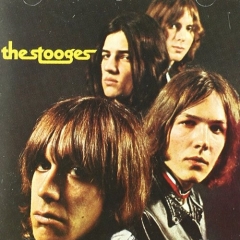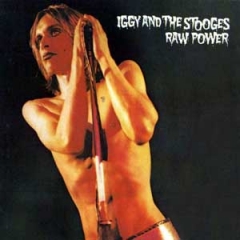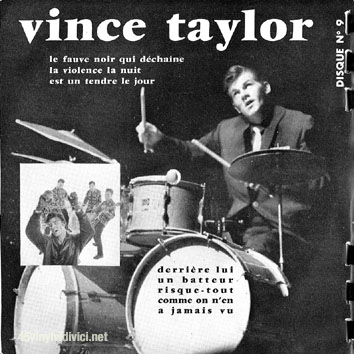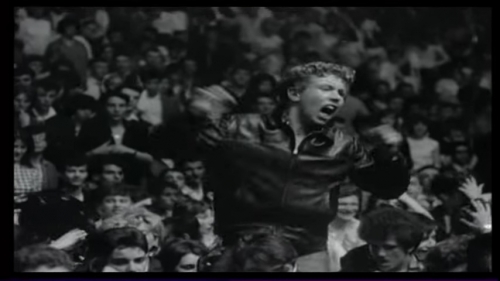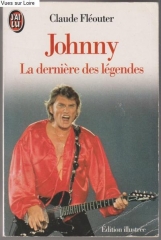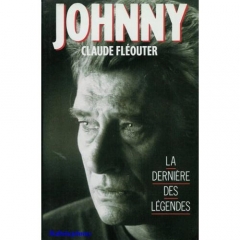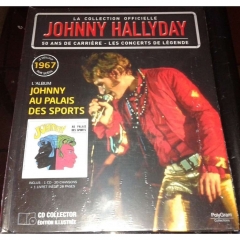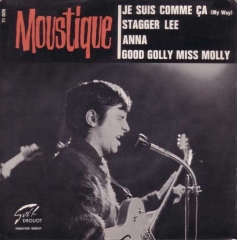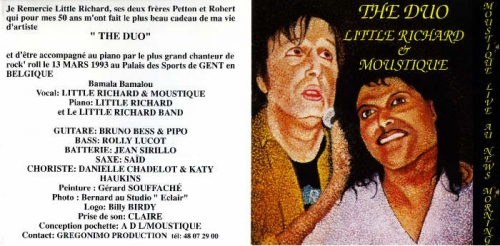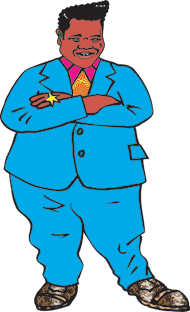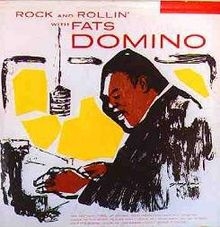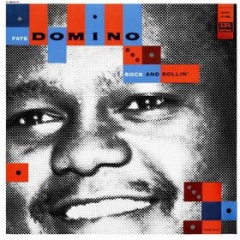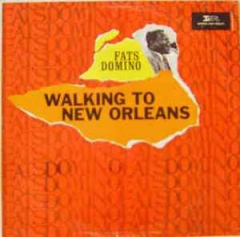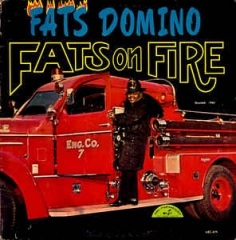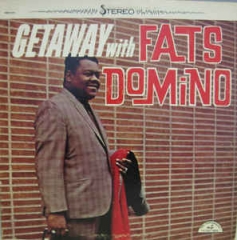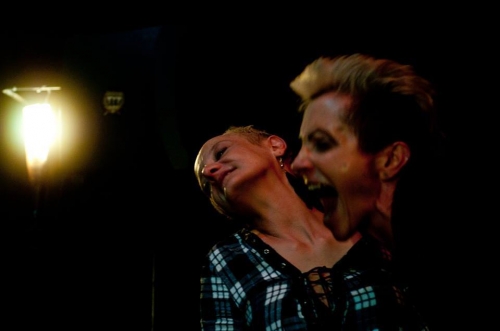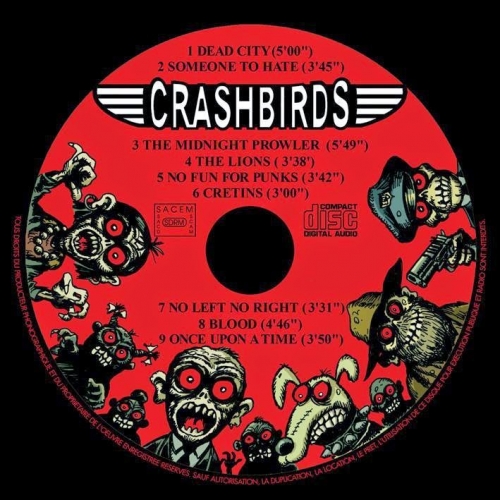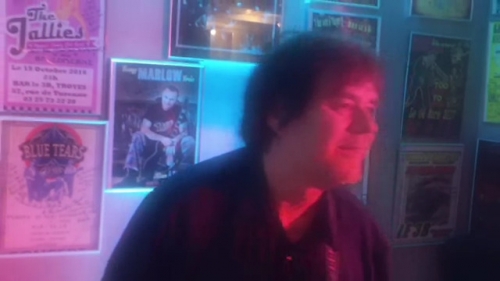KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 349
A ROCKLIT PRODUCTION
23 / 11 / 2017
|
PETER PERRETT / LED ZEPPELIN / HOBSBAWM JAZZ |
Perrett et le pot au lait

Il serait illusoire de vouloir entrer dans l’univers de Peter Perrett sans passer par Nina Antonia et son livre-tabernacle, The One & Only qui fut réédité et augmenté en 2015. Comme dans la grande majorité des cas, l’œuvre et la vie de l’artiste sont indissociables. On sait que Peter Perrett aime les drogues, mais on ne sait pas à quel point. On sait qu’il aime les femmes, mais on ne sait pas non plus à quel point. Peter Perrett est l’homme de tous les excès : junk, femmes, fringues, fast cars, rock, antiquités. Il ne fréquente pas n’importe qui. Des gens comme Keith Richards, Johnny Thunders et Nick Kent entrent dans son orbite. Les chansons qu’il compose pour les Only Ones sont à l’image de l’homme : vouées à ce néant fascinant qu’on appelle le dandysme, et par conséquent, les Only Ones valent cent fois mieux que toute cette fucking new wave amputée du cerveau, de la même façon que les chansons de Syd Barrett valent cent fois mieux que celles de ses anciens collègues.
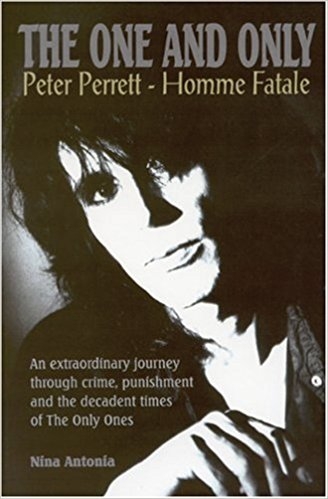
Le livre de Nina Antonia fonctionnerait presque comme un polar, car il y règne une certaine tension. Peter Perrett fut ce que la volaille appelle une grosse poissecaille, c’est-à-dire un gros dealer. Pourquoi travailler quand on peut se faire des montagnes de blé dans le deal ? - L’un des mes amis italiens revint de Bolivie avec un kilo de coke. C’était la première fois, on testait pour voir. On faisait cinquante cinquante, ce qui nous permettait de ré-investir. On avait un seul revendeur et on lui fourguait l’once au prix de 400 livres. On faisait un profit d’environ 700% - Peter raconte que jusqu’en 1975, il ne fumait que du hash. Il avait testé la coke, mais ça ne lui faisait pas assez d’effet. Puis il commença à consommer celle qu’il importait avec les Italiens. Elle était pure à 100% - Quand tu prends beaucoup de coke, tu bois de plus en plus et tu ne dors plus. Je buvais donc comme un trou. Puis je pris de l’héro une fois par mois, puis une fois la semaine - Peter redouble de prudence, mais la brigade des stups le harcèle. Le récit de Nina Antonia fourmille d’incidents policiers, de portes explosées au petit matin, de séances de tribunal et de nuits au trou avec ces fameuses couvertures qui sentent le vomi et qui sont bien sûr destinées à faire craquer les gens qu’on oblige à dormir avec.

C’est avec le deal qu’il finance son premier groupe, England’s Glory. Il baptise son groupe du nom de marque qui figure sur la boîte d’allumettes qu’il utilise pour allumer ses spliffs. Un petit label anglais réédita l’album dans les années 2000 et bien sûr, Nina Antonia signait le petit livret d’accompagnement. L’intéressant de cette affaire est qu’on voyait déjà apparaître ce qui allait caractériser le style des Only Ones, disons une certaine forme de décadentisme, notamment dans «Flowers Die», un vieux balladif fané qui, comme son nom l’indique, nous parle de dead flowers, un thème déjà bien exploré par les Stones ou encore les Saints. Avec «Weekend», Peter se rapprochait nettement de Lou Reed. On y entendait les accords de «Rock’n’Roll». Le cut ployait sous le poids des influences. «Shattered Illusions» se montrait digne des Only Ones à venir, poppy, baroque, inusité. On avait là un petit objet de curiosité finement travaillé, sans autre originalité que celle de sa propre existence. Avec «All In White», on entrait dans la décadence, le decaying side of it all chargé de toute la quintessence de fourrure mitée, de mascara périmé et de foulards en soie aux couleurs passées. Par contre, avec «In Betweens», on voyait que ça tournait un peu en rond et que ça puait la vieille ficelle de caleçon. Il fallait attendre «So Divine» pour frémir une dernière fois. Peter Pan et ses amis repompaient goulûment les accords du rigoletto nocturne de «Walk On The Wild Side», trempant leur doom de street urchin et de Jack the Lad dans une sauce indienne.
Pour entériner l’affaire, Nina Antonia cite Timothy Leary : «Trois catégories de gens vont amener une profonde transformation dans le new age. They are the dope dealers, the rock musicians and the Underground artists and writers.» Amusée par cet éclairage prophétique, Nina ajoute : Avec Peter, on en a deux pour le prix d’un.
C’est encore avec le deal que Peter finance le lancement des Only Ones dont personne ne veut à l’époque. Ils sont inclassables et donc invendables. Peter vient de rencontrer John Perry, Alan Mair et surtout Mike Kellie. Alan Mair ne touche pas à la dope, mais John Perry adore ça - La première année, je fréquentais Peter assidûment. We just got phenomenally stoned. The main activity at that point was coke - Ce groupe se présente comme une sorte de crème de la crème. Vu que l’argent coule à flots, Peter peut financer les heures de studio et le matériel. À cette époque, Peter dit adorer Dylan et le Velvet - Probably three quarters of the music I listened to was American - Et au plan personnel, il partage sa vie entre plusieurs muses : l’héro, Zena, Lucinda et les copines de Lucinda - Il roula un billet de cent dollars, sniffa une ligne de poudre blanche puis une ligne de poudre brune. Les lèvres de Lucinda suçaient son pénis et la langue de Jill explorait son anus. Jill qui était l’amie de Lucinda était aussi son cadeau d’anniversaire.

La femme de sa vie s’appelle Zena, issue d’une famille d’immigré grecs. Mais Peter aime aussi les autres femmes, et comme le lui dira plus tard Johnny Thunders, il a beaucoup de chance d’avoir rencontré Zena. Elle reste quarante ans avec lui, ça veut dire qu’elle partage les énormes risques du deal. Elle lui donne aussi deux fils, Peter Junior et Jamie, et quand les Services Sociaux britanniques lui retirent le deuxième, elle sombre elle aussi dans l’héro. Dans cette ambiance de chaos permanent, elle réussit à manager les Only Ones et dessine des fringues que copie Vivienne Westwood. Vivienne et Malcolm apprécient les «risqué designs» de Zena. Elle essaie de vendre Peter à McLaren qui cherche à monter un groupe à sensation, des «raunchy Bay City Rollers» - He wanted the Rollers, but he still wanted someone debauched looking like the New Yok Dolls, but not fucked up on drugs - Mais Peter se méfie du côté manipulateur de McLaren.
Zena pourrait bien être le personnage central de cette wild saga, car c’est elle qui rend tout possible en acceptant l’extravagance de Peter. Cette forme d’acceptation est un modèle du genre, celui dont rêvent tous les hommes qui n’ont pas la chance de côtoyer une telle femme - Si tu aimes quelqu’un, tu ne l’obliges pas à devenir ce que tu veux qu’il devienne. Peter ne m’appartient pas. Il me disait ceci : ‘Ce n’est pas que je ne t’aime pas, au contraire, je t’aime, mais j’aime aussi une autre femme.’ Il me disait aussi qu’il aimait passer du temps avec d’autres filles. Qui étais-je pour prétendre que j’étais la seule à pouvoir le satisfaire ? Ça venait peut-être de mon éducation, mais je ne voyais rien de mal à penser qu’on pouvait aimer quelqu’un d’autre. J’étais amoureuse de Peter, mais je faisais semblant de ne pas l’être. Je ne voyais pas comment faire autrement - Une prodigieuse intelligence filtre à travers cette confession. Zena retourne le principe d’amoralité comme une peau de lapin pour en faire un précepte d’une rare puissance. Il porte un nom : la générosité.
Danny Eccleston rend aussi hommage à Zena (qu’il appelle Xena) à sa façon : «Peter Perrett is friendly, funny, frank and guileless, but it’s his fears for Xena that make your heart most go out to him. He owes her everything.» (Peter est chaleureux, drôle, franc et naïf, mais c’est sa façon de se préoccuper de Zena qui le rend attachant. Il lui doit absolument tout).
La première fois qu’il prend de l’héro, c’est avec Lucinda - It was the best feeling in the world. We were like naughty kids together. Zena allait se coucher et on restait au salon - C’est l’époque où ils font ménage à trois - La première fois que tu prends de l’héro, ça rend le sexe mille fois meilleur et tu crois devenir très émotionnel - Peter ne se pique pas. Il chasse le dragon, c’est-à-dire qu’il inhale la fumée d’héro qu’il chauffe sur un papier alu - J’ai toujours fait les choses à l’extrême. The way I approached drugs was by taking as much as I possibly could - si je prenais des drogues c’était à l’excès. Quand tu fumes l’héro, tu mets un quart de gramme sur un papier alu et ça met 10 à 15 minutes à monter. C’est plus lent qu’un shoot, mais on overdose plus facilement avec un shoot - Mais il finit par se piquer lors d’une tournée américaine. Une fille l’embarque chez elle à Atlanta pour un shoot et Peter chope une hépatite. Mais Peter étant Peter, ses pairs lui reconnaissent des qualités, par exemple Nick Kent : «As a drug addict, Peter was a really nice guy and that’s very rare.»
Plus tard, Johnny emmène Peter dans le Lower East Side pour lui montrer ce qu’est le deal on wheels - Très peu de taxis acceptaient d’aller dans ce coin. Ceux qui acceptaient savaient pourquoi tu t’y rendais. Le taxi ralentissait, mais ne s’arrêtait pas, car c’était trop dangereux. Alors, des mecs arrivaient, ils couraient à côté du taxi, ils te montraient ce qu’ils avaient, et dès que tu avais filé le blé, le taxi repartait en trombe - Dans l’interview qu’on trouve à la fin du livre de Nina, Peter retrace nonchalamment son parcours : «Dans ma vie, j’ai eu 100% de réussite dans tout ce que j’ai entrepris. J’ai réussi dans le rock, et quand j’ai arrêté le rock et que je suis devenu un vrai drug addict, j’ai aussi réussi. J’ai toujours eu les meilleures drogues, je n’en ai jamais manqué, j’ai toujours été très organisé, je n’étais pas obligé d’aller chercher des doses dans la rue. I was a very privileged junkie.»

C’est Zena qui négocie le contrat des Only Ones avec CBS : 70,000 livres, avec 250,000 livres à venir pour dix albums. Sur le premier album des Only Ones, on trouvera une belle énormité : «The Beast». Monté sur un joli groove envoûtant, le cut s’emplit de son et lâche des vagues de pop ondoyante. C’est même joué jusqu’à la dernière goutte de son. Les Only Ones vont faire de ce genre de final éblouissant une vraie spécialité. L’autre gros cut de l’album s’appelle «City Of Fun», Mike Kellie y retrouve ses marques et muscle bien le beat. Mais les autres cuts de l’album sont très particuliers, on sent une tendance à la pop sophistiquée, une sorte de dandysme underground. Avec «Creature Of Doom», ils vont plus sur l’épique, mais c’est trop théâtral et trop valorisé par les excès de langage. Trop de mélange de genres et on finit par y perdre son latin. Un cut comme «Language Problem» semble âprement combattu, arraché de force à l’inertie, oui, ils font une sorte de pop informelle et peu décidée à en découdre. Dans Sounds, un journaliste compare Peter à Syd Barrett et à Kevin Ayers - Both parties write almost narrative lyrics that don’t follow the conventionally accepted styles.
Malgré le contrat mirobolant, les Only Ones ne roulent pas sur l’or. Mike Kellie est habitué à la dèche - La seule indépendance économique qu’on avait était celle qu’on ramenait avec nous. Je n’ai rien récupéré de Spooky Tooth and never had two pennies to rub together - Mike explique qu’il ont touché 500 livres chacun. Le reste du blé est parti dans l’équipement. Comme il n’a pas une thune, Mike vit chez à l’époque chez les Perrett. «Je croyais dans ce groupe. Je ne pleure pas sur mon sort, mais je me souviens d’avoir vécu cette histoire comme une frustration. It wasn’t terribly fair, but life isn’t fair. You want fairness, go to hell. If you want justice, become a Christian.»
On a jamais compris ce que venaient faire les Only Ones dans la vague punk de Londres. John Perry poussait la logique encore plus loin : il trouvait que l’anachronisme, c’était le punk-rock et non les Only Ones - We are a perfect expression of late ‘70 English rocn’n’roll and it was punk that was the oddity.

Even Serpents Shine sort un an plus tard et s’ouvre sur un cut purement wildien, «From Here To Eternity». Peter Perrett s’y livre à son exercice favori, celui d’une délicieuse déliquescence vocale. Puis il passe à la petite pop allègre avec «Flaming Torch» et tout le reste de l’A s’enfonce dans le non-événement. Le groupe se réveille en B avec l’excellent «Curtains For You», groove psychédélique dans la veine du «Cowboy Movie» de Croz. En ramenant son talent de batteur dans les Only Ones, Mike Kellie fait bien le lien entre les sixties et les seventies. Il appartient à la génération des Knox et des Chris Spedding qui ont su mettre un peu de plomb dans la cervelle du mouvement punk. Et dans «Someone Who Cares», Peter Perrett sonne comme un Lou Reed alangui. Selon Nina, cet album «has a certain baroque feel in common with the Doors at their most mesmerizing.» Quel drôle de compliment ! Pour Mike Kellie, l’album est un mélange de satisfaction et de déception. Selon lui, la pochette fut un cauchemar pour la maison de disques - A marketing man’s nightmare !

Et puis voilà le troisième et dernier album studio des Only Ones : Baby’s Got A Gun. Ils attaquent avec «The Happy Pilgrim» qui sonnerait presque comme une rumba, tellement le beat se veux joyeux et enlevé. Ils tapent dans le Diddley beat pour «Me And My Shadow». C’est de bonne guerre, après tout. On a encore de la petite pop indicatrice des penchants des Only Ones avec «Strange Mouth». Ils cherchent tellement à sophistiquer qu’ils en oublient de sceller le destin des chansons. On ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Il semble que le laid-back soit leur vrai terrain de chasse, car «The Big Sleep» éclate au grand jour, plein de décadence mortifère. En B, on tombe sur une petite merveille intitulée «Re-Union», dotée du meilleur son psyché et joliment martelée par Mike Kellie. Le heavy doom leur sied à merveille. En matière de laid-back, ils frisent la perfection. On a là le meilleur cut des Only Ones, léger et délié, joué avec un âcre raffinement. Par contre, «My Way Out Of Here» sonne comme du Buddy Holly. Mike Kellie bat ça à la petite cavalcade d’Hopalong dans les vastes plaines du Far-West. Ils sont marrants, à vouloir faire du Buddy Holly. Mais globalement, l’album manque de punch. Alan Mair : «Je pense que les chansons de Peter devenaient trop druggy. Elles étaient trop lentes, just too drug oriented.» Comme le rappelle si bien Nina, il faut bien dire que le riche mélange de séduction, de destruction et d’addiction que proposaient les Only Ones ne pouvait pas cadrer avec les aspirations superficielles du public des années quatre-vingt. Dans la presse, on se moquait de Peter : «The last survivor of the make-up and fake leopard skin wars.»
Alan Mair finit par ne plus pouvoir supporter le ballet funeste de Peter. Le groupe débarque à Amsterdam pour une tournée et plutôt que de préparer le concert, Peter et John Perry disparaissent pour aller faire leurs courses. Alan prévient que si Peter continue de monter sur scène complètement défoncé, il va quitter le groupe - He had been a magical bloke but that aura had gone - Pourtant, Peter tente de réagir : «Je n’aime pas que les gens nous fassent passer pour un groupe de drogués. Ça ne plait pas à ma mère. Elle m’inspecte les bras. C’est aussi très mauvais pour Alan qui ne boit même pas. Ce serait terrible qu’on se retrouve affublés de la réputation de Keith Richards, une réputation de junkie célèbre.» Mais comme l’ajoute Nina, c’est déjà trop tard.
Les Only Ones se séparent à l’issue de leur deuxième tournée américaine. Dans le show-business, on s’est bien moqué d’eux : pendant des années, dans les séminaires, les gens de CBS citaient les Only Ones as an exemple of how no to make it in the music industry - L’art de rater une carrière. Danny Eccleston en rajoute une couche : «The band who rewrote the rules on how not to get ahead in the music business, and a singer who earned more money selling drugs than making records.»
Pour leur quatrième album, les Only Ones avaient proposé à CBS un album de covers : «My Way Of Giving» des Small Faces (qu’on retrouve sur Remains), «Mamma You’ve Been On My Mind» de Dylan, «Gantanamera», «You Can’t Hurry Love» des Supremes, et «The Girl From Ipanema» d’Antonio Carlos Jobim. Dommage.
John Perry revient longuement sur la personnalité de Peter : «Dans son genre, Peter était un mec unique. C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à bosser avec lui. De toute évidence, sa voix n’allait pas plaire à tout le monde. It was a specialist taste. Tout en lui était unique : son look, le son de sa voix et les chansons qu’il écrivait.» Pour mieux situer le personnage de Peter, Nina cite Edmund White : «Le dandy remplace les traditionnelles hiérarchies de valeurs morales par des règles esthétiques qui lui sont propres.» John Perry voit chez Peter un mélange désarmant de timidité et de candeur, il voit aussi un esprit très calculateur contrebalancé par une extraordinaire naïveté - You have to look in terms of paradoxes. Mais la meilleure définition du dandysme, qui d’autre qu’un dandy comme Peter Perrett pourrait la donner : «I like to stand out, so I was fortunate at that time (1977). I like not fitting in - That’s what gives me great pleasure.» (J’aime me distinguer des autres. À cette époque (1977), j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire. Me distinguer des autres est ce qui me donne du plaisir).
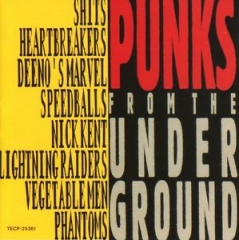
Et pour corser encore un peu le chapitre charme discret, Peter ne fréquente pas n’importe qui. Nick Kent confie que Johnny Thunders voulait Peter comme guitariste dans son groupe - Can you imagine ? For him to abnegate his ego to that point, which shows you how much Johnny respected Peter - Oh c’est vrai, l’admiration que portait Johnny à Peter surpassait celle qu’il avait pour lui-même. Ça montre à quel point il le respectait. Peter joua dans The Living Dead, mais ce n’était pas un groupe très officiel. Et Nick Kent ajoute : «They were a good pair, but Johnny let the lifestyle corrupt him, whereas Peter didn’t. Je ne l’ai jamais vu tenter d’arnaquer quiconque, mais la dope commençait à le ralentir.» Nick Kent raconte qu’il est allé en studio avec Peter au temps des Subterraneans. Il y avait aussi Mike Kellie et Tony James de Gen X. On trouve ça sur le fameux Punk From The Underground édité par Skydog. L’amitié de Peter et de Johnny remonte au temps des Heartbreakers, évidemment. Les Only Ones et les Heartbreakers n’avaient rien de commun avec la vague punk. Comme les Stones et les Who, les Only Ones et les Heartbreakers avaient un sens des dynamiques de r&b que n’ont jamais eu les groupes de punk-rock. Leur relation d’amitié reposait sur un goût commun pour la dope, bien sûr, mais aussi sur un «mutual level of respect, attraction and affection that was unusual for either of them.» Et ce n’est pas un hasard si Peter et Mike Kellie se retrouvent sur So Alone, le premier album solo de Johnny.
Tiens puisqu’on parle des Stones et des Who : les Only Ones seront invités à jouer en première partie des Who sur une tournée américaine, mais comme Daltrey ne peut pas les schmoquer, ils sont virés après cinq soirées au LA Sports Arena, «for failing to bond with the main band.» Quant à Keef, c’est une autre histoire. Il se disait intéressé par les Only Ones et voulait les produire - Keef was too stoned to roll. With his heavy lidded eyes, ruined teeth and Eucharist pallor, Richards had become the patron saint of white, middle-class junkies - Les Only Ones allèrent le rencontrer dans la maison qu’il louait à Donald Suntherland sur Old Church Street, à Chelsea - It was just before the Toronto bust and he was in the depth of his addiction. There was a great deal of fog to penetrate - Le projet échoua justement grâce au Toronto bust.

Pas mal de belles choses sur Remains paru en 1984, à commencer par la fameuse reprise des Small Faces, «My Way Of Giving». Idéal pour une rock star aussi anglaise que Peter Perrett. On a aussi «Flower Die» qui date d’England’s Glory, un cut salement atmosphérique, sans doute l’une de leurs meilleures exactions, et Mike Kellie double en fin de cut, alors ça décolle merveilleusement, d’autant que John Perry devient loquace. On a aussi un final flamboyant dans «My Rejection». Ces gens-là savent exploser une fin de cut, et c’est là où la présence d’un vétéran de toutes les guerres comme Mike Kellie se révèle déterminante.

Curieusement, c’est sur les albums live comme The Big Sleep enregistré en 1980, ou encore les Peel Sessions, que les Only Ones deviennent géniaux. The Big Sleep est un album absolument extraordinaire, bourré de son et de dynamiques jusque-là inconnues. «As My Wife Says» sonne tout de suite comme un classique de pop anglaise, bien claqué aux accords clairs de John Perry. En fait c’est lui, John Perry, qui fait le son du groupe, avec sa manie de faire tournoyer le son. L’«Oh Lucinda» live n’a plus rien à voir avec celui de l’album studio, c’est même le jour et la nuit, car claqué d’intro aux accords de Stonesy et bien emmené, bien dynamique et fruité à l’excès, même si Peter Perrett chante avec de la mélasse plein la bouche. Même chose avec «Language Problem», toxique et trituré par John Perry et Mike Kellie multiplie les effets de style. Sur l’album, tout est très joué, très enlevé, très touffu, très chanté. On a cette impression de densité qui n’existe pas sur leurs trois premiers albums. C’est encore plus frappant avec «The Beast», chef-d’œuvre de pop décadente et sacrément latente. C’est extraordinairement ambiancier, aux limites de l’imparable. Même l’«Another Girl» qui suit n’a rien à voir avec la version originale, tellement c’est joué vite, avec un punch terrible. Sur scène, ce groupe devient un véritable buisson ardent. C’est dingue ce qu’ils sont bons ! Ils tapent chaque fois un final éblouissant. Extraordinaire «City Of Fun», joué à l’énergie concomitante, Mike Kellie s’en donne enfin à cœur joie, il tape dans tous les coins. Tout le jus des Only Ones est là.

Si on aime bien les Only Ones, il faut aussi écouter Darkness & Light, la compile des BBC sessions. C’est l’un des disques qu’on emmènera sur l’île déserte, avec The Big Sleep. Quasiment tous les cuts sonnent comme des énormités cavalantes et bien sûr, toute la décadence du rock anglais rapplique au rendez-vous. On tombe très vite sur une version d’«Another Girl Another Planet» claquée au riff salace par ce dingue de John Perry. Même chose avec «The Beast» : on sent ramper le souffle nauséeux dès l’intro. C’est aussi profond et jouissif qu’un hit des Doors. Les Only Ones flirtent avec la démence. On a là l’apocalyptic side of it all, avec un final démentoïde. Voilà les Only Ones qu’il faut écouter. «Langage Problem» déborde aussi d’énergie, ils jouent ça à fond de train, emmenés par Mike la loco, ce Kellie killer de beurre. Tout aussi incroyablement tonique, voici «Miles From Nowhere», surchargé de basslines cavaleuses, chanté à la junky motion et pulsé par ce dingue de Mike Kellie. On a là l’une des meilleures équipes de popsters d’Angleterre. Ce groupe maîtrisait l’art des dynamiques fulgurantes et curieusement, on ne les retrouve sur aucun des trois albums studio. John Perry amène «From Here To Enternity» au pinacle, et ça continue comme ça avec «Prisoners», véritable slab de good time music à l’Anglaise, mais là, ça prend des couleurs et du volume ! Quelle incroyable vitalité du son, my son. John Perry boucle tous les cuts à coups de violentes dégelées impavides. Dans «The Happy Pilgrim», on l’entend mettre en valeur le chant accidenté de Peter Pan. Et Mike Kellie se bat comme un dieu affûté. Tout dégouline de jus et de son. On plonge à la suite dans «The Big Sleep» infesté de requins, avec un Perry qui bien sûr part en vrille. Le seul conseil qu’on puisse vous donner à ce stade d’effusion est d’écouter «Why Don’t You Kill Yourself». Ils y explosent le carabinage. C’est au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Ce diable d’Alan Mair fait des prodiges sur son manche de basse. Alors bien sûr, on retrouve plusieurs fois les mêmes cuts, car les sessions se succèdent les unes aux autres, mais à aucun moment on ne décroche, car dès le retour de «The Beast», on sent l’embardée, on sent l’aura de l’empereur romain, on sent la fin de règne et l’écroulement des illusions. On ne trouvera jamais ça ailleurs. Tiens, encore un coup d’Another Girl, histoire que vérifier que cette jungle sonique est toujours aussi épaisse. Alan Mair charbonne comme un dingue sur sa basse et Mike Kellie tape dans tous les coins. Il aurait fallu les enfermer, à l’époque. On a aussi un «She Says» complètement explosé du cortex. Enfin bref, ce double album est une nécessité. John Perry : «I particularly like the Peel Sessions because they reveal what the band was best at, which was playing more or less live. They were very concise, ordered sessions, recorded in an afternoon and mixed in an evening.» Nina Antonia parle de «far greater depth of emotion both vocally and musically», et même de «much more of a Perrett melodrama, complete with pushy bass runs, knock-out drums and crackling guitars.»

En 1996, Peter Perrett enregistrait un excellent album solo, Woke Up Sticky. On avait avec le morceau titre un merveilleux spécimen de Beautiful Song, un chef-d’œuvre mélodique qui tombait comme une bruine de lumière sur la terre. Il enchaînait avec «Nothing Worth Doing», une fantastique explosion de power-pop balayée par des vents de guitares. Aucun cut des Only Ones n’avait jamais sonné comme ça. Il poussait encore le bouchon de l’excellence avec «Falling», une sorte de descente aux enfers de la pop. Peter Pan peut devenir monstrueux si on lui donne de bonnes chansons. C’est ici le cas. Il semblait qu’avec cet album, il atteignait enfin les cimes. Il avait derrière lui un fabuleux guitariste nommé Jay Price. Il tapait aussi dans les Kinks avec «I’m Not Like Everybody Else», d’une façon tellement impeccable qu’on avait l’impression que Ray Davies avait écrit ce hit spécialement pour lui. Derrière, un bassmatic nommé Richard Vernon jouait à l’outrance de la prestance. Il nous pulsait ça au bottom line et Peter Pan réanimait la magie des sixties. On s’affolait d’entendre un disque de rock anglais aussi parfait, car tout y était : la classe, la stature, l’allure, le port et le maintien. Et ça continuait avec «Sirens», joué à l’excellence du gospel according to Peter. On avait là un cut solide, bardé de dynamiques jugulaires nappées en couches superposées, oui, un cut chargé de son et d’élan à ras la gueule du mousqueton. Oh et puis, il fallait aussi écouter attentivement «Land Of The Free». Peter y jouait le Dominatrix kinda thing, avec une décadence qui suintait par tous les pores d’attache de sa légende. Il psalmoldiait dans la pénombre, les yeux couverts de khôl.

Quand Danny Eccleston rencontre Peter Perrett pour parler du nouvel album, il lui demande sur quoi portent les chansons et Peter lui répond en souriant : «Mostly about death». Et il ajoute : «Seriously, the one thing that is new on the horizon is the proximity of mortality. When I was young, I was indestructible. Now I think about what it would be if my wife died.»

Et pouf, son nouvel album solo vient de paraître. Il s’appelle How The West Was Won et vaut son pesant d’or. Peter Pan l’attaque avec le morceau titre, une sorte de groovy cut à la Lou Reed et refait l’histoire du Far West avec les Indiens et les Mexicains qui en prennent plein la gueule, qui feel the rope, the blade, the gatling, puis c’est au tour des buffalos de passer à la casserole. Tout au long de cette infernale diatribe, Peter soigne son style de dandy décati. Avec «An Epic Story», il propose tout simplement une Beautiful Song, c’est-à-dire un grand balladif élancé. C’est sûr Sam, c’est un smash - It’s too late for repentance of sin/ Don’t worry babe - et il lance son message fatal - I’ll always be your man/ No one could love me the way you can/ If I could live my whole life again/ I’d choose you every time - Cette façon qu’il a de tartiner son every taïme ! Eh bien, avec «An Epic Story», on se retrouve une fois de plus gros Jean comme devant avec un hit planétaire sur les bras. C’est aussi beau et puissant que «L’Inaccessible Étoile» de Jacques Brel - Aimer jusqu’à la déchrirrrrure/ Aimer même bien même mal - ou «L’Hymne À L’Amour» d’Edith Piaf - Que m’importe si tu m’aimes/ Je me fous du monde entier - Peter ajoute : «Quand tu es avec quelqu’un, tu peux rire de tout et même des choses les plus cruelles de la vie. Le monde fait très peur, mais quand on est deux, c’est moins dur. Comme le dit Dylan dans Brownsville Girl, Strange how people who suffer together have stronger connections than people who are most content.» Il revient à la femme de sa vie dans «Troika» - I’ll always be a part of you - Si on veut savoir à quoi ressemble le romantisme à l’Anglaise, c’est là. Love is the drug. Mais la B est encore plus spectaculaire, car «Man Of Extremes» est un véritable coup de génie. On a là une belle pop d’action directe immédiatement accessible, classique en diable, ultra chantée, mais la distanciation du dandy - It’s a sick so-caï-ty/ Thre is no place left to hide to be free - Franchement, c’est digne du Dylan de 1966. Et ça continue avec «Sweet Endavour», une pop typique des Only Ones, très épique et secouée de belles dynamiques internes. Il nous fait ensuite la grâce de chanter un balladif intitulé «C-Voyeurger». Cet indubitable romantique n’en finit plus de bercer nos cœurs de langueurs monotones - Can’t live without the girl I love/ There’s no point living in this world when she’s gone - Et ça repart de plus belle avec «Something In My Brain», fantastique groove perrettien amené sous le boisseau - Now rock and roll is back in me/ Oh yeah - et il en profite pour glisser des petites insinuations autobiographiques : il se compare à un rat de laboratoire qui préfère le crack à la vie - He could choose life/ Or he could choose crack - Cet album fantastique se termine avec «Take Me Home», joué aux grandes eaux de la power-pop - I wish I could daïe in a hail of bullets some taïme - Avec sa diction dépravée, Peter Perrett restera l’un des plus grands chanteurs d’Angleterre. Danny Eccleston confirme tout ça à sa manière : «The headline news : Peter Perrett is back from the dead and has made an album that’s worthy of his legend.»
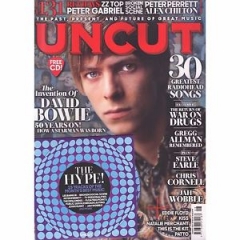
Dans Uncut, Alastair McKay dit à Peter que son nouvel album ne sonne pas comme un discours d’adieu et Peter confirme. C’est pour lui la possibilité de faire de la musique, which not many people of my age are privileged enough to expérience. Et quand McKay lui demande si c’était facile de retrouver la santé, Peter lui répond que ça revenait juste à prendre une décision - But once I make a decision, I find it very easy. Et il ajoute que lors d’un séjour récent à Berlin, il avait commandé une bière sans alcool, and my tolerance is so low, I got drunk on that. That shows how clean I am. Peter appelle son humour the gallows humour (If you’re on the gallows and the trap door is about to open then your best friend is gallows humour - c’est-à-dire l’humour du pendu, quand on a la corde au cou et que la trappe sous les pieds va s’ouvrir).

Il fut un temps où on ramassait encore les DVD. Le concert filmé à Shepherds Bush en 2007 valait vraiment le détour, car on y voyait apparaître un Peter Perrett arbitre des élégances, lunettes noires, grand manteau d’épouvantail, chemise à motif floral et pantalon flottant. Il attaquait un drôle de set d’une voix perçante au timbre frelaté - I’m always in the wrong place/ In the wrong time - John Perry y jouait sa dentelle et Alan Mair labourait les terres en profondeur. Ils reprenaient le «Flowers Die» qui date du temps d’England’s Glory, sur les accords de «Wild Horses». La dynamique des Only Ones se mettait alors en route et ils concluaient sur un final éblouissant. Ce concert filmé permettait de confirmer cette vieille théorie : sur scène, les Only Ones avaient le génie pop-rocky des dynamiques internes et externes. Peter enlevait son manteau et annonçait : «This is a new song, it’s called Dreamt She Could Fly». Bien sûr, le set souffrait de certaines longueurs, comme d’ailleurs les albums studio, certains cuts semblaient traîner en longueur, mais John Perry n’en finissait plus de les enluminer. Il était intéressant de noter que Peter Perrett avait alors exactement la même morphologie que Keith Richards, avec un visage taillé à la serpe, construit comme un dégradé de frange puis de nez en surplomb d’un menton sec, et ses joues étaient celles d’un crâne de catacombe. On reconnaissait le gratté d’accords d’Another Girl dès l’intro et John Perry l’ornait de son vieux phrasé glorieux. Et tout le Shepherds Bush Empire dansait. «The Beast» sonnait aussi comme au bon vieux temps, avec ses fantastiques descentes dans les soutes du blues-rock de facture classique et John Perry piquait une merveilleuse crise de solotage. Rien qu’avec ça, on pouvait considérer les Only Ones comme des Beasts de finitude, ils explosaient leur vieux boogie à la cantonade, ils montaient ça en grosse apothéose shepherdienne de Bush bash. On sentait bien sûr le puissant Spooky Tooth derrière tout ça. Eh oui, Killer Kellie n’est pas né de la dernière pluie ! On voyait même Peter gratter comme un con, il fouettait sa pauvre Télé comme s’il se fût agi du cul rebondi de Justine dans Les Infortunes De La Vertu.
En guise d’exergue à l’épilogue du livre, Peter déclare : «Don’t believe everything you read - ne croyez pas tout ce que vous lisez.» Et il s’en explique ainsi : «À l’âge de 24 ans, je pris la décision de ne plus lire. Je voulais que toutes mes idées soient les miennes.»
Et quand il aborde le chapitre Mike Kellie qui vient de mourir, Peter n’y va pas par quatre chemins : «Kellie was the one person who you didn’t expect to die. He used to walk up mountains and stuff, he’d go hiking.»

Aujourd’hui, le problème de Peter est de pouvoir respirer, comme il le confie à Hugh Gurland : «I used to smoke thirty or forty joints a day and skunk tends to be quite strong. I was still pretty useless up until I stopped smoking cigarettes and joints, which was April 8th 2011(...) I try and make the best use of my lungs that I possibly can.» Alors forcément, quand on se rend au Point Éphémère pour assister à son concert, on s’attend à le voir diminué, comme ce fut le cas pour Johnny Winter qui ne tenait plus debout, ou Andre Williams qui peinait à retrouver du souffle au deuxième cut. Va-t-il chanter assis dans une chaise roulante, avec un masque à oxygène ?

En réalité, cet enfoiré se porte comme un charme. Il arrive sur scène serré dans un petit costard à rayures. Il porte beau, lunettes noires, le cheveu brun et un beau sourire cadavérique aux lèvres. Il passe la bandoulière de sa Strato noire et hop, c’est parti pour une heure trente de show incroyablement intensif. Franchement c’est à ne pas croire, de voir ce mec qui se disait mourant mener le bal comme il le fit voici quarante ans. Sans même transpirer, ou si peu. Et avec une classe qui laisse rêveur. On n’avait pas revu ça depuis Ronnie Lane. Très peu de gens se pointent sur scène avec autant de grâce rock’n’roll. Il est l’une des plus brillantes incarnations du dandysme rock. Le moindre geste est une merveille d’élégance, sa voix est intacte et les chansons parfaites. Il tape dans tout et les cuts du dernier album tapent dans le mille, surtout «Something In My Brain» qui fait pas mal de ravages dans les imaginaires des fans agglutinés au pied de la petite scène. «How The West Was Won» passe comme une lettre à la poste et sa diction est telle qu’on refait l’histoire en direct avec lui. Il tire aussi «Living In My Head», «C Voyeurger» et «Take Me Home» du dernier album.

Sur scène, les nouveaux cuts prennent un relief particulier. Son fils Jamie joue lead et deux petites poules ramènent du Yin dans le Yan perettien. Il tape dans «The Big Sleep» et même l’excellent «Woke Up Stick». Il faut toute une vie de rock pour produire un phénomène aussi spectaculaire que Peter Perrett. C’est en le voyant qu’on comprend que tous les excès mènent à Rome. Ça va si loin qu’on ne peut même pas le plaindre, puisqu’il n’est même pas abîmé. Il enterre déjà tous les vieux punks qui vieillissent si mal.

Quand arrive le riff d’intro d’Another Girl lors du premier rappel, le public explose, c’est de bonne guerre. Pour entendre cette exaltante merveille qu’est «Troika», il faut attendre le second rappel, et là, franchement, on se sent au bord des larmes, car Peter pulvérise absolument tous les records de grandiloquence sentimentale classieuse. C’est là qu’on prend l’I’ll always be a part of you en pleine gueule, c’est encore autre chose que d’écouter un disque à la maison. Voilà sa force, voilà sa grandeur, voilà sa vraie nature. Sur scène, cet homme revenu de tout a l’air vraiment heureux. Il ne parvient même plus à maîtriser son sourire.

Signé : Cazengler, Only Âne
Peter Perrett. Le Point Éphémère. Paris Xe. 14 novembre 2017
England’s Glory. The First And Last. Diesel Motor Records 2005
Only Ones. The Only Ones. CBS 1978
Only Ones. Even Serpents Shine. CBS 1979
Only Ones. Baby’s Got A Gun. CBS 1980
Only Ones. Remains. Closer Records 1984
Only Ones. The Big Sleep. Live In Europe 1980. Jungle Records 1993
Only Ones. Darkness & Light. The Complete BBC Recordings. BBC 1996
Peter Perrett. Woke Up Sticky. Demon Records 1996
Peter Perrett. How The West Was Won. Domino 2017
Nina Antonia. The One & Only Peter Perret, Homme Fatale. Thin Man Press 2015
Danny Eccleston : Ballad Of A Thin Man. Mojo #284 - July 2017
Hugh Gulland : Once Upon A Time In The West. Vive le Rock #46 - 2017
Alastair McKay : How The West Was Won. Uncut #243 - August 2017
Only Ones. Live At Shepherds Bush - 9th June 2007. DVD 2008
CABALA
LED ZEPPELIN OCCULTE
PACÔME THIELLEMENT
( HOËBEKE / Octobre 2009 )

Dès sa préface Philippe Manoeuvre vous invite à poser vos grosses valises rock'n'roll dans le vestibule. Oui John Bonham savait vous battre les oeufs en neige mieux que quiconque, OK John Paul Jones était un arrangeur hors-norme, yes Jimmy Page était un sacré guitaro, ya Robert Plant savait feuler comme un puma agonisant, mais il ne s'agit pas de cet aspect-là des choses dont il est traité en cet opus. Le Cat Zengler le rappelait la semaine dernière dans sa chronique sur les Stooges, que pour être une espèce de showman un tantinet destroy l'Iguane, déjà à cette époque, n'était pas un abruti. L'était pourvu d'intelligence et de flair. Savait où il allait et ne partait pas à la conquête du monde avec la tête creuse.

Tout le monde n'est pas Sid Vicious. Encore qu'être Sid Vicious n'est pas donné à tout le monde. L'est un principe de base qui préside à l'écriture de ce livre, les gars qui ont fomenté le projet Led Zeppelin ne se sont pas lancés à l'aventure les yeux fermé. De fabuleux musiciens certes – ça aide – mais la tête pleine d'idées, même si c'est avec des instruments que l'on fait de la musique. Pacôme Thiellement part du principe que les membres de Led Zeppelin ne manquaient pas de culture. Culture rock, cela va sans dire, la liste de tous ceux qu'ils ont pillés dans le blues trahit une compétence acérée. Mais aussi, tout un acquis de connaissances, de lectures, d'observations et de réflexions diverses qui ont orienté leurs choix autant stratégiques que philosophiques. Les interviewes de Jimmy Page et de Robert Plant ne laissent planer aucun doute quant à cela. Même si à partir d'un certain point d'investigation par trop précise, ils éludent les questions et bottent rapidement en touche...

Vu de l'extérieur Zeppelin était une grosse machine à cash. Ramassait les liasses de billets par ballots. Mais le groupe ne mégotait pas sur la quantité et la qualité. Concerts extraordinaires, enregistrements historiaux. Une pompe à phynances qui aurait ravi le Père Ubu. Toutefois ce sont vos ennemis qui révèlent le mieux vos points faibles. Portent toujours l'attaque, là où ça fait le plus mal. Très vite pour le Led, les campagnes de déstabilisation n'ont pas manqué. Le sexe – n'avaient pas fait vœu de chasteté – les drogues – y ont succombé sans se cacher – et le rock'n'roll – particulièrement tonitruant, clinquant et déchiré chez eux, s'en vantaient, en étaient particulièrement fiers. Petite bière que tout cela, autant reprocher à un alcoolique de boire de l'alcool. S'ils s'étaient contentés de ces trois vices rédhibitoires, on leur aurait presque pardonné. Mais non, z'étaient comme Socrate, mais en pire, corrompaient la jeunesse, ébranlaient l'édifice moral de la société, mais aggravaient leur cas, attention lecteurs kr'tnteurs, retenez votre souffle – les ligues de vertu sont toutes d'accord sur ce point : z'étaient z'avant tout des zuppôts de Zatan ! L'on s'en inquiéta publiquement jusque dans les plus hautes sphères de la Maison Blanche. Arrêtez vos rires gras et de vous taper sur les cuisses. La vérité c'est que c'est la vérité vraie. Et Pacôme Thiellement prend à cœur de nous l'expliquer de long en large. Avec tout de même ce bémol d'importance, c'est que la vérité tout comme le mensonge possède plusieurs facettes, plus ou moins attrayantes, à tel point d'ailleurs qu'il peut vous arriver de les confondre...
CIA. Non, ce n'est point un début d'accusation contre la célèbre agence américaine, pour une fois, elle n'y est pour rien. Ou alors elle l'a bien caché. C pour Celte - désolé les rockers ce n'est pas pour country, I pour India je reconnais une légère influence hippie, A pour Arabe, pas spécialement des terroristes. Simplement les influences musicales revendiquées par le Zeppe. De Bron-Y-Aur à Kashmir pour ceux qui ont la disco dans la tête. Mais pas que. Chaque musique véhicule sa culture. C'est là que les non-initiés vont décrocher. Car le savoir officiel, Le Zep il s'en moque, s'intéresse à la connaissance sacrée, à l'ésotérisme, à la gnose.

Thiellement aussi. C'est son dada. On le lui a beaucoup reproché lorsque le livre est paru. Il est étrange de voir combien les gens se fâchent quand on leur tend un miroir dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Parfois je me dis que s'ils avaient lu par exemple Oscar Vladislas de Lubicz Milosz ils ne se cabreraient pas autant devant l'image de leurs ignorances. C'est sûr que Jimmy Page ne fait rien pour arrondir les angles. S'est toujours revendiqué d'Aleister Crowley. Vous ne trouverez pas plus charlatan que lui. Nous avons déjà évoqué sa figure dans KR'TNT ! Mais s'en référer à Crowley en public, c'est comme si vous improvisiez une conférence sur les bienfaits de la prostitution sacrée dans une assemblée de féministes. Les enseignements de Crowley sont incompatibles avec la raison raisonnante qui gouverne notre monde ( qui se porte si bien ). Fut un adepte de la magie ( rouge dirait Philippe Pissier ), pratiqua entre autres des rituels d'invisibilité, diaboliques et sexuels. Vous n'êtes pas obligés d'y croire. Mais dans la vie, il ne faut pas croire. Il faut savoir. Sinon, vous vous taisez. Derrière Crowley se profile en notre vieille Old England tout un monde intellectuel de haut niveau, de Lewis Carroll à Yeats, de Shelley à John Dee. Des gens qui professent des théories sociales et comportementales que Nietzsche définissait par delà le bien et le mal. C'est qu'au bout d'un certain moment, que le dieu ou le diable soient votre support cela importe peu si vous pensez chevaucher le tigre.

N'y a pas que les anglais, la littérature française est aussi à l'honneur, Raymond Abellio et sa Structure Absolue, et une sentence comminatoire à méditer de Jean Parvulesco. Les Italiens se taillent la part du lion avec Marsile Ficin, en profitent pour s'infiltrer à la suite du protégé des Medicis, les soufis et toutes les théories déviantes de l'Islam, la légende du douzième Iman et toute la théologie transgressive des Fidèles d'Amour, je vous fais grâce des classifications tantriques d'Inde... L'étude des textes du Dirigeable réserve bien des surprises. Page et Plant en connaissent bien plus qu'ils ne l'admettent. Ne sont pas fous, ne vous écrivent pas ce qu'ils pensent noir sur blanc. Faut savoir lire les indices. Ne faites pas comme Thiellement qui ne vous dit pas tout. Cherchez plus à fond. Par exemple penchez-vous sur le Led Zeppelin III, ne serait-ce que l'étrange roue à symbole de sa pochette ( procurez-vous un 33 tours d'époque ), Thiellement insiste beaucoup sur le IV, le disque sans nom, revient sans cesse sur cette Dame qui achète – mettez en relation avec la machine à cash – un escalator électrique pour le paradis et attendez-la lorsqu'elle redescend. Relisez en attendant, par exemple, El Desdichado de Nerval, Cela ne peut pas vous faire de mal. Que sont ces maisons sacrées de Houses of the Holly – voilà une question qu'elle est bonne – et de quels fils ( prononcez de deux manières ) est tramé le cachemire du tapis volant de Kashmir, et pourquoi Achilles Last Stands sur Presence ? Thiellement ne répond pas à toutes les questions mais il apporte des questions éclairantes. L'ouvre des portes, à vous de les franchir...

Cabala, ce n'est pas la Kabbale juive, mais le caballum que l'on charge de tous les acquis que l'on a ramassés ou glanés tout au long de sa vie. Nietzsche employait le terme de chameau pour désigner cet animal de bât intellectuel. C'est au lion ensuite de mettre de l'ordre, de déchiqueter de ses dents et de ses griffes tout ce qui est inutile. Peut-être alors deviendrez-cous comme les enfants blonds sur la chaussée des géants de Houses of the Holly. Mais personne ne vous oblige à grandir. Assumez vos choix. N'oubliez pas que tout maître fût-il aussi prestigieux que Led Zeppelin se doit de périr de la main de celui qui a cru en lui.

Ce qui est prodigieux dans Led Zeppelin – en dehors de sa musique – et nous ne sommes pas ici pour savoir si sa qualité intrinsèque dépend ou non de sa mise en situation – c'est la manière dont le groupe en tant qu'entité rock'n'roll a été pensé. Ce qui fait la différence dans le rock ce sont les quatre-vingt dix-neufs pour cent d'énergie qui doit impérativement le constituer. Mais le mystérieux un pour cent restant est tout aussi important. Un sacré multiplicateur, tout dans le dosage, manipulation commerciale, ou manipulation mentale ? Vous fait-on cracher au bassinet, ou accéder à un nouvel état de conscience ? Généralement les pourceaux d'Epicure de la consommation auditive n'entrevoient même pas la possibilité de la question. Ce livre de Pacôme Thiellement est parfait pour mettre les groins en chemin vers des nourritures d'un autre genre.
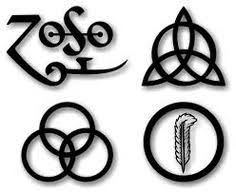
Esthétiquement le livre est une réussite. Intellectuellement il heurtera les sensibilités cartésiennes qui sont convaincues que deux droites de savoirs parallèles ne se croisent jamais. L'exige une faculté à s'étonner. Pourquoi par exemple, l'auteur traite-t-il en si peu de lignes L'Objekt qui prolifère sur la pochette de Presence - la jaquette de Hollydays in the Sun des Sex Pistols en est une délicieuse et imbécile parodie – alors qu'il revient systématiquement en pleine page à chaque nouveau chapitre ? Répondez en quinze pages. Vous n'êtes pas obligés. Faites ce que vous voulez.
Damie Chad.
COLLECTION ROCK & FOLK N° 4
LED ZEPPELIN

Les menées souterraines du hasard ? A peine venais-je de terminer l'article précédent que dans le kiosque à journaux sur le présentoir, deux chevelures rapprochées, l'une noir corbeau, l'autre de toute blondeur léonine, m'arrachent la vue. Pas encore lu le titre que j'énonce à la grande joie du tabagiste qui en fait tinter d'aise son tiroir caisse avant même que je ne lui aie tendu l'objekt de tous les délices, une maxime définitive ''Led Zeppelin, je prends d'office !''

Ne se sont pas beaucoup fatigués chez Rock & Folk, n'ont pas pris la peine de pousser la rédaction à carburer sur de nouveaux articles définitifs, l'annoncent en toute honnêteté et sans honte au bas de la couve, En collaboration avec Uncut. Ont adopté un principe simple : premièrement : traduction des articles d'Uncut présentant dans l'ordre chronologique les dix disques du Zeppe, deuxièmement : les chroniques d'époque du Melody Maker qui ont précédé ou suivi la sortie des galettes à effets catatoniques, troisièmement : les interviewes principalement de Jimmy Page et de Robert Plant relatives à chacune des étapes foudroyantes du Dirigeable, quatrièmement : visite commentée de l'épave du Dirigeable foudroyé avec suivi des aventures personnelles de chacun de nos héros. Loi du boomerang, ce sont les Titans qui forgèrent la foudre de Zeus qui en furent les victimes désignées. Terrible, vous ne pouvez pas évoquer Led Zeppelin sans que les Dieux de l'Olympe ne s'en viennent sonner à la porte.

Apparemment les journalistes d'Uncut ne sont pas des membres clandestins de l'Ordre Trismégiste de l'Aube Dorée Reconstituée, ne s'en tiennent qu'aux faits – lieux, dates, personnes - et leurs jugements même quand ils sont des plus subjectifs quant à la valeur de tel ou tel opus ne s'écartent jamais de données purement objectivales, ne se laissent jamais tenter par des méditations erratiques dans le genre de Pacôme Thiellement. Signe que la musique du vaisseau amiral de la flotte du rock'n'roll est assez riche pour susciter de nombreuses approches. L'on peut ergoter sur l'originalité et la créativité du numéro mais pas sur son amplitude. Six heures de lecture assurée. Plus les photographies à admirer avec recueillement et attention. Un ouvrage idéal pour les jeunes générations, les Doors et Led Zeppelin restent les groupes historiaux encore écoutés et respectés par les lycéens qui connaissent tant soit peu leur musique mais point par le menu la monstrueuse saga du plus grand des dinosaurocks ayant vécu sur notre planète.

Lorsque Edward Gibbon intitula sa grande fresque Histoire de la Décadence et de la Chute de l'Empire Romain, il rassura par deux fois ses lecteurs. Certes l'Imperium s'était écroulé, mais cela avait pris du temps. Deux siècles avant la syncope finale, les élites s'interrogeaient sur la survie de ce pachyderme qui dépassait les mille ans d'existence. Désormais il n'y avait pas plus à s'interroger sur l'inéluctabilité future des catastrophes que sur l'imminence proximale de leur survenue. Pour le Led Zeppelin, ce fut terminé en six semaines. En vrai à la mort de John Bonham, étranglé dans son vomi – les éléments sordides sont typiquement rock and roll – les carottes étaient cuites. Ne fallut qu'un mois et demi aux trois survivants pour rédiger le communiqué final signifiant au monde entier la mort de l'aventure.

L'est une autre manière d'analyser les ferments décadentistes. A peine l'homme a-t-il atteint l'âge de sept ans – les biologistes l'assurent – nous ne progressons plus, nous nous renouvelons, nous nous étoffons, nous grandissons, mais les ferments mortuaires nous inclinent déjà vers notre tombe, même si les transformations de l'âge adolescent et l'éclat de notre jeunesse nous donnent l'illusion que nous suivons une voix royale de floraison infinie... qui inexorablement nous conduit au cimetière. Envisagé sous un angle similaire la trajectoire de Led Zeppelin est des plus inquiétantes. Le groupe est formé en 1968, il livre dès 1969 deux albums époustouflants, le I récapitule toute l'histoire du blues anglais en cinq morceaux, efflorescence absolue, épanouissement total. Le II fonde le heavy metal, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des précurseurs, un peu partout et autour d'eux, c'est qu'ils le propulsent avec une puissance inimaginable en leur temps. Le passé du blues et le futur du rock en deux disques. Personne n'avait fait ça avant eux. Et chose plus grave, personne n'est capable de le refaire. Rajoutez des tournées américaines époustouflantes, et dites-vous qu'en deux ans le Led a réalisé en ving-quatre mois ce que la plupart des bands ne réaliseront pas en vingt longues années d'approximations incertaines.

Déjà avec le III les choses se gâtent. Perso, je le préfère aux deux précédents. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur, c'est parce qu'il est différent. Passons sur les fans désorientés par son côté folk. Le Led se suicide. Tout seul. Généralement les artistes subissent des contraintes, des pressions de la maison de disques, de leurs staffs à l'affût des schémas prévisionnels de vente à un accès très grand public, mais le Zeppe a fignolé ses contrats, ont imposé la liberté artistique totale, et d'eux-mêmes ils coupent court à la surenchère sonique que l'on attendait d'eux, font de la dentelle au marteau-pilon, bref ils interrompent d'eux-mêmes le processus de sur-rajeunissement phonique pléthorique incessant qu'ils avaient eux-même initié.

Avec le IV nous font le coup du chemin heideggerien qui s'infléchit brutalement dans la direction opposée à celle qu'il suivait. En même temps nous font remarquer que le chemin qui monte ( Black Dog ) est aussi celui qui descend ( Stairway to Heaven ) – étrange comme le paradis se trouve à la place habituelle de l'Enfer - bref le Wild and the Mild entrent en de curieuses concomitances. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et hop, nous resservent avec le V le coup du III. S'en vont habiter d'étrange maison. Houses of The Holly. Rien à voir avec la Fun House des Stooges. Z'ont mis des housses sur les canapés, vous avez peur de les salir si vous vous y allongez dessus avec votre petite amie. Une ambiance perverse et pernicieuse. Ça embaume les trafics illicites, les trucs louches, du rock'n'roll trafiqué, de la pop dégriffée, du la symbiose douteuse, du bio négatif. A peine y avez-vous goûté que vous y retournez. Poison mortel. Irrésistible.
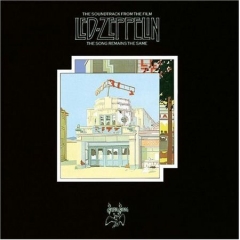
Vous commencez à comprendre comment le Zeppelin fonctionne. Gonflent le ballon explosif à bloc. Puis le vident de son hydrogène, le voici tout flasque, du dur au mou, de l'érection à la débandade. Et chaque fois l'état atteint est délicieux. Evidemment le Physical Graffiti est très physique. Bodybuilding appuyé. Muscles d'acier. Pectoraux chromés. N'empêche qu'à y réfléchir la saga du Zeppelin se déroule selon un rythme déroutant. Un coup trampoline éblouissant, un coup matelas pneumatique crevé. Ne donnent jamais dans la demi-mesure. Les médecins vous déconseillent ce genre de vie. Qui cherche le bâton de chaise finit par se faire battre. Vous connaissez l'apologue de la mort lente et de la vie vive qui se battent dans un duel à mort. Donc vous savez comment cela finira.

Lorsque paraît en 1979 In Throught the Out Door, Bonham est rongé par l'alcool, Page par l'héroïne, Plant anesthésié par la mort subite de son fils de cinq ans, et le disque tient davantage du génie de la bricole – mais de ces étudiants doués qui vous fabriquent une bombe atomique sur leur gazinière – extrêmement prometteur, mais la disparition de Bonham stoppe tout développement ultérieur.

Presence paru en 1976 est le dernier véritable disque de Led Zeppelin. The Last True Record. A sa sortie le couperet est déjà tombé. Robert Plant se remet difficilement de son accident de voiture. Mon disque mascotte de Zeppelin, celui que j'emporterais sur l'île déserte du Cat Zengler. Je dois être le seul fan du combo à émettre un seul choix. L'est celui du retour aux origines. Non pas au blues, mais au rock. Le Led a déplacé le curseur du noir au blanc. Ce basculement d'intérêt n'est pas étranger aux fortes réticences de Robert Plant à la reformation du groupe. Un désaccord musical fondamental l'oppose à Jimmy Page responsable de cette évolution. Ne s'agit pas de position idéologique inébranlable, si l'on suit de près les itinéraires des deux complices, l'on voit que leurs intérêts ne cessent de se croiser, l'un se dirigeant vers la source sombre quand l'autre s'en vient s'abreuver à la pâlichonne, et vice-versa. Le dernier tiers de la revue qui se penche sur l'après Led Zeppelin de chacun des deux principaux protagonistes du Zeppe aide à une telle lecture.

Les réticences de Page et Plant devant l'émergence du punk sont éloquentes. Ne peuvent pas être contre, mais ne sont pas pour. Le punk est une solution trop simple. Certes, il a ringardisé leur image de super-groupe, ne sont plus à la une de l'avenir du rock, la mode a changé, le vent a tourné, mais leur condamnation est aussi le signe de leurs propres interrogations quant à la poursuite de l'évolution du rock. Led Zeppelin a épuisé une forme. L'a mené le riff à son accomplissement terminal. Ont épuisé le style. Ont développé toutes les possibilités formelles et esthétisantes de cette manière d'appréhender le rock'n'roll. Et après ?

Plant s'essaie à toutes les fusions ethniques. Page se replie sur le groupe. Elabore et échantillonne avec un soin scrupuleux les rééditions, une manière pour lui de préserver l'héritage et peut-être aussi de conférer un sens à sa vie et une intensité existentielle similaire à celle ressentie lors de la carrière du groupe. J'émettrais l'hypothèse que dans ses tiroirs doit traîner des bandes d'espèces de suites symphoniques guitaristiques des plus novatrices que pour de mystérieuses raisons il garde par-devers lui. L'est capable de les emmener avec lui lorsque viendra son heure de grimper les marches du staiway to heaven.
Damie Chad.
REBELLION
LA RESISTANCES DES GENS ORDINAIRES
ERIC HOBSBAWM
( Editions Aden )
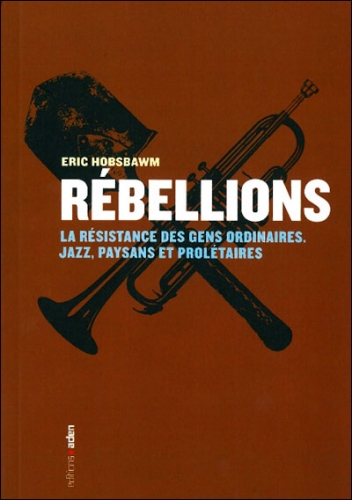
Un gros livre. Cinq cent trente pages auxquelles viennent s'ajouter une trentaine de notes. L'ensemble se présente comme une suite de vingt-six articles dans leur très grande majorité déjà publiés, dans des journaux américains ou britanniques, ce qui n'est en rien d'extraordinaire puisque l'auteur, décédé en 2012, résidait en Grande-Bretagne. Marxiste convaincu, membre du Parti Communiste, il fut un écrivain engagé qui s'intéressa à l'histoire du mouvement ouvrier. Fut de toujours attiré par les marginaux, les outlaws, les déclassés, les pauvres. Sujets passionnants mais qui ne recoupent que partiellement le champ principal d'exploration kr'ntique. A part que dans ce volume pas moins de sept chapitres sont dévolus à des figures charismatiques de l'histoire du jazz ou à l'analyse de la réception de cette musique. Eric Hobsbawm n'est pas un musicologue mais ses réflexions sur le jazz envisagé sous un angle d'attaque original valent le détour. Cerise rouge sur le gâteau, nous sommes parfois en pays de connaissance puisque la France n'est pas absente de ces études.
SIDNEY BECHET

Décapant. A quoi tient la gloire et à la célébrité ? Peut-être pas à pas grand-chose mais sûrement à un jeu de circonstances dont les bénéficiaires ne sont pas spécialement les promoteurs. Nous présente Bechet comme un personnage antipathique au possible. Rejeté d'Angleterre pour une sombre histoire de viol, mêlé à un règlement de compte avec armes à feu à Paris, doué d'une personnalité peu amène, égocentrique, radin, têtu et peu généreux. Oui mais un sacré musicien, rétorquerez vous ! Oui, un peu. Non, beaucoup. Il est indéniable que tout jeune sa virtuosité instrumentale éblouit. Armstrong et Ellington en furent témoins et nous faisons confiance à leurs jugements. Très vite Sidney quitte l'Amérique, voyage en Europe et pénètre en Russie dans les premiers temps de la Révolution. En profite pour courir les concerts de musique classique. Ce qui laisse entrevoir une certaine ouverture d'esprit. Lorsqu'il rentre aux States, n'a en rien perdu sa virtuosité, par contre en dix années le jazz a évolué. L'on se dirige vers les grandes formations savantes, les petits groupes au coin des rues ou dans les bars miteux, c'est de l'histoire ancienne. A tel point que ne trouvant pas de boulot – son sale caractère décourageant les rares admirateurs qui apprécient son jeu – il abandonne la musique pour successivement ouvrir une friperie et un garage. Mauvais gestionnaire il revient au jazz par la force des choses. Foutu, fini, radié des listes. Plus personne ne pense à lui. N'y a pas un nègre prêt à miser un dollar sur lui. Normalement l'histoire devrait s'arrêter là. Ne devraient rester que le souvenir de la demi-douzaine de faces enregistrées au tout début. Mais aux States, au dernier moment, vous avez le Septième de cavalerie qui vient vous sauver des indiens. Pas un cheval à l'horizon, mais beaucoup mieux que cela, la mauvaise conscience des intellos blancs. Ceux du cru ( qui souvent tournent autour du Parti Communiste ) et Européens, notamment, cocorico ! les français dont Hugues Panassié reste la figure emblématique... Problème pour nos intellectuels qui se convertissent au jazz davantage en tant qu'idéologues qu'en amateurs éclairés. Sont horrifiés, les grands orchestres de jazz sont en vogue, gagnent de l'argent, commencent à être connus en Europe, ces satanés noirs sont en train de s'embourgeoiser, de devenir des Oncles Tom. De quoi désespérer des pauvres qui ne pensent qu'à s'enrichir ! C'est dans leurs têtes que s'élaborent le mythe du jazz perdu, qui aurait conservé sa pureté initiale, mais où le trouver ? La réponse ne tarde pas à émerger, ni à New York, ni à Boston, ni à Philadelphie, ni à Chicago, tout simplement à l'endroit où il est né. A la New Orleans ! On se met à courir les bouges où remuent les derniers hasbeen, tout ceux qui ont conservé des relents old style sont les bienvenus. Ne sont pas de merveilleux musiciens, mais Sidney se fait connaître. Il sauve la mise de ce jazz New Orleans ossifié qui se répand comme la sclérose en plaque, aux Etats-Unis, en Europe et si bien en France qu'il ne tarde pas à s'y installer et à y jouir d'une notoriété et d'une ferveur qui ne se démentiront jamais. Un merveilleux musicien mais pas un créateur... L'article pourrait s'arrêter là mais Eric Hobsbawm ne résiste pas à une dernière méchanceté idéologique, les racines créoles de Sidney en font l'un des descendants de cette bourgeoisie semi-blanche qui s'est un temps formée dans la ville des bayous... L'on n'échappe pas à son destin de classe, on porte en soi le sang de la trahison. Expression inconsciente d'une espèce de racisme biologique à rebours qu'il ne cesse de condamner dans son article ! N'empêche que l'analyse donne à réfléchir et dénoue bien des contradictions.
COUNT BASIE

Le ton change du tout au tout avec Count Basie. Un homme modeste à qui le hasard de la chance sourit. Un petit pianiste noir du New Jersey, agile de ses mains mais pas un grand musicien, qui se retrouve en carafe un jour de déveine à Kansas City. Court les boîtes, les bars et les filles. N'en demande pas plus. Mais l'est tombé dans la bonne ruche. En pleine récession il est tombé dans l'oasis. Ne mythifions pas, gagne juste tous les soirs – l'on travaille au chapeau – ce qui lui permet de survivre jusqu'au lendemain midi. Un détail qui ne trompe pas, au début de la ''célébrité'' de son ''grand'' orchestre il porte encore sans fausse honte des pantalons rapiécés. Ne soyons pas idéaliste, émerveillons-nous plutôt sur cet étrange fait que de Kansas naquirent et la populaire musique de danse et l'aventurisme musical novateur de Charlie Parker... Count sera à l'origine du premier filon. N'est pas le premier musicien de son band, donne le rythme sur son piano et sait avec un extraordinaire instinct introduire chacun de ses musiciens au moment opportun, le laisser s'exprimer et lui signifier d'arrêter juste avant qu'il ne commence à se répéter. Ne sait pas lire la musique, n'a que des bouts d'idées novatrices, mais autour de lui tout le monde, ses propres musiciens mais aussi des personnalités des formations voisines, s'empresse pour les conforter et les mettre au point. Des musiciens solidaires, et cette union se ressent dans les parties communes lorsque l'orchestre en son entier reprend un riff et lui donne un allant extraordinaire qui bouleverse et emporte le public. C'est ce dernier issu des ghettos qui imposa un répertoire imbibé des patterns blues, qu'à son arrivée à Kansas Count Basie maîtrisait mal... Deuxième as de cœur dans son jeu, c'est John Hammond qui en 1935 l'entendit dans sa voiture à la radio et qui subjugué par le jeu de son orchestre lui permit d'accéder à une audience nationale. Count Basie permit à des pointures comme Lester Young et Jimmy Rushing – un des plus grands blues shouters – d'atteindre un même niveau de célébrité.
DU BLANC AU NOIR

Nous sommes dans les grands orchestres. De jazz noir. Toutefois une constatation s'impose, ce sont les blancs qui ont eu l'idée de ce genre de formation. C'est à San Francisco que Art G. Hickman élargit aux alentours de 1915 son sextet en rajoutant une grosse section de cuivres qui le transforma en l'un des tout premiers Big Bands de jazz, puisque spécialisé dans les musiques populaires de danse et empruntant pour cela pas mal d'éléments aux musiques noires. Paul Whiteman, qui avec Ferde Grofé, travailla à l'orchestration de Rhapsodie in Blue de Gershwin, s'essaya avec son orchestre au jazz symphonique ce qui lui apporta notoriété et reconnaissance de la part de musiciens noirs comme Miles Davis. Pour sa part Ferde Grofé reste connu dans l'histoire de la musique classique américaine pour avoir composé des suites symphoniques comme Niagara Falls, Mississippi, Grand Canyon... Cette rencontre entre sourciers noirs et défricheurs blancs éclaire l'intérêt qu'artistes d'avant-garde et musiciens classiques européens comme Cocteau et Stravinsky portèrent dès les années 20 au jazz.
THE DUKE

Cet état de fait entrevu en son aspect généalogique explique les prétentions de Duke Ellington à se définir en tant que compositeur et pas en simple chef d'orchestre. Eric Hobsbawm insiste sur sa situation de fils de bonne bourgeoisie noire, le décrit comme un enfant gâté, dilettante paresseux en son oisive jeunesse, qui la trentaine advenue décida d'embrasser une carrière de musicien qui lui semblait peu accaparatrice. Nous trace un profil psychologique similaire à celui de Sidney Bechet, directif, sec, dépourvu de tact tant avec les femmes qu'avec les hommes, vindicatifs et égoïste. En contre partie il exerce un fort attrait sur tous ceux qui le croisent où sont amenés à le côtoyer tant sur le plan professionnel qu'humain. Emprunta beaucoup quant à la direction d'orchestre à Fletcher Henderson un des pionniers du big band noir et à Paul Whiteman dont les partitions symphoniques le confortaient dans l'idée que lui, the Ducke, n'était pas spécialement un musicien de jazz mais un grand musicien tout court, à inscrire dans la lignée des Beethoven... Le problème c'est que question composition c'était à chaque musicien de développer ses propres improvisations sur les simples quatre premières mesures indiquées au piano par le Maître... Savait presser le citron de ses solistes et des ses pupitres, en extrayait le jus le meilleur, les poussait jusqu'aux limites des dissonances les plus aventureuses, qui n'étaient pas sans évoquer les avancées de la musique sérieuse européenne. S'arrangeait aussi pour que les créations de ses solistes ne s'écartent point trop de la coloration de son thème initial... Reste à ne pas oublier après ce réquisitoire implacable que le grand chef est-ce celui qui fait tout tout seul, ou celui qui est capable de déléguer à ses subordonnés ! Dans ce second cas, le mythe du créateur solitaire, de l'Artiste avec un grand A majuscule souligné au feutre rouge, en prend tout de même un sacré coup... Dans les dernières pages de son article Eric Hobsbawm effectue un rétropédalage notoire, en les conditions sociales, temporelles, et économiques de sa création – Ellington n'est tout compte fait que le patron d'un big band dont le premier objectif est de ne pas ennuyer son public – il n'a pu, et même n'aurait pu, faire mieux. Le Duke, dont il s'avoue un grand admirateur, a réalisé une oeuvre populaire et collective – en tant que communiste, on le devine sensible à cet aspect – de grande qualité artistique et de forte densité culturelle.
LE JAZZ ARRIVE EN EUROPE

Contrairement à ce qui viendrait à l'esprit de prime abord ce n'est ni la radio ni l'invention du disque qui facilitèrent l'arrivée du jazz en Europe mais les transatlantiques qui permirent de traverser l'océan en quelques jours. La revue musicale The Origine of the Cakewalk est visible la même année à New York et à Londres, en 1898 ! Le fox-trot arrive en Belgique en 1915 ! En 1917 des formations de jazz prennent pied sur le territoire européen. Qu'une musique populaire noire se soit infiltrée jusque dans les couches bourgeoises et intellectuelles de la société reste étonnante. A part Toulouse-Lautrec et ses représentations de danseuses du French-Cancan – musique née aux alentours de 1830 en tant qu'opposition, crypto-païenne et anti-chrétienne affirmée, à la morale officielle ré-instituée par la réaction blanche de la Restauration royaliste de 1815 – les sociétés européennes tempérées n'étaient point habituées à un tel phénomène. Il y eut des signes précurseurs, la danse de salon codifiée perdit dès la fin du dix-neuvième siècle les rigueurs de ses codifications, signe que sa pratique rituelle en tant que convention d'accès au monde aristocratique était en déclin. La fin de la grande guerre enregistra cette émergence proto-démocratique. Dès 1927, le jazz avait à Paris pignon sur rue, prôné par de larges couches de la jeunesse et de minorités intellectuelles. Le blues bénéficia aussi, surtout en Angleterre, d'un tel accueil. L'éclosion du rock'n'roll en ce pays lui en est en partie grandement redevable. De l'accueil de l'Original Dixieland Jazz Band à l'apparition des Rolling Stones au tout début des années soixante, le fil pour être invisible n'en est pas moins présent et solide. Le Melody Maker – qui fut un organe important de diffusion de la culture rocck – était dès l'année de sa création en 1926 acquis au jazz. En ces mêmes années, l'auteur estime que les amateurs de jazz ne dépassaient pas cent mille individus. Ce que l'on appelle les minorités actives. Ironie des choses le trad-jazz d'Angleterre permit par sa permanence l'éclosion du rock qui raya le jazz de la carte du monde. Cette dernière expression est bien de Hobsbawm.
LE SWING DU PEUPLE

Chapitre peu musical centré sur la personnalité de John Hammond. Fils de la grande bourgeoisie blanche américaine farouchement convaincu de l'égalité des races qui par son entremise permit à de nombreux artistes noirs – Ella Fitzgerald par exemple – d'atteindre à une notoriété nationale et internationale. Mais l'on força quelque peu la main du public. La mise en œuvre du New Deala resserra les liens entre les jeunes, les noirs, les communistes, les étudiants d'extrême-gauche et les milieux folk. Les Big Bands et leur corollaire le swing furent systématiquement mis sur le devant de la scène. Le swing devint la danse populaire par excellence. Même si toute une majorité silencieuse du public aurait préféré entendre de la chanson sentimentale... Après la guerre – le fait est totalement avéré dès 1948 – les big bands sont au chômage, le public se tourne vers la country music ou la variété. Franck Sinatra est l'exemple parfait de cette nouvelle donne, il passe des grandes formations jazz à l'enregistrement de belles mélopées amoureuses. C'est le commencement de la fin pour le jazz, les big bands sans public débauchent, et les musiciens de Be Bop trop convaincus de jouer une musique élitiste entament une démarche qui mènera vingt ans plus tard sur les sentiers d'une musique savante et ennuyeuse dans laquelle la jeunesse ne se reconnaît pas. John Hammond finira sa carrière de producteur en ouvrant les portes à Bob Dylan... qui cinq ans plus tard électrifiera sa musique. Page définitivement tournée.
LE JAZZ DEPUIS 1960

Jusqu'aux début des années 90. Constat sans appel, dès 1963, le rock'n'roll domine le monde musical. Les Beatles sont cités, mais en tant qu'intellectuel de haut niveau, notre auteur fait total impasse sur la première génération des rockers. Lâche du bout des lèvres Bill Haley, Chuck Berry et Elvis mais il n'est manifestement pas inscrit dans la société des Sunophiles ! Le jazz ne représente plus que 1,3 % des ventes de disques. Un peu de sa faute, la façon dont les amateurs de jazz ont insulté le rock'n'roll ( voir le méprisable exemple de Boris Vian par chez nous ) n'était pas une bonne stratégie de coexistence pacifique, les avancées du Free Jazz et de la New Thing dans l'atonalité ont découragé les auditeurs, les prises politiques souvent extrémistes de ses leaders n'a guère aidé à leurs diffusions sur les ondes institutionnelles, mais plus grave, les innovations technologiques, enregistrements et amplifications sont l'œuvre du rock'n'roll et non des jazzmen... Hobsmawm se console, une petite renaissance autour des années 80 lui donne quelque espoir, mais il reconnaît que cela ne va pas bien loin, beaucoup de musiciens qui se la jouent au lieu de jouer, un bon marché de réédition, et cette constatation de la jeunesse noire détachée du blues, qui s'adonne au rap... Un seul espoir, le jazz est une musique qui a connu tellement de mutations que peut-être bientôt, incessamment sous peu, Anne ma sœur Anne ne vois-tu rien venir ?...
BILLIE HOLLIDAY

Courte notice nécrologique rédigée en 1959 à la mort de Billie Holyday. Un récapitulatif des plus réalistes de la vie de celle qu'il considère comme une artiste suprême. Le plus bel hommage se trouve dans les quelques lignes d'introduction de l'article. Il vient de John Hammond sur son lit de mort, vieil ami de l'auteur qui lui demande – il n'est jamais trop tard pour bien faire – le nom du chanteur ou du musicien qui, parmi tous ceux qu'il a lancés vers la gloire, lui est le plus cher. La réponse ne se fait pas attendre. Billie Holliday !
Choix des plus émérites et judicieux !
Damie Chad.