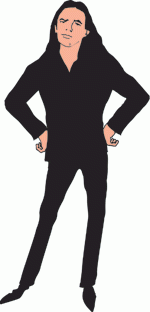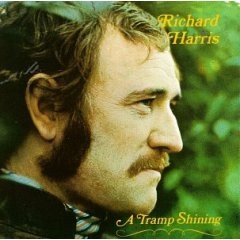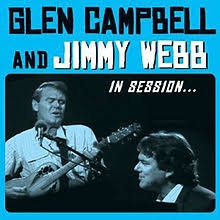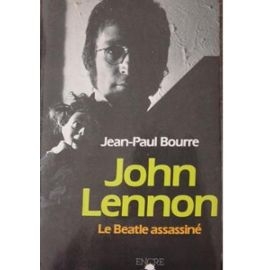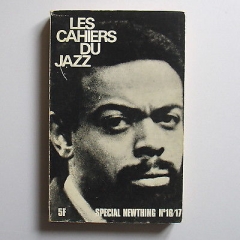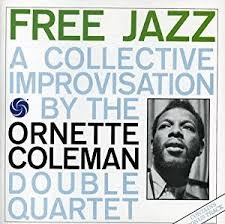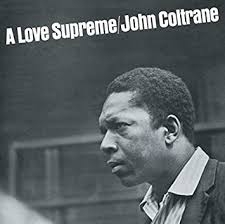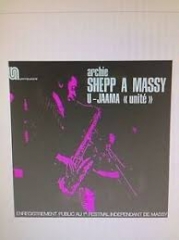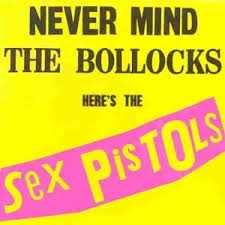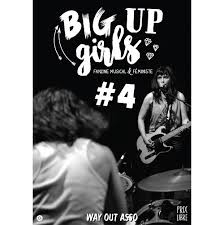KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 401
A ROCKLIT PRODUCTIOn
10 / 01 / 2019
|
MICK RONSON / HAPPY ACCIDENTS / THETRUEFAITH KURT BAKER COMBO / FULL PATCH / ERIC CLAPTON / IGNEUS |
Ronson toujours deux fois - Part One
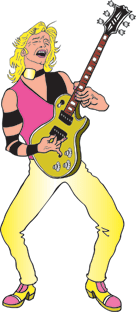
En 2009, Weird and Gilli (Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly) proposaient une bio de Mick Ronson intitulée The Spider With Platinum Hair. Cet ouvrage manque cruellement de teneur. Dommage. Les auteurs ont un petit côté oies blanches qui dérange. Ils s’attardent par exemple trop longuement sur l’épisode du concert mémorial organisé après la disparition de Ronno, en 1993.

Weird and Gilli parviennent toutefois à mettre l’accent sur le caractère bien trempé de Ronno. Il s’agit en effet d’un chti gars du Nord, élevé à l’ancienne par un père rigide. Quand pour des raisons médiatico-stratégiques, Bowie lui demande de déclarer à la presse qu’il est gay, Ronno l’envoie sur les roses : «No fuckin’ way’ !» Et quand Bowie lui demande de porter le costume doré, Ronno fait sa valise et file à la gare pour rentrer chez lui. Bowie envoie Woody Woodmansey le récupérer. Ronno est indispensable. Pas de Ronno, pas de Ziggy. Mick Rock : «Without Ronno, Ziggy would never have braved the heat of the attention he inspired.» Bien sûr, Ronno finit par porter le costume doré. En 1975, il revenait dans Circus sur l’image bisexuelle de Bowie : «J’ai pris ça au sérieux, car il ne plaisantait pas. Je n’ai pas aimé ça au début, mais on finit par s’habituer à tout. Des tas de gens autour de nous sont bisexuels et on finit par trouver ça normal. Mais au début, j’étais choqué. Je me demandais ce que les gens allaient dire !»
Autre point capital : Ronno est fan de Jeff Beck. Chrissie Hynde surenchérit, et elle a raison. Non seulement elle trouve que Ronno est l’un des mecs les plus distingués qu’elle ait rencontré, mais il était aussi capable de jouer comme le meilleur de tous, Jeff Beck : «Mick was one of the nicest men I’ve ever met. Certainly one of the best-looking and one of the great guitar players. It was a pretty devastating combination (...) Mick was the only player that I think could actually sound like Jeff Beck who was also unrivalled technically, stylistically and everything.» Alors, si ça n’est pas un hommage suprême, qu’est-ce donc ?

Ronno adorait tout particulièrement l’album Truth du Jeff Beck Group. Il en apprit tous les guitar licks, sauf un, celui de Beck’s Boogie, qu’il n’arrivait pas à reproduire et ça l’énervait. En 1968, Ronno coinça Jeff Beck au Cat Ballou à Grantham et lui demanda de lui montrer le riff d’intro. Et Ronno apprit le riff.
Dans les dernières pages du livre de Weird and Gilli sont rassemblés des extraits d’interviews de Ronno (Mick Ronson in his own words). C’est classé par thèmes. À la rubrique «Mick’s Spiders From Mars equipment», Ronno donne tout le détail et indique de quelle façon il travaille : «Le conseil que je peux donner à ceux qui veulent jouer de la lead guitar, c’est de faire comme je fis à mes débuts : écouter soigneusement ses guitaristes préférés, aussi bien sur scène que sur les disques. J’allais voir jouer Jefff Beck, Jimi Hendrix, Keith Richards et George Harrsion et je regardais où ils mettaient leurs doigts et comment ils obtenaient leur son. Je rentrais à la maison et m’entraînais jusqu’à ce que j’obtienne le même résultat.»
Le nom de Ronno reste à jamais lié à celui de Ziggy. Ils firent ensemble six albums qui figurent parmi la crème de la crème du gratin dauphinois d’Angleterre. À part les Stones, les Kinks et les Pretties, on ne voit personne qui ait su proposer une suite d’albums aussi magistraux : The Man Who Sold The World, Hunky Dory, The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars, Aladdin Sane et Pin Ups. Tout ça en deux ans, de 1972 à 1973 ! Non seulement ces disques ne prennent pas une ride, mais ils restent d’une brûlante actualité. Ziggy régnera à jamais sur l’empire du glam.

The Man Who Sold The World fit un flop. Tony Visconti : «It was just too early. It was just two freaky.» Il se peut que la photo de pochette (Bowie en robe se prélassant dans un sofa) ait choqué les gens. Et pourtant, quel album ! Et quel son ! Ronno donne le ton dès «The Width Of A Circle», il riffe du gras à la grosse cocote et bâtit l’archétype du glam britannique. Tony Visconti fait ronfler sa basse. Lui et Ronno jouent en solo, chacun dans son coin, c’est d’une brûlante actualité déliquescente et complètement ravagé par les contreforts. Nous voilà plongés dans le mythe Bowie : puissance et beauté, luxe, calme et volupté, grandeur et décadence. Ronno recharge sans répit. Avec «All The Madmen», on reste dans la heavyness mirifique - Don’t set me free/ I’m heavy as I can be - et il revient toujours caus’ I’d rather stay with all the madmen, Ronno enveloppe tout ceci d’un son divin, zane zane zane, ouvre le chien. «Black Country Rock» s’inscrit dans la même lignée. Ronno invente un son qui n’existait pas, le glam-rock, il y met du souffle et une attitude de Jack the Lad. En B, «Saviour Machine» nous fait entrer dans l’extrême tension bénéfique, un monde chargé de tout le psychodrame shakespearien de la vieille Angleterre. Bowie semble laisser filer ses vers au fil des siècles et Ronno aménage quelques descentes vertigineuses. Nouveau chef-d’œuvre avec «She Shook Me Cold» - Mother she blew my brain - Et Ronno revient à contre-courant du drive de basse. Pure démence de la latence !
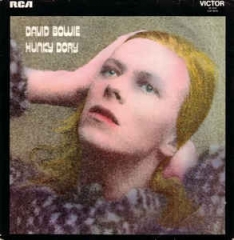
The Mayor of the Sunset Strip Rodney Bingenheimer assistait aux sessions d’enregistrement d’Hunky Dory, l’un des grands albums classiques du rock anglais. Il flasha sur Ronno et lui conseilla d’aller aux États-Unis - I kept telling him he should come to America and he should be a star. He laughed and said ‘oh yeah sure !’ - Rodney avait en effet de quoi flasher, car il faut entendre Ronno jouer de l’acou royale sur «Andy Warhol». Il y déploie une somptueuse espagnolade galvanique. Les hits pullulent sur cet album magique, à commencer par «Life On Mars». C’est là que s’étend l’empire du glam spatial, un glam lumineux et infini. Avec ça, Bowie invente un monde et Ronno entre dans la danse avec une élégance à peine concevable. C’est aussi beau et pur que «Strawberry Fields Forever» ou «Waterloo Sunset». Bowie s’y élève dans les airs. «Changes» reste l’une des plus belles pop-songs de l’histoire du rock et avec «Oh You Pretty Thing», Bowie donne au glam ses lettres de noblesse. «Kooks» et «Quicksand» figurent aussi parmi les grands classiques de la pop anglaise, dans ce qu’elle peut présenter de plus subtil et suave, toxique et éternel. Ronno entre dans le lard de «Queen Bitch» à sa façon, en claquant des beignets d’allers et retours. Il fait un travail d’orfèvre avec du petit solotage en sous-main. Bowie avait alors le son, et donc le pouvoir de régner sans partage. Il termine cet album historique avec «The Bewlay Brothers», une ode au néant qui luit comme un fanal dans la brume. Pour l’éternité.

Et là, Bowie et Ronno accèdent à la gloire. C’est le Rise de Ziggy et la parution du troisième album classique, The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. Tout est bon sur cet album, rien à jeter. Si on n’écoute que Ronno, on se substante largement. C’est fou ce qu’il joue juste dans «Soul Love». Il se montre persuasif dans le ton et virulent dans l’insistance. C’est dans «Moonage Daydream» que Bowie se dit alligator et c’est aussi là que Ronno prend l’un de ses solos les plus spectaculaires. «Starman» et «It Ain’t Easy» restent des hits imparables. Ronno revient riffer «Hang On To Yourself» et on le voit partir en balade sur la bassline de Trev. Dans «Ziggy Stardust», on assiste aux épousailles du gras double de Ronno. Et s’il est une cocote qui compte sur cette terre, c’est bien celle de Ronno dans «Suffragette City» - Hey man/ She’s a total blam blam !

Rien ne pouvait plus arrêter les Spiders et Ziggy. Bowie composa les chansons d’Aladdin Sane pendant la première tournée américaine. Il subissait alors une pression terrifiante et pour tenir, il n’eut qu’une solution, la coke. Cet album est certainement le sacre du tandem Bowie/Ronno, car ça grouille de hits et de son. Ronno sort le grand jeu dès «Watch That Man», superbe slab de glam d’époque. Ronno y joue un solo en apesanteur. Bowie et Ronno étaient alors les rois du rock anglais, et donc les rois du monde. C’est Mike Garson qui fait le show dans le morceau titre, il y pianote des chopinades dignes de Debussy, des contre-temps charmants et délicats, des rivières de perles de lumière, oooh who’ll love a lad insane - On a tous vénéré cette chute à l’époque. Ronno ramène sa grosse cocote pour «Panic In Detroit». Il y donne le meilleur de lui-même, du bon gras de Les Paul. Il joue ses phrasés de biais, il est l’archange du saindoux sonique. En B, il ramène du glam joyeux dans «The Prettiest Star». Avec cet cut charmant, Bowie et Ronno sont au pinacle de l’âge d’or, dans un genre qu’ils sont inventé. Ronno ne semble vivre que pour un absolu de pureté. Ils font une belle cover de «Let’s Spend The Night Together» et Ronno emmène «The Jean Genie» au paradis - New York a gogo and everything tastes nice.

Fin de l’aventure avec Pin Ups. Cet album de reprises est enregistré au Château d’Hérouville, sans Woods qui vient de se faire virer comme un chien par Defries. Pour Ronno, c’est l’occasion de se frotter à ses idoles, comme par exemple les Yardbirds et «Wish You Well». Joli choix aussi que «See Emily Play», et même idéal pour un magicien de la pop comme Bowie. Ils en font une version encore plus psychédélique, comme si c’était possible. Ils tapent «I Can’t Explain» à la heavyness et Ronno s’en donne à cœur joie, car on l’a vu, c’est un spécialiste. On ne le savait pas, mais «Friday On My Mind» sonne comme un cut de glam pur. La pop suprême des Easybeats se fond dans l’excellence du glam de Ziggy. Et Ronno se jette à corps perdu dans l’aventure. Il tire aussi de jolies notes dans la version de «Don’t Bring Me Down» et Bowie devient héroïque dans «Shapes Of Things». On voit Ziggy renouer avec la baravado des Who dans «Anyway Anywhere Anywho» et Ronno écrase bien ses power-chords dans «Where Have All The Good Times Gone». Il y ramène tout le gras-double du monde. Quel fabuleux cocoteur ! Derrière Bowie, il fait des miracles.

Même si on connaît par chœur chacun de ces cinq albums et qu’on croit avoir fait le tour du phénomène, il est impossible de faire l’impasse sur le fameux Live Santa Monica ‘72 paru en 2008. Il s’agit là d’une sorte de preuve par neuf du génie des Spiders. Et dès «Hang On To Yourself», Ronno est dessus ! Il mouline sa moutarde et démultiplie les petites vrilles à l’infini. Trevor Bolder fait des ravages sur sa basse. Force est d’admettre qu’il fait tout le boulot ! Attention, non seulement ce live est un best of, mais le son vaut celui des meilleurs albums live de l’histoire du rock. Ronno y sculpte son son dans le dos de Bowie, mais Bolder sculpte aussi, il joue en mélodie et boufferait presque Ronno tout cru, un Ronno qui claque des accords de cristal et qui les égrène à Grenelle. On se demande ce que les Californiens pouvaient comprendre au glam. Oui, car le glam de Ziggy est si pur qu’il semble incongru sous le soleil de Californie. Mais Ziggy fonce et attaque «Changes», un pur hit de la légende des siècles. Il chante comme un dieu, ça on le savait, mais l’I’m much too fast to take that taste sonne si bien sur scène ! Et Bowie plonge la Californie dans une sorte de fascination. Peu de performers pouvaient prétendre à une telle aura. Ronno taille «Life On Mars» sur mesure. Il faut l’entendre profiler le filet. Et Bowie chante «Five Years» à l’excès de génie. Il faut bien dire que sur ce coup-là, Ronno n’a que très peu de valeur ajoutée. On entre ensuite dans un «Space Oddity» sacrement ambiancier et gratté à coups d’acou. Bowie appelle Grand Control et il n’y a plus rien à ajouter : Bowie crée son monde et se dirige vers le néant. Fantastique artiste ! Coup de chapeau à Warhol avec l’«Andy Warhol» tiré d’Hunky Dory et back to the heavyness avec «The Width Of A Circle», au cœur de l’empire de Ronno qui nous fout aussi sec le souk dans la médina : il part en vrille de gras double et a semble-t-il un mal fou à se calmer pour attaquer «Queen Bitch» qu’il riffe à la Lou Reed et pouf, il repart dans un nouveau numéro de cirque. Avec «Moonage Daydream», on entre dans le glam céleste et ça continue dans l’irréalité des choses avec «John I’m Only Dancing», Ronno gratte ses dernières notes au bord d’un précipice, tout sur ce disque pue la démesure. Ils s’embarquent dans une version dévastatrice de «Waiting For The Man» - And that’s Mick Ronson on the guitaaahh - Fabuleuse version, Ronno la joue au clair de la lune et ça embraye sur l’apothéose de «The Jean Genie», rock’n’roll Ronno blaste sa petite affaire - New York a gogo hoo hoo - Fantastique et mortelle randonnée et ça monte encore d’un cran comme on peut l’imaginer avec «Suffagette City», Hey man, oui, oui, avec Ronno qui riffe et qui raffe comme un démon, Wahm bam thank you man, Ronno fait gicler toute sa purée, you can’t afford a ticket, no no. On donne sa langue au chat. Et ça se termine comme ça doit se terminer, par une version mirobolante de «Rock’n’Roll Suicide». Fin d’une époque magique. Tous ceux qui ont vécu ça en direct ne s’en sont jamais remis.
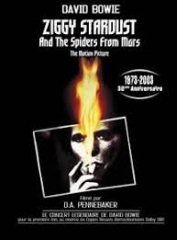
C’est la raison pour laquelle il faut voir le film de DA Pennebaker, Ziggy Stardust And The Spiders From Mars : on y assiste en direct au dernier concert de Ziggy, filmé le 3 juillet 1973 à l’Hammersmith Odeon. Pennebaker filme Bowie dans la loge et il réussit l’exploit d’en faire un monstre. Il le cadre serré et le vaste regard glaçant de Bowie fout un peu la trouille. Mais sur scène, c’est une autre histoire. Ronno attaque «Hang On To Yourself» au riffing sur sa Les Paul en or. Il est ce soir là le roi du rock et il le sait. Ziggy revient en kimono pour chanter Ziggy played guitar/ With Weird and Gilli et il exhibe ses très belles cuisses, aw yeahh ! Puis Ronno joue la loco dans «Watch That Man». Dans la fosse, les kids deviennent dingues ! Mais le pire est encore à venir. Ronno se tape une fantastique échappée belle dans «Moonage Daydream», et après un changement de costume, Ziggy revient chanter l’énorme «Changes». Il gratte sa douze, il faut le voir swinguer son mid-tempo, c’est là qu’on réalise à quel point ce mec est une star. Il n’est que grâce et élégance suprêmes, mais cela, tout le monde le sait. Il enchaîne avec le grand control de Major Tom, le croon du néant et les gamines pleurent dans la fosse. L’émotion est à son comble. Ils tapent aussi une fantastique version de «Cracked Actor», mais Bowie est faux à l’harmo. Ronno tente de cacher la misère et ils embrayent sur un autre monster hit, «The Width Of A Circle». Trev joue aussi en solo. Pour Ronno, c’est la quart d’heure de vérité. Dommage qu’il fasse autant de grimaces. Et elles ne sont pas belles. Trev joue comme un diable dans les strobes et ce bon Woods shuffle ses cymbales. Puis ils enchaînent des stormers, à commencer par un version up-tempo de «Let’s Spend Together» («This is for Mick», grommelle Ziggy), et avec Suffragette, ils rockent littéralement le monde. Au micro, Ronno fait d’admirables chœurs d’Hull - Hey maaaaan - et c’est la fin du set. Pour le rappel, Ziggy passe un haut transparent noir et claque un coup de «WhiteLight/White Heat». On sait comment ça se termine : le suicide de Ziggy et «Rock’n’Roll Suicide». Just perfect.

On note aussi qu’en 1973, Bowie et Ronno sont allés jouer deux cuts sur l’excellent album de Dana Gillespie, Weren’t Born A Man : une reprise d’«Andy Warhol» et «Mother Don’t Be Frightened». On entend Ronno rôder dans cette merveille qu’est «Andy Wharhol Superstar», il joue en sous-main, à la soudoyarde. Terrific ! Sur Mother, il change de son devient plus ambiancier, et même trop moyenâgeux - But there’s nothing you can do - On profite de la parenthèse pour conseiller l’écoute de cet album. D’autant qu’elle démarre sur une cover extrêmement intéressante de Third World War, «Stardom Road Parts I & II». Elle fait le Part One en mode gothique, c’est assez fascinant, d’une féminité profonde et sombre, puis elle tape le Part Two en mode no highway code on stardom road, et là, on est content d’avoir croisé son chemin. Avec «Dizzy Heights», elle propose une jolie pièce de rockalama. Elle se rapproche du son de Delaney & Bonnie, un son fouillé bardé de chœurs de folles, c’est admirable. On retrouve ce son en B dans «All Cut Up On You». Wow ! On se croirait à Muscle Shoals. Elle chante du haut de son registre avec une autorité qui fait foi. Tenue impeccable et très haut niveau productiviste. Elle va même groover «Weren’t Born A Man» à la Bobbie Gentry. C’est saxé de frais et ambiancier à souhait.

Dans l’article qu’il écrit pour Classic Rock (The Rise And Fall Of Mick Ronson) Max Bell va dix mille fois plus loin que Weird And Gilli. Bell explique que les Spiders finissaient par ennuyer Bowie terriblement - Hurt my ears - mais avec le temps, il admet qu’avec Ronno, ils touchaient au but - As a rock duo, I thought we were as good as Mick and Keith - Bell rappelle aussi que Ronno était avant toute chose un homme galant et doux. Angie Bowie : «He was a sweet-talking Romeo (...) he was handsome and so divine.» Il était toujours le premier à offrir un verre à une dame.

Le fan de Ronno devrait aller aussi mettre le nez dans Bowie At The Beeb, car on y entend ses tout premiers pas dans le monde du rock. En 1968, ce sont des gens comme John McLaughin et Herbie Flowers qui accompagnent un Bowie prometteur. Le jeune Dave adorait les guitares opiniâtres et le pathos d’«Amsterdam». Bowie joue relentless, il gratte son acou à l’infini. Ronno joue pour la toute première fois sur «The Width Of A Circle». Il entre dans la danse à sa manière, louvoyante et vénéneuse. Tony Visconti bat le nave sur la basse. Tout est très joué. On est à Londres en 1968 et ces mecs ne plaisantent pas. Dans l’ouvrage de Weird and Gilli, Mick déclare qu’il rencontra Bowie pour la première fois dans le studio et qu’il ne connaissait pas les morceaux : «I just sat and watched David’s fingers. I didn’t know what I was doing but I suppose it came across well.» Dans Bowie At The Beeb, on entend aussi une session de The Hype, ce super-groupe qui fit un bide. Bowie cherchait alors à percer. Il chantait déjà comme un dieu ce «Wild Eyed Boy From Freecloud». Pour «Bombers», Peely introduit la bite de Dave dans la cuisse de Jupiter. Ronno se fourvoie dans des salives. Ça fructifie et ça déborde de coulures. Ronno joue la carte du gras double sur «Looking For A Friend» et Trevor Bolder fait des miracles sur la reprise du «Almost Grown» de Chuck. Et puis évidemment, ça monte en puissance alors qu’on remonte dans le temps, car voilà les Spiders avec les hits classiques, Hang On, Ziggy Stardust, tout de suite les grands moyens, avec un Bolder devant dans le mix et un Ronno qui joue comme l’archange Gabriel. Ils deviennent des surdoués avec «Queen Bitch» et explosent une fois encore le pauvre «Waiting For The Man» qui ne demandait rien à personne. La version de «White Light White Heat» enregistrée pour la BBC sent bon les puissances des ténèbres. Ronno y suture des fréquences pendant que Bolder se promène dans la pampa. Ronno hante ce chef-d’œuvre comme une ombre. Ce ne sont plus que hits intemporels et virulences plénières. Bowie et ses Spiders deviennent trop gros pour la BBC. Il faut se souvenir qu’à l’époque, Bowie était aussi gros, en termes d’aura, de génie, de chiffre d’affaires et de popularité, qu’Elvis et les Beatles. Par son seul génie visionnaire, Bowie aura autant marqué l’Angleterre que les Beatles.
Pour la petite histoire, Trev et Woods tentèrent de redémarrer les Spiders avec le chanteur Pete McDonald et le guitariste Dave Black. Ils n’enregistrèrent qu’un album sur Pye en 1976. Ronno fit partie de l’aventure et enregistra des bricoles qui, comme beaucoup d’autres choses, sont restées inédites. L’album rouge des Spiders disparut sans laisser de traces. Les fans de glam n’y retrouvèrent pas leur compte, puisque les Spiders ne proposaient en tout et pour tout qu’un seul cut glam, le «Sad Eyes» d’ouverture de bal. On y entendait Dave Black faire de belles vrilles. Mais Pete McDonald emmenait le groupe dans une autre direction, celle d’une pop groovy, pas vilaine, certes, mais embarrassante, dès lors qu’on s’appelle les Spiders et qu’on sort d’une aventure faramineuse. On entendait par exemple en B un cut intitulé «(I Don’t Wanna Do No) Limbo» très pop et digne des grandes heures de Love Affair. «Stranger To My Door» sonnait comme de la pop trop sensible et en composant «Good Day America», Woods espérait revenir vers quelque chose de plus rock’n’roll. Avec son côté good time music enchantée, «Rainbow» avait une allure de cut sauveur d’album, d’autant que Woods le battait sec et doux. Mais bon, des disques comme celui-là, il en existe des millions.

On en rêvait, et Ronno le fit : l’album solo. Mais bizarrement Slaughter On 10th Avenue nous laissa sur notre faim. Ce n’est pas que l’album fut mauvais, non, mais il n’était pas au niveau de ceux qu’il avait enregistrés avec Bowie. La reprise de «Love Me Tender» n’accrochait pas. Difficile de moderniser un tel monument de kitsch. Il fallait attendre «Only After Dark» co-écrit avec Scott Richardson de SRC pour retrouver le grand Ronno, le plantureux riff-master. On avait là un hit glam ponctué à a cloche de bois et bardé de chœurs décadents, de ahh hah ahh énamourés, le pur glam de Hull, the hell of it all, la perfection, la suite de Ziggy, la magie du son anglais. Il reprenait aussi «I’m The One» d’Anette Peacock, mais le tarabiscotage provoquait une sorte de désenchantement. Et puis on allait de cut en cut, à travers la morne plaine, jusqu’au morceau titre, composé par Richard Rogers. Ce cut redorait le blason de Ronno. Il jouait en effet le thème mélodique au gras double de guitare. On avait là un cut profondément inspiré et puis, comme un gosse qui casse ses jouets, il partait à l’aventure et ruinait tout.
En travaillant avec Scott Richardson, Ronno eut l’idée de monter avec lui, Trevor et Aynsley Dunbar les Fallen Angels. Ils enregistrèrent des choses restées coincées dans les archives.
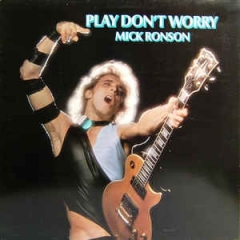
Paru l’année suivante, son deuxième album solo s’appelait Play Don’t Worry. On y trouvait une fastueuse reprise de «White Light/White Heat» amenée au piano jazz. Ronno s’y prenait pour Lou Reed. Il y allait de bon cœur. Il entrait dans le clan des cover-boys de bon aloi. Et pour l’occasion, il pulvérisait son jeu de guitare - Euh euh white heat ! - Le spectacle de ces Anglais qui essayent de sonner comme des Américains paraissait pour le moins grandiose. Ronno passait en prime un solo trash. Que pouvait-on dire du reste ? Ronno tentait de chanter comme Bowie sur «Billy Porter», une sorte de petit glam cocasse à la Cockney Rebel joué au pouet pouet de tuba. Mais Ronno n’est pas Bowie. Hélas. Il enchaînait avec un slowah ridicule intitulé «Angel No 9». Il allait en fait accumuler ce genre d’erreurs, avec notamment ce morceau titre qui sonnait comme de la mauvaise pop. On ne comprend pas qu’à l’époque des gens aient pu accepter d’orchestrer une horreur telle que «Empty Bed». Et ça empirait encore avec «Woman».

Paru en 1994, soit un an après sa mort, Heaven And Hull avait plus d’allure, et ce pour quatre raisons principales. Un, le «Don’t Look Back» d’ouverture de bal, un cut dévasté du bigorneau, avec un Ronno qui saute à pieds joints dans la soupe. Il redevient le guitariste incisif qu’on adore, il joue de belles lampées chromatiques et nous gibsonise bien les oreilles. Il ouvre des portes sur l’infini et crée son monde. Voilà ce qu’on attend des artistes : qu’ils créent leur monde. Il enchaîne avec une très belle cover de «Like A Rolling Stone». Bowie chante, c’est admirable car géré à l’up-tempo. Ça vire au céleste. Bowie chante à l’excédée, tel un seigneur de l’An Mil importuné par des barons. Version monstrueuse ! Ronno gratte comme un beau diable. C’est à la fois échevelé, grandiose et anglicisé. Les Lords avalent Dylan! Troisième raison : «Trouble With Me» avec une Chrissie Hynde qui entre dans la danse et ça tourne au duo d’enfer. Ah quel régal ! - You can be so strong if you need to - Voilà un groove impliqué. Et quatre, la version live d’«All The Young Dudes» avec Ian Hunter et Bowie. L’Hunter fait le cake. On se demande comment Bowie a pu supporter un m’as-tu-vu comme l’Hunter. Les chœurs sont un chef-d’œuvre de fondue bourguignonne. Et le reste ? John Mellecamp vient faire le zouave sur «Life’s A River». Ronno y claque de sacrés paquets d’accords, mais il lâche une mayo trop liquide. Même s’il joue comme un beau diable. Quant à «Colour Me», ça sonne un peu trop rock FM. Il faut se méfier, Ronno pourrait montrer des tendances à la putasserie, il faut le surveiller, d’autant qu’il a pris la sale habitude de tortiller du cul. Ça ne plaisait pas à Trevor Boulder qui détestait les tantes. Bon, c’est battu sec, mais ça flirte avec le rock FM. Ronno nous chante ça en loucedé.
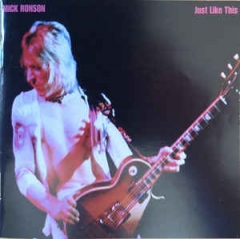
Puisqu’on est dans les albums posthumes, on peut encore en citer trois, et pas des moindres : Just Like This et Showtime (parus en 1999), puis la BO du film Indian Summer parue un an plus tard. «Just Like This» est un vieux standard de T. Bone Walker que Ronno tape au Diddley beat revanchard. On a là du grand Ronno pop avec toute l’énormité de son à laquelle il nous habitue depuis le début. On note même la présence de vieux relents de «Jean Genie». On trouve d’autres merveilles sur Just Like This, notamment «Is That Anyway», pur jus de glammy power surge. Quand il claque, il claque , il ne fait pas semblant. Il renoue avec son extraordinaire savoir-faire d’artisan de glam d’Hull. Il rentre dans le gras du glam comme personne. Tiens, encore une merveille avec «Roll Like A River». Il joue son heavy blues au gras double. Big Ronno game. C’est même assez affolant. On peut même aller jusqu’à qualifier son son de terriblement distinctif. Il joue à la dégoulinade de notes. C’est d’une véracité à toute épreuve. Il fait exploser sa niaque de son et il part sans prévenir en mode boogie blast. On retrouve aussi sur cet album le fameux «April No 9» de Pure Prairie League, un groupe qui l’avait sollicité à une époque. Ronno adore les échappées belles vers la frontière. Il se répand. Comme il se sait particulièrement doué, il s’accorde le droit de faire ce qu’il veut, alors il explose le pauvre cut. Ça va même très loin, car il crée les conditions d’un monde pur. Si on aime la grande électricité, c’est lui qu’il faut écouter. «Taking A Train» vaut aussi le détour. Avec ses amis de Bearsville, il crée de l’enchantement. Il va chercher les meilleurs climats guitaristiques. Il va à l’exaction comme d’autres vont aux putes, c’est aussi simple que cela. Encore un extraordinaire shoot de pop glammy avec «Hard Life». C’est d’un niveau si haut qu’on en chope le torticolis. Il faut se rappeler que Ronno est un génie de l’impulse sonique. Il ne joue pas ses notes, il les suspend, comme on suspendait les jardins à Babylone. Il joue en prime tous les accords intermédiaires. Dans le move, il claque des gimmicks de Ziggy. Il tape «Craey Love» à la note tropicana. Voilà un fabuleux shoot de pop atmosphérique - Crazy love/ Is haunting me - Ronno n’en finit plus e bâtir l’empire du son épique. C’est lui et nul autre au monde qui définit les règles. Tiens, voilà une reprise du fameux «Hey Grandma» de Moby Grape. Le gang de Ronno fonctionne comme une horloge. Quelle fabuleuse énergie ! Ronno transforme tout en brasero. Même le boogie ultra cousu d’«Hard Headed Woman» passe comme une lettre à la poste. Pur Ronno drive. Il nous barde ça de couenne de son. Avec Ronno, pas de problème, on a tout ce qu’il faut.
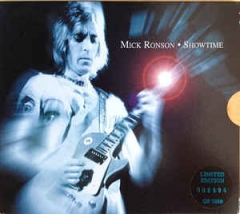
On reste au même niveau avec Showtime qui est en fait le titre de l’album enregistré avec Mott et jamais sorti. On a là du live, et même du gros live américain. Le Ronno band se compose de Mick Barakan (guitar), Jay Davis (bass), Bobby Chen (drums). Ils jouent tous les hits de l’album précédent, à commencer par «Just Like This», véritable assaut riffé à la vie à la mort - Gonna rock my baby/ Just like this - Ronne déborde de jus, il rocke son rock à coups de power-chords, c’est bardé de son à l’extrême. Belle version d’«Hey Grandma» pulsative à souhait. Quelle santé interprétative ! Ils courent comme des furets à travers l’immense pétaudière. Ronno dynamite tout ce qu’il touche. On retrouve aussi le heavy blues de «Taking A Train». Ronno taraude son son à la clé de sol entreprenante. Il darde de mille feux. Il est certainement l’un des guitaristes les plus expansifs du siècle passé. Avec «Junkie», il propose une extraordinaire pantalonnade d’accords décortiqués - Baby I can’t let you down/ I’m just a junkie about your love - Sur sa basse, Jay Davis fait un véritable festival. L’un des péchés mignons de Ronno est le romantico-mélodico : bel exemple avec «I’d Give Anything To See You». Là, il déploie ses ailes. Il s’élève dans le ciel et passe un solo élégiaque, il va chercher des féeries de notes au bas du manche. Quel Guitar Lord ! Puis il enchaîne avec un «Hard Life» poppy joué à la force du poignet sonique. Ronno nous noie tout ça dans le meilleur son, comme on peut bien l’imaginer. Il fait autorité dans tous les domaines. Quel seigneur des annales ! Il tape aussi une version solide de «White Light Whit Heat». C’est la pétaudière d’office. De toute manière, avec ce genre de cut, il est difficile de faire autrement. Impossible d’échapper au mode dévastateur. Ronno joue le pur sonic trash. Et ça se termine avec le brillant «Slaughter On 10th Avenue», l’hymne ronnique par excellence.
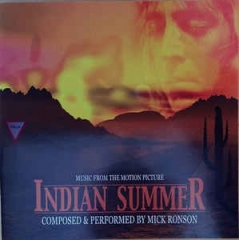
Ultime contribution de Ronno au monde du rock, la BO composée pour un film jamais sorti, Indian Summer. On s’en doute, le morceau titre renoue avec la veine élégiaque et montée du collet. Ronno joue ça au panoramique. Il faut attendre «Get On With It» pour trouver un peu de viande. On a là un fabuleux shake de rockalama joué au claqué d’accords secs. Tout est très carré, très gorgé de son. «Blue Velvet Skirt» sonne comme un slowah enragé, comme figé dans le sucre glace, mais au fond assez imparable. Une sorte de perfection se dégage en permanence de Ronno. On sent qu’il ne fait jamais rien au hasard. Il ouvrage le western spaghetti de «Satellite 1» comme un orfèvre et la blue velvet skirt fait son retour, mais cette fois pour tomber au sol. Il termine en grattant «I’d Give Anything To See You» en solitaire. C’est un vétéran du you’re not alone, ne l’oublions pas. Il sait tortiller ses coups de Jarnac d’electric mud. Quel fantastique artiste ! De toute évidence, Ziggy n’aurait jamais pu exister sans lui. Même chose pour Ian Hunter.

La période Hunter est aussi consistante que la période Spiders. Même quand on n’aime pas trop l’Hunter, force est de reconnaître que ses albums s’imposent, notamment son premier album solo sobrement intitulé Ian Hunter, et paru en 1975. Il attaque avec l’un des hits les plus fantasmatiques de l’époque, «Once Bitten Twice Shy», pure zone d’émerveillement latéral. Ronno y gratte sa bonne cocote. Avec ça, on se retrouve dans le giron du meilleur rock anglais, celui du son à guitares des seventies. Il faut le voir, ce diable de Ronno, partir en vrille de solo flash académique. On est en plein dans le Mott Sound System. Ronno et l’Hunter enchaînent avec un extraordinaire brouet de glam intitulé «Who Do You Love», claqué au son de la perfection, cousu de fil d’or par un Ronno ultra-présent, hyper-actif et gracieux. C’est dingue comme l’Hunter pouvait singer Bowie. Il a cette puissance corporelle qui lui permet d’arquer au grand large, et Ronno aménage le meilleur sonic round-about d’Angleterre. Toute la magie du glam est là. Et ça continue avec «Lounge Lizard», un cut prévu pour Mott, trop beau pour être vrai, bardé de son, c’mon c’mon, c’est trop dense, trop riche. Ronno y tourbillonne à l’infini. Avec «Boy» ils tapent en plein dans le ziggy mille. L’Hunter singe à bras raccourcis, mais il fait quelque chose de stunning - You’re the guy/ You’re the number one - Quelle aventure ! Voilà un cut poignant et furieusement inspiré. L’Hunter sait glammer son monde et donner du volume. Il peut monter en puissance. Il sait worker son mojo. En B, Ronno ramène une belle louche d’heavyness dans «The Truth The Whole Truth», Free-cum-Zep Lennon’s style transmuté par un Ronno virulent. Il fait le show, il tire ses notes comme Jeff Beck et revient à contre-courant du move. En fait, ce cut n’a aucun intérêt, si ce n’est le travail de sape de Ronno. Il pique encore une crise avec «I Get So Excited». Pour l’Hunter, c’est facile, avec un cisailleur de Les Paul comme Ronno dans les parages qui fait tout le boulot. Mais on retiendra de cet album qu’il est entièrement calqué sur ceux de Bowie. Le tandem Hunter/Ronno fonctionne aussi bien que le tandem Bowie/Ronno. Bowie n’aurait jamais dû se séparer d’un type aussi brillant que Ronno. Il faut dire que l’Hunter charge bien sa barque. C’est un prodigieux outsider. Il sait balayer les obstacles, oui, il a cette puissance de caractère. Il mord dans le rock à pleines dents. Guy Stevens l’avait bien compris lorsqu’il le recruta pour prendre le leadership de Mott.

Paru quatre ans plus tard, You’re Never Alone With A Schizophrenic est nettement moins bon. L’Hunter campe dans le Mott Sound avec «Just Another Night». C’est chanté à la force du poignet, et avec «Wild East», l’Hunter replonge dans Bowie. Retour à Mott avec «Cleveland Rocks», c’est toujours le même son. L’Hunter-médiaire n’est jamais sortie de son système. Il continue de faire du Mott sans Mott. Quand s’ouvre la B avec «Life Afeter Death», on croit entendre Bowie. Sans Bowie, l’Hunter est paumé. Et Ronno veille au grain : il bâtit des ponts merveilleux. Il faut dire que les balladifs de l’Hunter finissent toujours pas fonctionner, c’est en tous les cas ce que prouve une fois de plus «Standing In The Light». Ronno gratte bien le groove de «Bastard», on l’entend cocoter de bout en bout, mais pour une fois, il ne part pas à l’aventure.

Welcome To The Club est sans doute l’un des grands albums live de l’histoire du rock. Si on affectionne les grand doubles live (Doors, Steppenwolf, Humble Pie, Hawkwind), celui-ci relève aussi du passage obligé. On pourrait appeler ça un best of qui ne vous lâche plus la grappe. Et ce dès «Once Bitten Twice Shy» qui sur scène prend une dimension irréelle. Après deux couplets à sec, la machine se met en route et Ronno joue la carte du gros graillon d’accords. L’Hunter, pourtant si peu sexy, y développe sa puissance. C’est l’un des hits du siècle. Ronno fait sa crème au beurre et le cut explose à l’infini. Voilà un live qui s’annonce drapé d’or. Ces démons enchaînent avec une version altière et bardée de bon son d’«Angeline». Ronno est un précieux allié. L’Hunter savait ce qu’il faisait en s’acoquinant avec ce silver boy, ce golden God of rock guitar, cet archange sonique. Qui dira la santé de son son ? On se sent soudain installé au cœur du mythe. Ronno joue des ortolans de son, il produit des jardins suspendus. L’Hunter annonce an old song from Sonny Bono, «Laugh At Me» et que fait Ronno ? Il le joue serré, à la candeur de l’ampleur, c’est un son ronnique des temps anciens, oui, ça vient d’un temps où le monde du rock semblait si beau, si pur. Tout bascule dans l’incommensurable avec «All The Way From Memphis». Ronno joue comme un dingue et l’Hunter fait son Bowie, il stoppe les troupes dans leur élan pour mieux les relancer à l’assaut du ciel. Ronno fait un véritable carnage, la défraye la gueule de la chronique, il troue le cul du ciel, creuse sa route des Indes. Il est à son pinacle d’intelligence guitaristique. Il attaque la B avec le vieux «I Wish I Was Your Mother» qu’il mythifie vivant. Ronno adore les petites conneries romantiques, ah pour ça on peut lui faire confiance. Il fait sonner sa gratte comme une mandoline. Et en bonne bête de somme, l’Hunter entre dans le cut sans ménagement, comme s’il enfonçait son pieu noueux dans le vagin délicat d’une petite princesse pudibonde et tremblante. L’Hunter ne fait pas dans la dentelle. C’est un soudard. Il abuse de ses vieux accents glam pour chanter «Irene Wilde». Il donne vie au rêve working-class. C’est atrocement beau. Voilà un balladif taillé sur mesure pour l’Hunter. Back to the heavy motion avec «Just Anoteher Night». Ronno sait claquer de l’accord anglais. Il explose tous les encarts, il travaille sous terre, il sape le moral, il manigance des petites montées de fièvre, et quand ça s’emballe, il écrase ses propres riffs. C’est le vieux boogie-rock à l’Anglaise jadis initié par les Stones. On reste dans les pires excès avec «Cleveland Rocks». Ces mecs-là étaient beaucoup trop puissants pour leur temps. Ah les gens en avaient pour leur pognon ! Tout cet album est visité par la grâce de Ronno. Un Ronno qui se montre tout simplement admirable de bout en bout. Le disk 2 vaut lui aussi tout l’or du monde, d’autant qu’on y retrouve «Walking With A Mountain/Rock’n’Roll Queen», un énorme slab de Stonesy. Pour Ronno, c’est du gâteau. Il joue comme un dieu du stade à la peau dorée d’ange d’Hull. Il joue clair derrière le chant et multiplie les intrusions organiques. Il faut l’entendre claquer ses petits riffs au débotté et couler un bronze éclair, avant de partir en vrille de Red Baron. Il construit une cathédrale de son haletante. Le public attend les Young Dudes au virage, et l’Hunter fait «louder !» Merci David ! Ronno réussit à placer son petit «Slaughter On 10th Avenue», si mélodiquement attirant et il s’amuse à l’exploser au firmament. On assiste là à un phénomène musicologique palpitant. Back to the hot glam avec «One Of The Boys» qui prend ici des proportions spectaculaires. Ronno n’en finit plus de claquer sa Stonesy et de filocher des zigouigouis qui collent et qui chuintent, il joue les grandes manœuvres et secoue d’immenses carcasses d’accords. Il génère une monstrueuse pétaudière et file au vent mauvais vers la gueule béante des enfers. On trouve aussi en D une version superbe de «Man O War». Ronno et l’Hunter tapent encore dans la Stonesy et soudain, l’Hunter part en chasse, ils sont dans ce move, sans peur et sans reproche. Ils rendent hommage à Keef et joue leur Stonesy dans les règles de l’art. C’est là où le glam épouse la Stonesy. On est au cœur du rock anglais le plus précieux.

L’Hunter s’est fait couper les cheveux, d’où le titre de l’album Short Back ‘n’ Sides, qui paraît l’année de l’élection de François Miterrand. Ronno et Mick Jones se partagent la prod. Dès «Central Park West», on sent la pop, mais avec une certaine profondeur de champ, c’est déjà ça. Mais les choses empirent assez rapidement avec «Lisa Likes Rock’n’Roll», un cut poppy et putassier infesté de relents de reggae. C’est très années quatre-vingt. Heureusement, Todd Rungren vient sauver l’album en jouant de la basse sur «I Need Your Love». C’est poppy et bien soutenu aux chœurs et on entend même un solo de sax. On assiste à une incroyable conjonction d’esprits supérieurs. L’Hunter fait du Bowie-funk dans «Noises», et en B, «Rain» passe bien, car monté comme «Walk On The Wild Side». Mais le reste de l’album bascule dans l’horreur putassière. Ronno joue du reggae et se discrédite.

On retrouve Ronno sur un autre album de l’Hunter, All The Good Ones Are Taken. Ronno ne joue que sur «Death ‘n’ Glory Boys» qui sonne comme un cut de Ziggy. Ronno tisse sa toile et ça devient vite épique, voire grandiose. Pour le reste, l’Hunter fait du Bowie dans «Fun» et du Mott avec «That Girl Is Rock’n’Roll» - She dresses in leather/ She isn’t too together - et plus loin il ajoute qu’elle adore mouiller - She likes to get wet - ce qui en dit long sur le personnage.

Avec YUI Orta (the Three Stooges catch-phrase) Ronno existe enfin. C’est un album Hunter/Ronson, alors qu’auparavant, l’Hunter paradait tout seul sur les pochettes. Ils opèrent un retour à l’énormité avec «The Loner» que Ronno traite aux heavy chords de bonne aubaine - Ouh ouh I’m a loner - Derrière, la basse titube. Autre coup de génie avec «Beg A Little Love». On voit bien que l’Hunter utilise Ronno pour pallier à son manque de véracité et effectivement Ronno développe une tangible évanescence de génie impromptu. On a là un hot hit monté aux chœurs de filles et un Ronno qui encore une fois joue comme un beau diable. C’est battu au beat énervé et Ronno overwhelme son cut qui sort des nomes. Il l’enflamme littéralement ! Une fois de plus, l’Hunter s’impose avec ses balladifs, à commencer par «American Music», terriblement mélodique et imparable. L’Hunter n’invente jamais la poudre. Il campe sur ses positions et avec «Women Intuition», il tape dans son vieux boogie rock à la Mott. Il adore rouler dans ses vieilles ornières. Et Ronno n’a aucun scrupule à taper dans les riffs de Marc Bolan pour «Tell It Like It Is». Retour au Bowie Sound avec «Livin’ In A Heart», mais l’Hunter ensorcelle. Avec «Cool», Ronno wah-wahte à l’Hendrixienne, mais ça tourne au ridicule et l’Hunter se prend pour Queen. Ah il faut le voir pour le croire. En fait, ce disk présente un gros défaut : l’Hunter bouffe à tous les râteliers. Il va taper dans la new wave et le groove à la mormoille. «Sons ’N’ Lovers» et «Pain» frisent le calamiteux. Ronno surgit comme Zorro pour sauver «How Much More Can I Take». Il s’y conduit en super-productiviste, directement du producteur au consommateur et il boucle avec «Sweet Dreamer», l’un de ces instros ultra-mélodiques et comme suspendus dans le temps dont il a le secret.

Pour clore l’épisode Hunter/Ronson, il est chaudement recommandé de voir le concert filmé au Rockpalast en avril 1980. Il est en ligne. Autant Ronno passe bien, autant l’Hunter-minable passe mal : trop confiance en lui, trop de cheveux, trop de bigger than life. En prime, il porte un costard, une cravate et des boots blanches. Trop c’est trop. Il gratte ses accords rock’n’roll avec une belle arrogance, c’est sûr. Sur scène, Ronno et l’Hunter de Milan sont bien entourés. Ronno fait moins de grimaces qu’à l’époque des Spiders. Il semble plus stoïque, plus appliqué et il joue avec une fluidité exceptionnelle. Sous le micro de l’Hunter-continental, on voit une série de médiators qui pendouillent comme autant des paires de couilles, collés à un bande de gaffeur. L’Hunter sort son harmo pour «Angeline» et n’en finit plus d’assurer comme une bête. On ne peut que constater l’imparabilité de sa présence scénique. C’est un bonheur que de voir Ronno partir en solo. Il s’y montre expansivement intangible. L’Hunter-communal annonce «Laught At Me» - A song written in 1965 by a guy called Sonny Bono - Puis Ronno joue de la mandoline sur «I Wish I Was Your Mother». Fantastiquement cousu et pourtant, ça marche à tous les coups. Mais l’Hunter accapare trop le lead. Ce n’est pas lui qu’on vient voir, mais Ronno. Avec «All The Way From Memphis», on reste dans du grand Mott puis Ronno sculpte la matière dans Dudes. Il y grave son gras dans le marbre du glam et Ronno boucle le set avec son magic Slaughter.
Signé : Cazengler, Mick Ronron
David Bowie. The Man Who Sold The World. RCA Victor 1972
David Bowie. Hunky Dory. RCA Victor 1971
David Bowie. The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. RCA Victor 1972
David Bowie. Aladdin Sane. RCA Victor 1973
David Bowie. Pin Ups. RCA Victor 1973
David Bowie. Live Santa Monica ‘72. EMI 2008
Mick Ronson. Slaughter On 10th Avenue. RCA Victor 1974
Mick Ronson. Play Don’t Worry. RCA Victor 1975
Dana Gillespie. Weren’t Born A Man. RCA 1973
Ian Hunter. Ian Hunter. CBS 1975
Ian Hunter. You’re Never Alone With A Schizophrenic. Chrysalis 1979
Ian Hunter. Welcome To The Club. Chrysalis 1979
Ian Hunter. Short Back ‘n’ Sides. Chrysalis 1981
Ian Hunter. All The Good Ones Are Taken. CBS 1983
Ian Hunter/Mick Ronson. YUI Orta. Mercury 1989
Mick Ronson. Heaven And Hull. Epic 1994
Mick Ronson. Just Like This. New Millenium Communications 1999
Mick Ronson. Showtime. New Millenium Communications 1999
Mick Ronson. Indian Summer. Burning Airlines 2000
David Bowie. Bowie At The Beeb. Parlophone 2016
Weird And Gilli. Mick Ronson - The Spider With Platinum Hair. Independant Music Press 2009
Max Bell. The Rise And Fall of Mick Ronson. Classic Rock #236 - June 2017
D.A. Pennebacker. Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. DVD 2007
Ian Hunter Band Feat. Mick Ronson. Live At Rockpalast. DVD 2011
08 / 01 / 2019 / PARIS
SUPERSONIC
HAPPY ACCIDENTS / THETRUEFAITH
KURT BAKER COMBO

Premier concert de l'année, un peu à l'arrache, déniche l'info de Kurt Baker Combo par hasard en trente secondes, inconnu au bataillon, j'y cours, j'y vole à l'aveuglette. Il ne sera pas dit que cette 401° livraison n'aura pas été auréolée de son concert. Surprise en arrivant, n'y a pas que le baker qui pétrira son pain ce soir, deux autres marmiton les précèderont au fournil, quel merveilleux hasard, que dis-je quel heureux accident. !
HAPPY ACCIDENTS

Quatre grands gaillards sur scène. Au troisième morceau, Metal Dance, il faut se faire une raison, groupe musical, pas de chanteur. Je vous interdis tout fourvoiement : ce n'est ni du metal ( dommage ! ), ni de la dance ( ouf ! ). Difficile à caractériser. Au début ça ressemble un groupe de surfin qui aurait oublié toutes ses racines rock'n'roll, drôle d'oiseau sans ailes. Ce qui est sûr c'est que les deux guitares et la basse tirent la loco. Rascal à la batterie joue le rôle du tender qui procure la pression. Une frappe sans interstice, rapide, sans temps mort, une galopade serrée et interminable, autant dire que les deux guitaristes devant ils n'ont aucune seconde de libre, aucun break pour articuler leurs émissions, à eux de se débrouiller pour occuper tout l'espace. Ils ne s'en privent pas, et vous devez changer le fusil d'épaule, l'ensemble est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraîtrait au premier abord. Vous font de ces friselis cordiques qui s'entremêlent joliment. Et bruyamment. Drone Attack le confirme, nous filons vers une modernité beaucoup plus immédiate, nous revoyons notre blind-test, nous disions surfin, cette fois-ci nous cocherons the progressive case. Le public adhère, les applaudissements sont de plus en plus nourris à chaque fin de morceau, vous y percevez cette satisfaction respectueuse qui s'empare des esprits lorsque l'on se rend compte que le conférencier compte sur l'intelligence des auditeurs pour comprendre de quoi il s'agit. Belle musique, ronflante et chamarrée, mais qui étrangement n'est pas sans évoquer le vide de notre époque, friches intellectuelles en berne et pauvretés économiques en érection. Ruiner, I Dreamed and I Died, pas besoin de beaucoup de mots pour effectuer des constats définitifs, les titres suffisent. Surprise, ils chantent aussi. Si l'on peut appeler cela chanter ! Disons qu'un gosier émet du son. El cantaor gêné par sa planche à pédales à effets multiples, se voûte sur le micro, l'a la colonne d'air aussi penchée que la tour de Pise les jours de grand vent. Ce n'est pas gênant, vu le propos, personne ne s'attendait à ce qu'il récite un poème. Sans doute n'y a t-il plus rien à dire en ce bas-monde. Les paroles du dernier morceau sont prophétiquement symboliques, se résument à trois mots-clefs La-La-La, que vaticiner de plus, les guitares vrombissent et vous sculptent votre malheur. A croire que l'accident final ne sera pas heureux. En tout cas, ce qui est certain, c'est durant trois quarts-d'heure nous n'avons pas été malheureux. Essayez de faire mieux.
Les groupes se suivent et ne se ressemblent pas. Après un quatuor expérimental qui aimerait bien s'éloigner des racines sacrées du rock'n'roll mais qui n'ose pas non plus plonger dans de savants dodécaphonismes noisiquement aventureux, voici la vieille garde du rock'n'roll, celle que l'on engage dans les moments critiques, lorsque tout semble perdu.
THETRUEFAITH

Ne sont plus très jeunes. Mais ils portent beau. La classe et le style. En quinze secondes, ils vous redressent la situation, un seul étendard, le rock'n'roll. Z'ont admis un petit jeune dans le groupe des grognards, l'est chargé de la batterie, un bon choix, n'arrête pas de décharger un fricot de fracassées abrasives. Une frappe lourde, multiple, ample et sans repos. Devant les guitares balancent. Normalement ce devrait être au drummer de balancer, mais là ce sont les guitaros. Car le drummer, je le rappelle aux esprits distraits, il cascade la casse sur ses caisses. Question guitares, pas du genre à tailler la mortadelle congelée en tranches superfines de Prisunic. Au fond du grabuge vous avez le vieux son des Stones, mais revu et corrigé par les Ricains, ne se sont pas fatigués les amerloques, ont repris les mêmes plans, mais en plus rapides, la même impression mortelle que mon chien et moi lorsque nous avons été pris dans un essaim de milliers d'abeilles en transhumance, un bourdonnement de partout qui fuse de nulle part et de tous côtés. Un danger grisant. En plus Thetruefaith ils ont un chanteur. Un vrai. Pas au four et au moulin. Au micro. Une belle voix, et plus le set avancera, elle se chargera de mille lampées de beuverie au fond de bouge sordides au bord des bayous infestés d'alligators. Un régal. En prime les poses qu'ose le torero devant les cornes, et les mimiques en coin de figure qui déchirent. Et puis les guitares, elles glissent, du pur jus de cambouis, vous passent les riffs comme les bandes de mitrailleuse dans Le Jour le Plus Long. Vous font de ces loopings de rêves et de ces toboggans d'enfer à courir allumer un cierge à sainte-Thérèse pour les remercier. Vaut quand même mieux rester sagement – en fait le public commence à tanguer et à se réchauffer – à les écouter car ils procurent Fire et Methadone à volonté. Brûlant et en concentré. Nos chouchous ont le show chaud. Z'appliquent la vieille recette de l'ébullition constante en augmentation obligatoire. Un truc qui défie les lois de la physique mais pas celle du rock'n'roll. Last Chance Googbye, Now It's Time, You'll Never Die – remarquez comme ces trois titres résument à eux seuls le mode outrancier de vie rock'n'roll - sont des bijoux brûlants, des diamants gros comme le Ritz aurait dit Scott Fitzgerald, l'épure et l'essence du rock'n'roll, inusable, immortel, la seule drogue à accoutumance éternelle. Merci Thetruefaith de nous l'avoir rappelé. Même si nous le savions déjà.

KURT BAKER COMBO

European tour 2019. Ce soir à Paris, demain en Allemagne. Kurt Baker provient de Portland mais s'est installé depuis plusieurs années en Espagne. Ne vous étonnez pas si ça sonne américain. Un drôle de mélange tout de même. De l'afterpunk mais beaucoup plus after que punk. De ce dernier ils on gardé l'énergie mais ont expulsé la méchanceté. After et même Before. Des racines lointaines qui remontent jusqu'aux Beach Boys. Dans la grande partition, ils ont choisi le côté Beatles, et non la blue darkness stonienne. Pas gentillets certes, mais tout de même un côté festif. Le public a adoré. Moi aussi. Surtout la musique. Plus réservé au niveau de la voix, trop coulée dans le foisonnement des guitares. Je ne sais si à la sono cela aurait pu vraiment être amélioré, au finish je pense que cela relève d'un choix esthétique.
Un hurlement d'asile aliéné pour lancer le set. Provient du batteur, à croire qu'un utahraptor s'est introduit dans la salle. On ne l'entendra plus de tout le set. Du moins au micro, car question drummin il effectue un travail de dingue, tâte un max, pas qu'il tâtonnerait, non une frappe puissante et d'une rapidité inouïe, always on the break, un continuum de brisures effrénées, le gars ne vous laisse jamais l'oreille en repos, doit avoir un cœur d'engoulevent capable de rester plusieurs mois en l'air sans se poser. Si les sbires de Diapason l'avait entendu, ils n'auraient jamais osé décerner un Diapason d'or aux Percussions de Strasbourgs.

Ce qu'il y a de miraculeusement terrible c'est qu'on ne l'entend pratiquement pas, pour être plus juste on ne le discerne pas plus que cela dans la profusion de l'ensemble. Un mur de lave qui descend d'un cône volcanique charrie bien de débris et de scories mais vous ne voyez qu'une immense langue de feu qui dévaste irrémédiablement la contrée. N'ont pas recruté un manchot à la guitare, certes Kurt à la rythmique l'aide bien mais Jorge est un bretteur imparable. Donne l'impression d'une foultitude de rubans d'or qui s'échappent de son appareil à combustion. Un laminoir à langue de tamanoir. Le son s'infiltre partout, vous submerge sans que vous en preniez conscience. S'amusent comme des petits fous. Les départs et les fins de morceaux sont de véritables films d'animations. Jettent un riff pratiquement au hasard et à chacun de se dépatouiller comme il peut, attention il faut que ça se termine ou que ça commence avec l'ampleur d'une ouverture ou d'un finale de symphonie à la Beethoven. Trapèze volant sans filets et je te pousse en plein déséquilibre, le bassiste particulièrement fort pour louer à la voiture balai en ces ultimes moments. J'en ai eu les oreilles toute batifolantes durant une heure en regagnant la teuf-teuf à l'autre bout de Paris. Rien à dire, flair infaillible de rocker, ce soir fallait être au SuperSonic. Ëtre ou ne pas être. That is the question ! Super Sonique !
Damie Chad.
FULL PATCH
LA BIBLIOTHEQUE DU MOTARD SAUVAGE
JEAN-WILLIAM THOURY
( Serious Publishing / 4° trim. 2018 )

Une ultime gorgée de café et dans cinq minutes je serai en train de kroniquer le dernier ouvrage de Jean-William Thoury. J'ai failli m'étrangler. L'on cause de Harley-Davidson aux infos. L'on situe l'endroit. Le point géodésique exact, in Paris, où la semaine dernière Jean-William Thoury dédicaçait son livre, je rappelle aux lecteurs à courte mémoire la kro 399 du 27 /12 / 2018, qu'en compagnie d' Alicia Fiorucci, Tony Marlow y faisait son show... Inimaginable nouvelle ! Le monde est en train de changer de base ! D'ici peu sera commercialisée la nouvelle Harley. Electrique ! Preuve à l'appui, le reporter nous fait entendre le ronronnement du nouvel appareil. Ressemble à s'y méprendre au bruit de l'engin à double balayettes qui nettoie les caniveaux devant mon domicile. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'ouïr le besogneux engin municipal provinois, il leur suffira de brancher leur robotique râpe à carottes pour en reproduire l'équivalent. Bye-bye les motards sauvages. Au siècle suivant l'on affirmera que le book de Jean-William Thoury aura été écrit juste avant l'extinction des dinosaures mécaniques.

Laissons-là ces lendemains qui déchantent. Un coffre à merveilles de quatre cents pages, papier glacé nous attend. Jean-William Thoury a lu plus de trois cents bouquins – genre de sport pratiqué par les érudits de la Renaissance - consacrés aux clubs de bikers. Nous les présente un par un. Production francographe et de langue anglaise. Une aubaine car parfois la langue de Shakespeare s'avère aussi incompréhensible aux natifs de douce France que l'écriture cunéiforme. Thoury s'est chargé du bruit et de la fureur, Serious Publishing de l'esthétique. Repros couleurs à chaque page. Une véritable exposition de tableaux. Il se pourrait qu'une majorité d'esthètes jugeassent ces couvertures cheap and kitch. Mais tous ceux qui adorent les bielles mécaniques et les pulpeuses créatures apprécieront ces rutilances phantasmatiques. Pour ma part j'oserai le concept de d'héraldique romantique. Toutefois ne cédez point aux miracles de l'imagerie, certes les pleines-pages photograpphiques abondent, mais le texte n'est point maigrelet. Policé en petits caractères extrêmement lisibles. Des heures de lecture. Jean-William Thoury n'a pas boudé le travail. Une Bible, mais cette fois vue du côté des anges de l'enfer. Les livres sont présentés dans l'ordre chronologique de leur parution. Si les années soixante occupent cent cinquante pages, la fin du siècle et le début du nôtre accaparent le restant de l'espace, cette inflation témoigne à elle seule de l'importance acquise par le phénomène biker en quatre-vingt ans, les sociologues ne manqueront pas de brandir le concept des minorités actives.
Full Patch oscille sempiternellement entre objectivité et subjectivité, ce qui est la meilleure manière de bafouer la lâche neutralité des universitaires. Jean-William Thoury résume le contenu des ouvrages qu'il présente. Pour les ouvrages d'imagination à suspense il se garde bien de nous révéler la toute fin de l'intrigue selon l'adage que l'incitation au désir procure davantage de jouissance que la satisfaction du plaisir. Le lecteur alléché n'hésitera pas à se reporter au bouquin idoine ou à se livrer à mille délices hypothétiquement imaginatives.
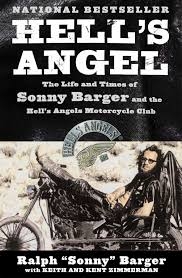
Full Patch possède ses parti-pris assumés. J.-W. Thoury est sensible à la force talismanique des mots. N'oublions pas qu'il lima en d'autres temps les chatoyances verbales du groupe Bijou. Ainsi il ne culbute jamais devant une longue liste de Motors-Clubs pas plus qu'il ne résiste à égrener les noms des principaux membres d'un club. Ces interminables nomenclatures évoquent des vocables aussi éclatants que les rimes flamboyantes des alexandrins d'Edmond Rostand. Ces mots portent en eux la force des présences qu'ils poétisent. Ils ne sont ni verbiage, ni remplissage, ils sont verbe agissant qui scandent le texte en lui permettant d'atteindre, grâce à une espèce de transe rythmique, à une profonde exaltation hypnagogique à l'instar de mantras matriciels. Leur nomenclature forme un arbre généalogique aux innombrables ramures. Vous croiriez facilement que vous êtes en train d'éplucher l'ancien armorial de la noblesse européenne... Un labyrinthe sans fin dans lequel vous seriez perdus si J.-W. Thoury ne nous venait en aide. Prend le rôle de Virgile qui guide complaisamment Dante dans les sept cercles infernaux de la Divine Comédie, encore que nous soyons carrément dans la Diabolique Tragédie dont le parcours, comme toute initiation, nécessite épreuves et persévérance.
Même si le premier Motor-Club date de 1903, l'histoire mythique des Bikers débute en 1947 avec les troubles d'Hollister popularisés en Europe par L'Equipée Sauvage en 1953. Incidemment, questions films, le lecteur se rapportera à Bikers, Les Motards Sauvages de Jean-William Thoury paru en 2013.
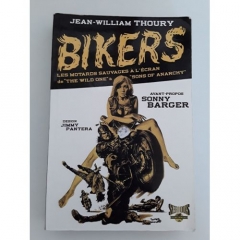
Jean-William Thoury en pince ( à vélo, excusez-moi ) pour les Hells Angels. N'en oublie pas pour autant les autres grandes confédérations, Bandidos, Pagan's, Outlaws, mais les Hells Angels remportent la palme. Ce sont eux qui ont en quelque sorte clarifié les tables de la loi. Il est aussi difficile d'évoquer les bikers sans faire référence aux Hells Angels que de parler de chevalerie sans faire allusion aux chevaliers du Graal. Reste que dans l'imaginaire populaire les Hells Angels n'ont pas une réputation d'agneaux innocents. Sont souvent présentés comme de sombres brutes mal dégrossies prêtes à vous trucider si vous vous approchez d'un peu trop près de leur moto.
Pour sa part la police n'y va pas de main morte. Elle assimile les Motor-Clubs à des gangs, autrement dit à de simples organisations criminelles coupables de toutes les exactions : viols, crimes, trafic divers : drogues, armes, prostitution... Jean-William Thoury remet les pendules à l'heure. Les M. C. ne sont pas responsables des actes commis par ses membres, à leurs initiatives personnelles, entrepris hors des activités du club programmées dans son statut. Ainsi le club de tennis que vous fréquentez n'est pas plus responsable des exactions diverses qu'à titre individuel vous exercez à vos risques et périls dans le restant de votre existence... Reste que toute institution légale peut aussi servir de paravent...

Qu'est-ce qu'un biker sauvage ? Outre le fait qu'il chevauche une moto ( de préférence une Harley customisée ), il est avant tout un être libre. Qui refuse de mener une vie d'esclave. A choisi une existence qui ne soit pas asservie par des horaires par trop contraignants, et à la merci de petits chefs emplis de suffisance et de médiocrité. Notons que de tels principes peuvent déboucher aussi bien sur une vision seigneuriale des plus éthiquement aristocratiques que donner lieu à des idéologies les plus troubles. Le biker est un anarchiste individualiste qui ne reconnaît qu'une seule association, celle de son moto-club...
Par la force des choses le biker conséquent avec ses principes se doit d'assumer sa propre subsistance. Il compte sur l'entraide de ses pairs, mais pas sur la charité des copains. Se débrouille. Se livre à de petits trafics : ce n'est pas tout à fait la même chose de de vendre cinquante grammes d'héroïne qu'un kilogramme. Nombreux sont ceux qui montent de petites entreprises : bars, tatouages, garage-motos...
Documentaires, romans, biographies et autobiographies sont les quatre types genres d'écrits que J. W. Thoury passe au crible de sa lecture. Ne sont pas tous de valeur égale. Trop de romans écrits à la chaîne regorgent de scènes de sexe et de violence, les auteurs ( et les éditeurs ) caressent les appétits les plus bas de leur lecteurs... C'est de bonne guerre. L'on ne lit que les livres que l'on mérite. Les documentaires se répètent souvent, quand ils deviennent intéressants et mettent la focale sur tel ou tel personnage l'on s'aperçoit qu'ils reprennent des éléments donnés dans les bios et les autobios des acteurs qui en ont été les principaux instigateurs.
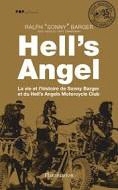
L'histoire des M. C. n'est pas de tout repos. Ils se livrent à de terribles luttes d'influence tant au niveau local que régional, national et même international. Parfois l'on brûle l'étape du baston pour sortir les fusils. Le Canada et l'Australie furent le théâtre de véritables guerres. Problème récurrent de toute organisation qui acquiert trop de puissance qui dès lors se concrétise sous forme de visées hégémoniques. Parallèlement à cette situation partagée par l'immense majorité des groupes humains, surgit la problématique des individualités. Désir de domination, jalousie, et ressentiment sont les moteurs ( non-exclusifs ) du comportement humain. L'on a un peu l'impression de lire des études du zoologiste Konrad Lorenz sur l'agressivité des oies cendrées.
Nous l'avons vu : en tant que personne morale le M. C. se refuse à toute violence et à tout trafic, mais il n'en est pas de même pour les individus qui le composent. Les trafics individuels génèrent argent, richesse et pouvoir. Autant de motifs de guerres intestines – la vie d'un M. C. n'est pas obligatoirement un long fleuve tranquille – et inter-claniques. De nombreux bikers finissent en prison. Les gouvernements n'aiment guère que des groupes auto-gérés échappent à son contrôle et instituent des zones de vie autonomes. L'Etat se défend : la police est chargée de surveiller et de réprimer ces ferments anarchiques. Les M. C. sont des structures fermées. Il est difficile à un policier de les infiltrer. Mais la parade fut facilement trouvée par le FBI. A un biker menacé de passer plusieurs années en prison il est facile de proposer de changer de camp, de rentrer dans un M. C. et de pousser certains de ses membres à quelques actions ou trafics illicites. Ce petit jeu peut durer plusieurs années, jusqu'à ce que l'on ait collationné un nombre suffisant de preuves, et lorsque le fruit semble prêt à tomber, le jour J, à l'heure H, sur différents points du territoire, parfois très éloignés, un ballet de perquisitions généralisées est déclenché... La récolte peut être juteuse, comme très maigre.

Mais le jeu est dangereux. Ne parlons pas maintenant des traîtres – nous les laissons avec leur conscience – mais de véritables et volontaires agents de l'Etat immergés durant des mois et des mois à l'intérieur d'un M. C. Des liens, sinon d'amitié, du moins d'estime, se nouent... Certains policiers infiltrés en arrivent à d'étonnantes conclusions : les gredins qu'ils espionnent leur paraissent plus honnêtes que leurs supérieurs hiérarchiques et politiques. Ils sont les premiers à dénoncer l'incompétence de leurs propres services... Hommage de la vertu au vice !
L'ensemble de l'ouvrage se donne à lire comme un roman historial. De volume en volume, Jean-Willam Thoury peint une épopée tumultueuse. Palpitante, car elle ne remonte pas aux temps anciens. Ses héros de chair et de sang bouillonnants sont nos contemporains. Ils ont choisi de vivre en marge d'une société dont nous-mêmes subissons toutes les coercitions et toutes les avanies. Ils ne sont pas meilleurs que nous, mais font preuve d'un peu plus de courage... Encore que... les temps changent... les anciens bikers d'âge respectables sont les premiers à dénoncer les changements survenus dans les M. C. victimes d'une certaine institutionnalisation. Les conditions de vie et les mentalités se sont modifiées. Les temps ne sont plus les mêmes. Le M. C. n'est pas encore un loisir de Monsieur tout le monde mais même les policiers ont leurs motos-clubs... Est-ce la rage originaire des laissés-pour-compte qui s'émousse, ou le Système qui parvient à récupérer tout ce qui s'oppose à lui … Il existe toujours et encore des motards, mais le biker sauvage est une denrée plus rare... Jean-William Thoury nous rassure, les vieux rêves sont comme les couteaux usés, ils ont besoin d'être aiguisés, et Full Patch est une merveilleuse pierre à fusil.
Damie Chad.
ERIC CLAPTON
PHILIPPE MARGOTIN
( Chroniques Editions / Novembre 2015 )
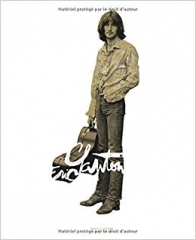
Je ne suis pas fan d'Eric Clapton, même si je dois reconnaître qu'il joue mieux de la guitare que moi. Quoique si je possédais sa dextérité j'en userais bien plus sauvagement rock'n'roll ! Comme il n'y avait rien d'autre sur l'étalage du camion Gibus, et qu'il est de bonne guerre de supporter son bouquiniste local qui se débrouille toujours pour offrir quelques vinyles à pochettes affriolantes, je m'en suis emparé, un peu dépité. Car je n'aime guère non plus, ces albums à grand format mis sur les étalages des grandes surfaces aux mois brumeux de novembre, afin de déclencher chez vos proches le réflexe pavlovien du cadeau de Noël... Me suis fait avoir parce que j'ai jeté un coup d'œil sur les premières pages. La préhistoire du british blues est aussi attirante et mystérieuse que la disparition de l'empire Hittite au douzième siècle avant le petit Jésus. Heureusement que je n'ai pas ouvert au milieu du bouquin. Clapton et moi c'est une histoire à éclipses, après 1974, j'ai laissé un peu tomber, de temps en temps un coup d'oreille, un peu comme quand vous présentez vos vœux à une antique copine...
Ne s'est pas trop fatigué Margotin, et les éditions Chroniques ne nous en fait pas voir de toutes les couleurs. Du blanc, du noir et des fonds de page mordorés. Des repros de pochettes de disques pas plus gros que deux timbres-postes sous lesquelles se trouve un commentaire des plus succincts, titres, musiciens + quelques phrases rapides pour situer le le style, et puis basta ! Les photos artistiquement découpées sont présentées comme ces vastes assiettes de hors-d'œuvres de la Nouvelle Cuisine en lesquelles se perd une asperge unique entourée de fines de lamelles de radis... Si vous êtes adeptes des révélations fracassantes, achetez de préférence l'autobiographie de Clapton, je ne l'ai pas lue, mais les seuls propos intéressants du livre y ont été empruntés par un Margotin visiblement en panne d'inspiration... questions réflexions personnelles et analyses pertinentes, Margotin ne s'est point moultement pressé le cérébral citron.

Un petit effort toutefois pour le début de la carrière de maître Eric. Un peu de grain à moudre pour le public actuel de Clapton qui n'aurait jamais entendu parler de Blind Faith, de Cream, des Yarbirds, des Blusbreakers et de toute l'antique panoplie, Margotin s'est fendu de quelques explications agrémentées d'encarts plus ou moins étendus pour les seconds couteaux de la légende, même si Alexis Corner, John Mayall, Peter Green, et Stevie Winwood ne méritent pas cette qualification infamante. Mais le margoulin en dit si peu sur Clapton que cela vous a un air de remplissage décevant...
La deuxième moitié du bouquin est franchement plus désagréable. Margotin se contente de noter les disques enregistrés par Dieu, chichement suivis de quelques commentaires sur la tournée promotionnelle qui suit. L'est vrai que Clapton ne l'aide en rien. Se contente de peu. Le mec gentil et serviable prêt à pousser un solo de guitare sur une des pistes de n'importe quel artiste qui l'invite. C'est simple, l'a joué avec tout le monde, sur scud comme sur scène. Les lecteurs pressés se reporteront en fin de volume aux quatre pages de la discographie. Bien présentée, claire, nette, précise, d'une lecture aisée.
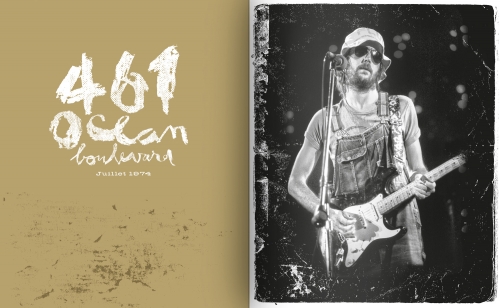
Et Clapton ? On le capte peu. Pas un mot sur sa personnalité. Margotin est le mec discret par excellence. L'évocation des amours d'Eric avec Pattie Harrison ne donnent lieu à aucune surenchère érotique. L'addiction à l'héroïne et plus tard à l'alcool est notée sans insistance, pas question de s'interroger par quels manques ou par quels déséquilibres ils sont causés... L'est vrai qu'il est un peu distant notre guitariste, quand la Reine le décore il déclare que plus jeune, dans sa période rebelle, il aurait refusé, mais là à soixante balais ( il y en a des coups qui se perdent ) il a réfléchi, l'ajoute même '' que c'est une chose importante que de pouvoir être un exemple''. Sans doute pour la jeunesse dégénérée qui écoute du rock'n'roll !
Passons au plus important : la musique. Avis aux amateurs de guitare, rien ne vous sera dévoilé. Je n'ose pas dire que je résume, j'enlève à peine quelques mots : en ses débuts Clapton jouait du blues. L'était même un puriste du country-blues. Après l'a mis de l'eau dans son vin bleu, pardon du rock'n'roll dans son blues - les Rolling Stones aussi – ensuite ce l'est joué laid-back. C'est à dire virtuose, surfin. Habileté maximale... qui coule comme de l'eau de source lustrale. C'est beau mais pas aussi fort qu'une rasade de moonshine au venin de crotale. Une nuit au camping idéale, sans moustiques, pour les adeptes du naturisme. N'empêche que l'on aurait apprécié quelques aperçus sur l'influence de Duane Allman et de J. J. Cale sur son style.

Le livre n'a pas que des mauvais côtés. Chacun rencontrera une figure mythique qu'il affectionne particulièrement – pour moi, par exemple Jim Cappaldi – mais la fidélité de Clapton au blues est patente. Quel plaisir de voir défiler tous les noms légendaires du Delta et du Chicago électrique, Clapton se débrouille toujours pour en caser au minimum un ou deux titres - classique ou exhumés de l'oubli, il s'y connaît le bougre - sur chacun de ses albums. Un néophyte tant soit peu curieux trouvera facilement dans ce livre bien des portes qui lui permettront d'entrer de plain-pied dans le territoire de la musique du Diable.

Quant à Clapton rescapé de l'explosion rock, auto-transformé en mercenaire de la guitare, j'avoue ne pas trop comprendre. Peut-être qu'un jour Dieu m'aidera. En attendant je cours me repasser Disraeli Gears et Layla pour dissiper mes idées noires et mes incertitudes bleues.
Damie Chad.
IGNEUS
PATRICK S. VAST
( Editions Fleur Sauvage / Novembre 2015 )
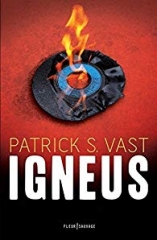
Jamais entendu parler de Patrick S. Vast ni des éditions Fleur Sauvage. Marcel Proust aurait dû y penser, A L'Ombre des Jeunes Filles en Fleurs Sauvages, ce n'est pas mal non plus. La couverture orange et surtout ce microsillon en flammes ont attiré mon regard. Rock'n'roll et satanisme au dos de la couverture, une petite lecture avant la nuit me procurera peut-être de splendides cauchemars ai-je pensé. Ben, non j'ai dormi comme un loir du Loir-et-Cher. Par contre une agréable lecture. Rock'n'roll, yes un peu. Période Led Zeppelin et Deep Purple. Et metal actuel. Ce qui nous vaut quelques scènes de répétitions en cave enfumée bien venues. Ce n'est pas le principal sujet du livre. Avant de l'aborder je vous délivre le Diable de sa fosse, z'oui un peu de satanisme, juste ce qu'il faut, comme quand vous vous préparez un kilo de piments habanero pour accompagner la cuisson d'un petit pois. Soyez un peu plus finauds, ce n'est pas parce que l'on ajoute un piment rouge devant vous qu'il faut foncer droit dessus. Non ce n'est pas ce qui doit aiguillonner votre désirs, peu de taureaux survivent dans l'arène. Les lecteurs de Kr'tnt auront toutefois cœur à réparer la description un peu trop caricaturale d'Anton LaVey.
Avant tout un roman policier. Avec un bon début et une meilleure fin. Patrick S. Vast vous fait le coup de ces groupes de rock qui terminent leur set en vous souhaitant un bon retour. Et qui cinq minutes plus tard reviennent pour un rappel que vous n'attendiez pas, qui se révèle plus surprenant que le set en lui-même. Et vous refont le même coup, avec un second rappel encore plus éblouissant. L'ultime baisser de rideau de Monsieur Vast est spécialement dévastateur. Tel est pris qui croyait prendre. Et le dindon de la farce c'est vous. Tant mieux pour vous.
Incidemment, mais il est des incidents qui soulèvent plus de questions que les énigmes que l'on vous offre pour détourner votre attention, Igneus jette ( à peine ) quelques pâles lueurs sur le sujet des combustions spontanées. Je sens que vous brûlez d'en savoir plus, alors je vous promets qu'une de ces livraisons je vous chroniquerais le roman de Jean-Pierre Roques sur ces consummations cendriques.
Igneus est avant tout, me semble-t-il, un livre sur le pouvoir. Politique, cela va sans dire, car c'est le seul pouvoir qui compte. Ses ramifications occultes, nécessairement, car pour agir en toute impunité, il est impératif de vivre secrètement. De quoi exercer vos vigilances citoyennes. Avant de courir aux armes. Ainsi que le propose la bonne chanson.
Damie Chad.