KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 377
A ROCKLIT PRODUCTION
07 / 06 / 2018
|
NEVILLE BROTHERS / VINCE TAYLOR U-BILAM / NAKHT / WILD MIGHTY FREAKS 2SISTERS / JAZZ MAGAZINE & CO |
Neville sainte - Part One
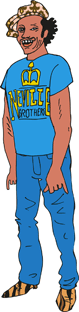
L’admirable Charles Neville vient tout juste de casser sa pipe en bois, au terme de soixante-dix ans d’une vie bien remplie : drogues, femmes, jazz et funk. Tous les amateurs de funk et de New Orleans Sound n’ont plus que leurs yeux pour pleurer, mais ce n’est pas leur genre. On le sait, ce que les gens de la Nouvelle Orleans appellent des Funerals sont d’abord des fêtes. On y chante et on y danse.

Charles est le premier des quatre Neville Brothers à s’en aller : Cyril, Art et Aaron lui survivent. Ces quatre brothers et leur oncle Big Chief Jolly jouent un rôle capital dans la légende de la Nouvelle Orleans. L’oncle Jolly paradait en tête des Wild Tchoupitoulas, Art monta les Meters dans les années quatre-vingt et Aaron a passé sa vie à chanter comme l’ange de miséricorde que filma jadis Wim Wenders. Quant à ce fantastique joueur de sax que fut Charles, il a préféré cultiver sa passion pour les drogues et la délinquance, ce qui lui a permis de visiter les ‘pens’ de l’époque, c’est-à-dire les pénitenciers, dont Angola, le plus terrifiant de tous. David Ritz consacre un livre aux Neville Brothers, mais il a l’intelligence de s’effacer, car ce que les quatre frères ont à raconter édifierait n’importe quel édifice. On observe un décalage vertigineux entre la saga des Neville et l’histoire de gens qui ont tenté de se faire passer pour des voyous, les Stones, par exemple. Tout au long de ce livre extrêmement dense, Art, Charles, Aaron et Cyril nous rappellent qu’un noir risquait encore sa peau pendant les années soixante et soixante-dix dans les rues de la Nouvelle Orleans - The cops were out for blood - et que tout le monde prenait des drogues dès l’adolescence.
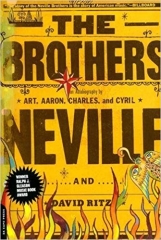
Le principe de ce livre est simple : après quelques pages d’intro signées David Ritz, les quatre brothers racontent à tour de rôle leur histoire, c’est-à-dire l’histoire de leur quartier (Valence Street), de leur famille (leurs parents, leurs femmes et leurs innombrables enfants), de leurs amis (Larry Williams, Dr John et combien d’autres) et leurs aventures musicales, aussi bien sur la route qu’à la Nouvelle Orléans. Des quatre, celui qui crée la plus belle proximité, c’est Charles, l’intellectuel de la famille, fan de Charlie Parker et de Monk, car il raconte son histoire avec une poignante honnêteté. Il développe ses épisodes assez longuement et termine généralement sur une chute brutale en forme d’apothéose, comme s’il jouait un cut de Trane.
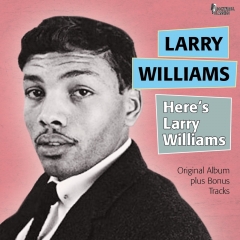
Quand il est gosse, son père l’emmène voir Charlie Parker, mais c’est complet. Charles reste à côté de la porte et écoute. Ce qu’il entend, pour lui, c’est la musique du futur - Bird was flying high - Il voit son père tendre l’oreille - My father had ears - Charles dit aussi que petit, il avait peur des blancs, surtout des paddy rollers qui patrouillaient la nuit pour terroriser les communautés noires. Charles a vu une bagnole de paddy rollers traîner un nègre attaché au pare-choc arrière. Petit, il a vu les night riders du Klan chevaucher et brûler des croix - Scary sights for a kid - Il évoque aussi les étudiants en médecine de Tulane, the gown men, qui rôdaient la nuit au volant de camionnettes blanches, en quête de corps pour leurs études. Une piqûre et puis pouf, terminé, plus jamais de nouvelles de vous - You’d never be heard from again -

Mais sur le chapitre du racisme, Cyril est le plus enragé des quatre : quand son frère fut envoyé cinq ans à Angola pour deux joints, Cyril considérait son frère comme un prisonnier politique, car pour lui, la guerre régnait à la Nouvelle Orléans. À ses yeux, les cops locaux se comportaient comme les unités spéciales de marines américains dans les villages du Vietnam - Search and destroy - Une nuit, Cyril et Aaron sont arrêtés par une patrouille. Aaron voit les flics frapper son frère, et comme il ne supporte pas ce spectacle, il réussit à choper l’arme d’un flic et annonce la couleur : «We all gonna die in this alley if you motherfuckers don’t back off.» Il met les flics en joue. Les cops reculent. Cyril dit à la page suivante que cette nuit-là, son frère lui a sauvé la vie. En gros, Aaron et Cyril expliquent que les cops avaient le droit de descendre des nègres dans la rue. Rien n’avait changé dans le Deep South depuis l’abolition de l’esclavage. Et quand on écoute ce qu’on appelle de la black (Soul, blues, r’n’b, funk, jazz, gospel ou doo-wop), il est essentiel de prendre ces éléments en considération. Dans les rues de leur ville, les Neville Brothers risquaient tout simplement leur peau parce qu’ils étaient noirs. Mais comme le rappelle Cyril, les gens de sa communauté parviennent quand même à célébrer la vie à travers la musique, quel que soit le genre, et ça fait toute leur force, pour ne pas dire leur supériorité. Des quatre frères, Cyril est le plus jeune et le plus enragé, politiquement. La guerre du Vietnam l’obsède parce qu’il ne comprend pas qu’on aille détruire des gens pour rien - Made no sense - Et ça le fout en pétard, exactement de la même façon que Mohammed Ali qui refusa d’aller se battre contre des gens qui ne lui avaient rien fait. Pour Cyril, les Vietnamiens subissent le même sort que les Indiens d’Amérique et les nègres. La conscience politique poussée à son extrême peut empêcher de vivre. That anger nearly cost my life.
À l’âge de seize ans, Charles prend la route et débarque à Tampa en Floride. On est en 1953 et il accompagne un certain Gene Franklin qui chante comme B.B. King et qui se fait passer pour lui, ce qui est facile, car à l’époque, les gens ne savent pas à quoi peut ressembler B.B. King. Voilà Charles installé au Blue Room, un club qui est aussi une maison de passe. Il y voit des artistes extraordinaires, comme Iron Jaw, Mâchoire d’Acier, qui rappelle The Bullet, l’homme tronc hurleur que décrit Dickinson dans son recueil de souvenirs paru l’an dernier : Iron Jaw pouvait lever une table en la tenant entre ses dents. Il pouvait encore la lever si une fille s’asseyait dessus. Il croquait et avalait des bouteilles de coca, des ampoules, des punaises, mêmes des lames de rasoir. Puis il avalait du feu. Charles séjourne aussi à Memphis, au fameux Mitchell’s Hotel. Il y fume beaucoup d’herbe et jamme avec le ferocious bopper George Coleman qui ira un peu plus tard jouer avec Miles Davis. Charles se laisse porter par l’air du temps comme un fétu dans le courant. Il joue du sax en pur autodidacte, il s’envoie en l’air chaque jour, et quand il peut, il touche au fruit défendu, c’est-à-dire la femme blanche. Charles est beau, extrêmement beau : les putes blanches lui tombent dans les bras.

Aaron explique que tout commence à l’école : «On appelait l’herbe ‘muggles’ et peu de temps après, j’ai attaqué l’héro. Dans note coin, uptown, c’était vraiment facile d’en trouver. Charles avait commencé avant moi. Uncle Jolly vendait de l’herbe, mais il recommandait de ne pas y toucher. Charles disait la même chose. Mais je ne les écoutais pas. The first time I shot smak, I was in love.» Comme Charles et Cyril, Aaron va rester sa vie entière accro - Hooked to the boy who make slaves out of men - le boy étant le surnom de l’héro. Et comme Charles, Cyril, Dr John et d’autres, il réussira à décrocher au moment où il trouvera de quoi remplacer cette fausse plénitude. Comme chacun sait, le substitut ne peut être que d’ordre spirituel.
En matière de sex and drugs and rock’n’roll, la part du lion revient à Charles. Il ne cache rien. Il s’installe à une époque avec Bobbie, une black savvy and superhip, qui vit la nuit et qui détient l’arme fatale : le contact avec Stalebread, le meilleur dealer de la Nouvelle Orleans. «Dans la hiérarchie de l’underground de la Nouvelle Orleans, les dealers se trouvaient au sommet.» Charles explique qu’on les respectait parce qu’ils reversaient leur blé dans la communauté - He was known as a bad dude who did good - Avec Bobbie, Charles découvre ce qu’il appelle the thrills, c’est-à-dire les sensations fortes - Aller de thrill en thrill devint my new way of life. Ce fut son moyen d’ignorer la peur.

Comme il ne travaille pas et que son sax ne lui permet pas de vivre, Charles cambriole des magasins. Il se fait poirer en sortant des télés d’une boutique et se retrouve au parish ‘pen’ de la Nouvelle Orleans. Six mois. Il y voit the Zuzu man, c’est-à-dire Dr John, vendre des crayons et des bougies. C’est là dans cette vieille taule que Charles devient ami avec Dr John - For life - Quand il sort, Charles et Bobbie décident d’aller faire un break à Memphis. Fin des années cinquante, Beale Street had that great music, that fast life and especially that cheap dope.

Charles fait pas mal d’allers et retours au trou, jusqu’au moment où ça tourne mal, puisqu’un juge l’envoie cinq ans à Angola pour deux joints - Considered a class-A narcotic as illegal as heroin - Les pages ‘Angola’ constituent le cœur de ce livre. C’est un véritable séjour en enfer. Le jour de la sentence, Charles voit son ami Melvin condamné à vie pour vente d’héro - Everyone was scared of Angola - Pour Cyril, Angola était ce qui pouvait arriver de pire dans la vie d’un nègre, the worst-case scenario : «The big, bad, dark state penitentiary stuck out there in north central Louisiana, where racism ran wild and convicts lost their minds and guards just for the hell of it tortured and killed» (ce pénitencier maudit installé au nord de la Louisiane, où régnait le racisme, où les condamnés perdaient la boule et où les gardes tuaient pour le plaisir). Ça, c’est la vue de l’extérieur. Charles donne une vue de l’intérieur. Angola était à son époque l’équivalent de ce qu’allaient être les camps nazis. Mais Charles commence par vivre ça avec philosophie : il savait qu’à force de jouer au con, ça allait mal tourner. Et comme il avait commencé à traîner un peu en enfer, il se disait : autant aller jusqu’au fond de l’enfer. So be it. Il s’y trouvait. Très vite, il apprend des règles de survie. Les gardes lui disent : «Si on te chope avec une lame en ta possession, tu prends deux ans de plus.» Et à côté, un vieux black lui dit : «Tiens prends cette lame. Il vaut mieux que ces bâtards de blancs te chopent avec plutôt qu’un prédateur te chope sans.» Charles écoute le conseil du vieux et prend la lame qu’on appelle black diamond. Il explique très vite que le danger vient souvent des autres condamnés, surtout ceux qui sont condamnés plusieurs fois à vie. Ils deviennent des prédateurs sexuels. Ils sont prêts à baiser n’importe quoi, surtout ceux qui ne savent pas se défendre. Charles sait que pour protéger son intégrité, il va devoir frapper le premier. Alors il frappe. Petit à petit il découvre le système d’Angola, particulièrement retors. L’ingéniosité de l’homme dans ce domaine n’a pas de limite, on le sait. Angola est en fait une très grosse ferme non subventionnée par l’État. Plusieurs kilomètres carrés. Les ressources proviennent des récoltes. Coton, canne à sucre. Ce sont des blancs qui gèrent ça, à cheval et armés, appelés the Free People, mais ils ne sont pas assez nombreux. Alors, ils nomment des blacks parmi les plus sanguinaires pour faire le boulot de ‘gardes’. Ils ont le droit de vie et de mort sur les condamnés qui travaillent. Les nazis vont utiliser le même procédé dans les camps. Le procédé remonte à Mathusalem.

Charles apprend vite à craindre the Free People, basically the descendants of slave owners, descendants des esclavagistes - Ils nous traitaient comme du bétail, et ils devaient même traiter leur bétail mieux que nous - Quand aux ‘gardes’, ils avaient l’autorisation de vous tuer si vous approchiez à moins de deux mètres d’eux - six feet - Et croyez-moi, personne ne disposait d’un mètre pour mesurer ça. You were at the mercy of mercyless men. Puis Charles raconte l’une des histoires les plus drôles de ce séjour en enfer : un beau jour, on l’amène avec toute une équipe sur un champ de coton. Le boss blanc sur son cheval blanc a deux sacoches : une pour son fusil et l’autre pour son manche de pioche. «On nous met en ligne, le boss donne un coup de sifflet et chacun avance dans son rang pour cueillir le coton. Sauf moi. Je n’ai jamais cueilli de coton, donc je ne sais pas comment faire. I don’t know shit. J’arrache des feuilles et soudain... WHACK ! Le boss me fend presque le crâne d’un coup de manche de pioche. Je tombe à genoux. ‘Dis-donc, négro’, me lance-t-il du haut de son cheval, t’as jamais cueilli de coton ?’ ‘No Boss, je n’ai jamais vu de putain de coton de toute ma vie.’ Je ne savais pas si j’allais avoir le temps d’apprendre avant que le boss ne me fende le crâne pour de bon. Un autre condamné me montra comment faire et pendant quatre-vingt dix jours horribles, j’ai cueilli le coton. J’entends encore la work song qu’on chantait dans les champs. À Angola, on appelait le travail ‘rolling’ - Early in the morning by the light of the moon/ I eat my breakfasyt with a rusty spoon/ Out to the cane field with the rising sun/ Just roll on, buddy, till the day is done/ Well I don’t mind rollin’ but, O Lord, we gotta roll so long/ Make me wish I was a baby in my mother’s arms» - C’est d’une beauté mélancolique hors normes.

Charles sort vivant d’Angola. C’était son seul objectif, sortir vivant. Il est interdit de séjour à la Nouvelle Orleans, mais on lui donne l’autorisation de revoir sa mère. En arrivant dans son quartier, il croise Stagger Stack Lee. Et avant d’aller revoir sa mère, il cède à sa vieille tentation - Went down the road and shot up with Stack - Il renoue avec sa chère héro. Une semaine après, il file à New York, où l’attend son agent de probation. Charles ne pense qu’à une seule chose : dreaming of thet potent heroin they sell in Harlem. Il vient de passer des années en enfer, mais la tentation est trop forte. Et comme le disait si justement Oscar Wilde, le meilleur moyen de résister à une tentation est d’y céder.
Et c’est la révélation : dans Central Park, il tombe sur des hippies qui lui offrent des tas de trucs - À Angola, les conflits conduisaient droit à la mort, et à Central Park, c’est la générosité des hippies qui me tuait. Je sortais d’un monde de violence, d’uniformes et d’humiliations et découvrais un univers coloré, psychédélique et vibrant de liberté - C’est un choc et Charles le dit mieux que personne. Il essaie les nouvelles drogues qu’il ne connaît pas et notamment le LSD - No wonder I became a tripper - Mais ce n’est pas pour ça qu’il arrête l’héro : «Harlem était le paradis des junkies, ou plutôt, comme j’allais le découvrir, leur enfer. Je n’avais jamais vu autant d’héro de ma vie. En arrivant à New York, j’hésitais à acheter de la dope dans la rue. À la Nouvelle Orleans, on connaissait bien les fournisseurs. On savait ce qu’on achetait.» Et il n’en finit plus de resituer les choses par rapport à la peur, qui, grâce aux patrons blancs dégénérés, est entrée dans la peau des nègres depuis plusieurs siècles : «Alors qu’à la Nouvelle Orleans, la peur ne me quittait jamais, je me sentais chez moi à Harlem. Harlem comprenait mon obsession, Harlem me permettait d’être défoncé tous les jours et d’être bien, l’approvisionnement était inépuisable et on se sentait loin, mais vraiment très loin du monde réel.»
Bien sûr, Charles ne perd jamais de vue la musique. Il accompagne à une époque Joe Tex, de passage à New York. Et qui joue du piano dans son groupe ? James Booker, l’une des légendes de la Nouvelle Orleans - who, like me, came to New York in search of better dope - Mais après de nouveaux ennuis avec la loi, l’agent de probation propose un choix à Charles : soit retourner au trou, soit décrocher. Il opte pour le décrochage. Il doit suivre un programme de méthadone. C’est un moyen de retrouver une vie normale, car calé sur la dose du matin, qu’il faut aller retirer dans une agence. À l’époque où il s’inscrit, ce programme est encore expérimental. On lui verse 800 $ par mois pour l’aider. Comme le gouvernement n’est pas sûr que ça marche, les candidats sont aidés financièrement. James Booker s’inscrit en même temps que Charles. Mais James est un virtuose de l’arnaque, et il s’inscrit dans trois centres en même temps. Il récupère donc trois chèques de 800 $ chaque mois. Et bien sûr, Charles en fait autant. Mais le programme de méthadone présente un gros défaut : si pour une raison ou une autre, on ne trouve pas de clinique ou d’agence quand on est en déplacement et qu’on rate sa dose, c’est l’enfer - The suffering is unimaginable - Et pour Charles, le résultat est le même : c’est une addiction. Il comprend qu’il faut passer à autre chose. Ça va lui prendre beaucoup de temps.

Le sauveur s’appelle Art, l’aîné des Neville Brothers. Des quatre, le plus discret. À l’origine des Meters. Un jour sa mère descend d’un bus et un camion qui ne l’a pas vu lui roule dessus. Art accourt à son chevet à l’hôpital, mais elle est explosée de l’intérieur. On ne peut rien faire pour la sauver. This is it, dit-elle. Puis elle ajoute avant de passer l’arme à gauche : «Keep them boys together.» Veille sur tes frères. C’est exactement ce que va faire Art : monter les Neville Brothers pour veiller sur eux.
Au moment où Art parle dans le micro de David Ritz, les Neville Brothers existent depuis vingt-trois ans. Depuis leur premier concert au Bijou Theater de Dallas, en 1977. Et comme on le verra dans Neville sainte - Part Two, ils ont à leur actif une belle ribambelle d’albums extraordinaires.
Signé : Cazengler, vil brother
Charles Neville. Disparu le 26 avril 2018
David Ritz, Charles, Aaron, Cyril, Art Neville. The Brothers. Da Capo Press 2000
Neville sainte - Part Two

Grâce à Art qui depuis l’âge d’or des Meters a gardé des contacts dans le business, les Neville Brothers enregistrent leur premier album chez Capitol en 1978. Jack Nitzsche produit cet album sobrement intitulé The Neville Brothers. Dès «Dancing Jones», les Bros nous servent cette pop-funk de belle facture dont ils vont se faire une spécialité. Art, Charles, Cyril et Aaron chantent ensemble. On sent une tendance disköidale, mais l’ensemble se veut globalement pacifique. Ils jouent pas mal de cuts passe-partout, que Charles essaye de sauver en soufflant comme un dératé dans son sax. Il chaloupe les cuts à la manière de King Curtis. Les amateurs de grands horizons se régaleront d’«Audience For My Pain», un balladif qui s’étend bien au-delà du delta. On tombe en B sur «If It Takes All Night» et on reconnaît bien la patte d’Aaron, cet imparable séducteur. Un peu de New Orleans Sound avec «Vieux Carré Rouge», soulevé à la trompette de charmeur de serpent et puis «Ariane» sonne exactement comme la «Suzanne» du vieux Leonard qui lui aussi a cassé sa pipe en bois. Mais l’album ne marche pas.
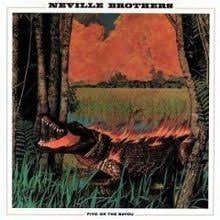
C’est bette Middler qui crie au loup, après les avoir vu jouer au Tipitina. Elle réussit à convaincre Jerry Moss, le boss d’A&M Records. Il confie à Joel Dorn le soin de produire leur deuxième album, Fiyo On The Bayou, enregistré à New York. Le titre s’inspire d’un cut qu’Art jouaient déjà avec les Meters. Sur la pochette, un gator en flammes sort du marais. Et pouf, ils attaquent avec «Hey Pocky Way», un groove swampy bien cuivré. Il s’agit là d’un groove unique au monde, chargé d’une musicalité extraordinaire, le symbole de la foison à gogo, un groove organique visité par les esprits. Leo Noncentelli gratte le funk sur sa guitare de Meter. On retrouve Cissy Houston et sa fille Whitney dans «Fire On The Bayou». Elles font le background, mais avec toute la clameur du gospel batch. L’impitoyable Fathead Newman prend des solos de sax à tous les coins de rue. Il remplace Charles, car Joel Dorn voulait des session-men accomplis pour cet album. En B, Dr John vient donner un coup de main sur «Brother John/Iko Iko», un joli groove battu aux gros tambours de Congo Square. Fabuleux, car squelettique et inspiré. Voilà une jolie pièce d’exotica. Mac est aux percus. Mais on le retrouve au piano sur «Run Joe», un groove joyeux de la Nouvelle Orleans. Quelle fantastique ambiance ! Ça saxe le jive de juke, pas de doute. Une fois de plus, nous voici rendus au cœur du meilleur groove d’Amérique, moelleux et moite, subtil et doux. C’est presque aussi capiteux qu’un groove des Caraïbes.

Keef déclara dans le magazine Rolling Stone que Fiyo On The Bayou était le meilleur album de l’année. Mais l’album ne se vend pas plus que le premier. De 1981 à 1987, les Neville Brothers n’ont pas de contrat. Personne ne veut miser sur eux. Trop inclassables. Ce sont les Stones et le Grateful Dead qui vont les aider en les faisant jouer et en partageant leur public - The Stones helped us a lot - Les Neville Brothers sont aux anges, car les Stones et le Dead nagent dans un océan de dope - The big turning point was the Dead. We did a New Year’s show with them that rocked the planet.
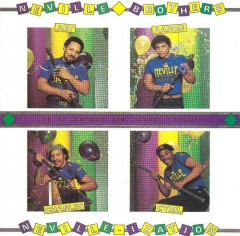
Premier album live avec Neville-ization paru en 1984. Aaron tape un «Woman’s Gotta Have It» au feeling maximaliste. Quelle voix ! Ce mec sait groover la moelle du chant. Il reprend plus loin son vieux hit miraculeux, «Tell It Like It Is», l’un des fleurons de l’âge d’or, romantique et duveteux comme une peau d’adolescente. Encore du groove de charme épouvantable avec «Why You Wanna Hurt My Heart». On entend rarement des grooves aussi décontractés. En B, ils font une fantastique version de «Caravan», le classique de la Nubie antique. Charles joue le solo de sax et derrière lui, ça fourmille de percus extraordinaires. Ils enchaînent avec un hommage à Big Chief Jolly Landry, leur oncle, dont on voit la canne dans les mains des quatre frères.


Deuxième album live en 1992 avec Live At Tipitina’s II. Ils tapent dans un gros classique de la Nouvelle Orleans, «Rockin’ Pneumonia & The Bugie Way Flu» de Huey Piano Smith, dans «My Girl» de Smokey, et font un petit coup de gospel batch avec «Riverside». Aaron enfile son costume d’ange pour interpréter «All Over Again» et «Wildflower», mais cet album cède un peu trop aux sirènes des années quatre-vingt.
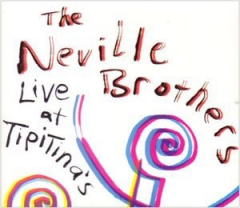
Ce live est ressorti sous le titre Volume Two, avec une set-list différente. Les Neville démarrent avec «Hey Pocky Way» monté sur le légendaire drumbeat que l’on sait, puisque c’est une cover des Meters. On sent la grosse machine à groover à l’œuvre. Les Neville sont comme des poissons dans l’eau du bayou, ils circulent entre les gators et Tony Joe White. Admirable pièce de jive. On trouve à la suite tous les vieux coucous, «Wishin’», «Rock’n’Roll Medley», «All Over Again» et un joli «Doo Wop Medley». L’empire des Neville s’étend aussi loin que porte le regard sur l’horizon du doo wop, hey hey hey. C’est une pure merveille. On peut faire confiance à l’ange Aaron. Les chœurs le suivent en enfer, ce chanteur est un don de Dieu. Avec «Wildflower», il descend dans le cercle magique du chant de rêve.
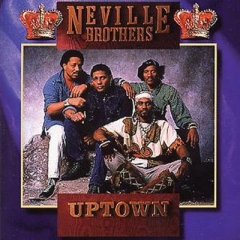
Alors n’ayons pas peur des mots, l’Uptown de 1992 est un album complètement foiré. On y entend du reggae à la mormoille et du synthé. On trouve un peu de good time music diskoïde dans «Shekanana» qui ouvre le bal de la B et par miracle, Aaron y ramène sa fraise d’ange de miséricorde. Ils reprennent un peu de poil de la bête avec «Old Habits Die Hard», un joli mid-tempo de charme, puis avec «Midnight Key», joué à l’énergie de la Nouvelle Orleans. La basse ronfle bien, mais les percus ont hélas un léger parfum diskoïde. Charles déteste cet album : «It was pretty fucking flat.» Il dit que le son de boîte a rythme et de synthé utilisé pour l’album était à ce moment-là déjà complètement dépassé.

Avec Yellow Moon paru en 1989, les pochettes commencent à virer au vaudou haïtien. Cette fois, le producteur s’appelle Daniel Lanois. Grâce à lui, ils reviennent aux sources, c’est-à-dire à l’Afrique, avec «My Blood» - Mother Africa - Ce groove des racines sonne comme une vraie bénédiction et s’orientalise même un petit peu. Lanois comprend parfaitement l’esprit musical des Neville Brothers. Ils jouent le groove des origines de l’humanité. Ils reviennent au calypso avec le morceau titre, un cut profond et comme visité par des sons libres comme l’air. Ils flirtent avec le vrai reggae, c’est-à-dire le reggae sourd. Ils tapent dans Link avec «Fire & Brimstone» et groovent le Wray de Wray en profondeur, sur un festival de basse signé Tony Hall. S’ensuit un hommage fabuleux à Sam Cooke avec «A Change Is Gonna Come». Aaron le chante de sa voix d’ange de miséricorde, et la magie s’installe pour quelques minutes. Ce chanteur extraordinaire peut aller swinguer des syllabes à l’octave. Ils finissent l’A en beauté avec une reprise de «With God On Our Side» du grand Bob. C’est d’une pureté inégalable. Le filet de voix d’Aaron scintille au firmament. Voilà pourquoi les Neville sont des géants. Ils créent de la magie. La B est hélas beaucoup moins dense. Ils l’attaquent avec «Wake Up», un groove qui file entre les genres et les époques. Au fond, on voit bien qu’ils n’appartiennent à aucune époque ni à aucune mode. Ils reviennent à Dylan avec «The Ballad Of Hollis Brown» et opèrent un merveilleux croisement des cultures. Quelle grande leçon de feeling !
Cet album fut celui de la consécration puisque disque d’or - The motherfucker is still selling today, nous dit Charles. Art apprécie surtout le respect que leur témoignent Jerry Moss, Herb Alpert et Al Cafaro, après trente ans de bricolage avec des labels locaux clochardisés.

Pochette vaudou pour Brother’s Keeper paru l’année suivante. Il s’agit là de leur meilleur album, ne serait-ce que pour «Bird On A Wire», un nouveau moment de magie pure. Aaron y fait vibrer ses notes perchées. L’autre coup de génie de l’album est le morceau titre. Aaron part en voyage dans un infini de beauté pure et ça vire à la merveille mélodique chantée à l’unisson du saucisson. Encore un coup de génie avec «Sons & Daughters», une sorte de victoire de l’esprit sur la barbarie, c’est-à-dire de l’esprit noir sur la barbarie blanche - You can’t stop runnin’ water/ You can’t kill the fire that burns inside/ Don’t ignore our flesh and blood/ Don’t forsake our sons and daughters - Eh oui, ils ont raison, on ne peut pas empêcher l’eau de couler ni éteindre le feu qui brûle à l’intérieur de chacun, alors il faut bien prendre en considération la chair et le sang des noirs d’Amérique qui n’ont jamais demandé à traverser l’océan. C’est une chanson éminemment politique, bien sûr. Aaron y décrit en trois lignes la vie d’un jeune black condamné à 352 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis, la taule d’Angola, les nuits sans sommeil, les champs de coton et de canne à sucre - Young man lands in jail for some crime he did not commit/ 352 years hard labor in Angola prison/ 352 years at hard labor/ Sleepless nights between sugar cane and cotton - Ils tapent aussi dans Link Wray en A avec «Fallin’ Rain» et se mettent au groove des Caraïbes avec «Steer Mr Right». On se pelotonne au creux du coude du fleuve. Aaron refait des étincelles de lumière avec «Fearless», il tape dans l’infiniment beau, c’est son dada. On ne se lasse pas de l’entendre chanter. On trouve aussi sur cet album visité par la grâce une belle reprise de «Mystery Train» traitée au groove de basse. Il s’agit là d’élégance à l’état le plus pur.
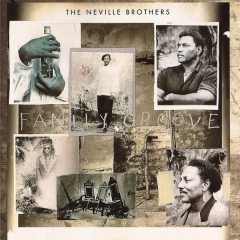
Fabuleuse pochette que celle de Family Groove : les photos des Brothers semblent dater du XIXe siècle. Ils attaquent avec une reprise du «Fly Like An Eagle» de Steve Miller, tapé en mode diskö-funk mais chanté avec le meilleur feeling d’Amérique. On passe aux choses sérieuses avec «Day To Day Thing», the real funk of New Orleans. Admirable, car chanté en duo avec des renvois. On sent le pouls du funk sous le vent, c’est tout le contraire du funk urbain, celui-ci se veut fruité, subtilement soutenu aux percus, à peine teinté de doo-wop et relevé par du xylo voodoo. Aaron prend «Take Me To Heart» de sa voix d’ange. C’est aussi pur qu’une balade océanique de Fred Neil. En B, on tombe sur le morceau titre, un groove funky admirable car joué au riffing réfractaire. Comme le cut refuse d’avancer, il se joue dans l’instant T du funk de base et ses veines se gonflent. Retour d’Aaron dans «True Love» pour une nouvelle échappée dans l’azur immaculé.
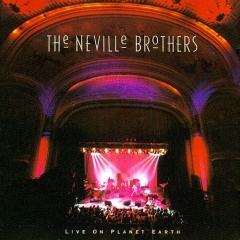
Tiens, encore un live avec Live On Planet Earth qui date de 1994. Quand on voit la pochette, on comprend que les Neville sont devenus une grosse machine. Dès «Shake Your Tambourine», on est saisi par l’énormité du son. Ils groovent à la vie à la mort, ça hurle et ça tambourine, on sent qu’on est arrivé à la Nouvelle Orleans. S’ensuit un fantastique «Voodoo» shaké aux congas de Cyril. Cet enfoiré sait créer un climat délétère. On est dans le meilleur groove du monde, n’ayons pas peur des mots. Charles souffle dans son sax. Aw my God, si vous parlez de groove, par pitié, mentionnez au moins le nom des Neville. Ils sont tout simplement fabuleux. Certainement l’un des meilleurs groupes de tous les temps. Encore du groove de rêve avec «The Dealer» et puis «Junk Man» arrive, monté sur une bassline de rêve, on croirait entendre des heavy dudes. Solo de sax signé Charles, le jazzman du gang. Cyril et Charles reviennent hanter «Brother Jake» et ils rappent un hommage aux femmes avec «Sister Rosa» - To my mother, my sister and strong women everywhere - Tony Hall, bassman de choc, emmène «Yellow Moon» au paradis du groove et on tombe un peu plus loin sur «Congo Square» - A place where American music was born, a place called Congo Square - Ils tapent ensuite dans Stephen Stills avec «Love The One You’re With» et enchaînent avec une autre reprise, «You Can’t Always Get What You Want». C’est assez réussi. Aaron chante aussi «Amazing Grace». Il règne dans sa version une émotion unique au monde - You’ve got the blessing - Sa voix se perd dans un halo de réverb boréale.

On retrouve tout le son de la Nouvelle Orleans dans Mitakuye Oyasin Oyasin/ All My Relations, paru en 1996 sous une belle pochette africaine. Ils attaquent avec «Love Spoken Here», bien sanglé au stomp des années 80, mais chanté par l’ange Aaron. C’est à la fois bon et cousu de fil blanc comme neige. «Holy Spirit» sonne comme un groove magique noyé d’orgue et de clap-hands. On voit le fleuve traverser la ville, c’est chanté au maximum des possibilités de la Soul, avec une puissance hors normes. Ils noient ensuite «Soul To Soul» dans le gospel batch. Ils sont puissants mais jamais ne se comporteront en seigneurs. «Whatever You Do» est trop syncopé pour être honnête. Ils visent le funk de l’être, avec les congratulations du style. Aaron revient sur le devant avec «Saved By The Grace Of Your Love» et tout redevient magique. Il éclate ses syllabes juste pour la beauté du geste. Il crée de la magie. Dès qu’il chante, le monde se met à vibrer. Charles part en solo de sax sur «Ain’t No Sunshine». Et bien sûr, Aaron éclate tout le cut au feeling pur.
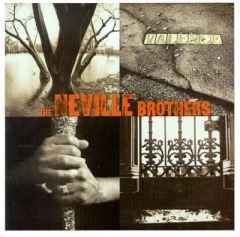
On trouve deux véritables coups de génie sur Valence Street, mystérieux album paru en 1999. «Little Piece Of Heaven» sonne comme un calypso magique, vu qu’Aaron le chante. Fin, tremblé et diaphane. Trop beau pour être vrai. Cet homme fait des miracles, il peut transformer la pop en vin et le son en pain. L’autre coup de génie est la reprise d’«If I Had A Hammer», le vieux cut de Peter Seeger popularisé par Trini. Aaron explose le Trini, il en fait une merveille d’anticipation de Congo Square. Il transfigure complètement ce hit connu comme le loup blanc des steppes pour en faire un chef-d’œuvre complètement libre, il chante tout à l’éclate de syllabes rondes et mouillées. Il liquéfie le groove. Avec «Real Funk», ils passent au vrai funk de la Nouvelle Orleans. Funk it up, baby ! Funk it off, funk it down in the neighborhood, c’est extraordinaire de stand it up, ils développent leur funk à coups de wha-wha. Aaron revient éclairer le monde avec «Give Me A Reason». On ne peut pas se lasser de son tremblé de glotte. On parle ici de préraphaélisme, il navigue dans les lumières voilées d’Edward Burne-Jones. Notons aussi le retour des grandes énergies de la Nouvelle Orleans dans «Over Africa», pourtant joué aux violents accords blancs.

Le dernier album studio en date des Neville Brothers s’appelle Walkin’ In The Shadow Of Life. Joli titre, typique du coin. Le morceau titre sonne comme un hit funk, c’est une vraie partie de rentre-dedans. Ces gens-là savent se confronter aux réalités. Quel shook de shake ! Pas de meilleurs funksters que les Neville Brothers. Ils enchaînent deux autres cuts de funk, «Poppa Funk» et «Can’t Stop The Funk» et tapent dans les Tempts avec «Ball Of Confusion». Les brothers Neville se mesurent à la royauté, mais Aaron mène la meute, alors ça se passe bien. On peut même parler de prise de pouvoir. Quelle version, and the beat goes on ! Ils sont dessus et ramènent du son. Ils passent au heavy sound avec «Streets Are Callin’» - It’s your business - Aaron s’y colle à la voix fêlée. Quelle rigolade ! - It’s your business/ better holler holler - «Carry The Torch» sonne comme un énorme hit de diskö-funk joué à la descendante - This young man he ain’t no plans/ Skulls and bones is all he knows - Aaron et ses frères donnent des conseils - And carry the torch of love in your heart - Fantastique ! Aaron chante «Brothers» en contrepoint et jette à nouveau toute sa lumière sur le monde - Come and walk with me/ We’re in this crazy world together - On le suivrait jusqu’en enfer.
Le monde enchanté d’Aaron solo fera donc l’objet d’une troisième partie en forme d’aller simple pour le paradis.
Signé : Cazengler, vil Brother.
Neville Brothers. The Neville Brothers. Capitol Records 1978
Neville Brothers. Fiyo On The Bayou. A&M Records 1981
Neville Brothers. Neville-ization. Back To Top Records 1984
Neville Brothers. Nevillization II - Live At Tipitina’s. Essential 1987
Neville Brothers. Uptown. EMI America 1987
Neville Brothers. Yellow Moon. A&M Records 1989
Neville Brothers. Brother’s Keeper. A&M Records 1990
Neville Brothers. Family Groove. A&M Records 1992
Neville Brothers. Live At Tipitina’s II. Stoney Plain 1992
Neville Brothers. Live On Planet Earth. A&M Records 1994
Neville Brothers. Mitakuye Oyasin Oyasin/ All My Relations. A&M Records 1996
Neville Brothers. Valence Street. Columbia 1999
Neville Brothers. Walkin’ In The Shadow Of Life. EMI 2004
Sur l'illusse de gauche à droite : Art, Charles, Aaron et Cyril
VINCE TAYLOR
L'ANGE NOIR
ARNAUD LE GOUËFFLEC / MARC MALèS
GLENAT EDITIONS / MAI 2018
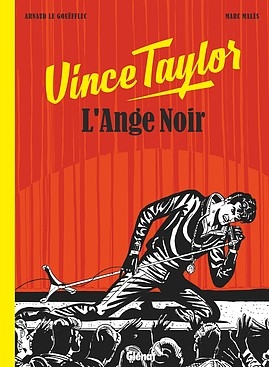
RAPPEL
Le dernier come-back de Vince Taylor de Jean-Michel Esperet ( in Kr'tnt !142 : 02 / 05 / 2013 ),
Vie et mort de Vince Taylor de Fabrice Gaignault ( in Kr'tnt 188 : 08 / 05 / 2014 ),
Vince Taylor n'existe pas de Maxime Schmitt et Giacomo Nanni ( in Kr'tnt ! : 25 /09 / 2014 ),
Vince Taylor, Le perdant magnifique de Thierry Liesenfeld ( in Kr'tnt ! 246 : 11 / 09 / 2015 ),
L'Être et le Néon de Jean-Michel Esperet ( in Kr'tnt ! 301 : 03 / 11 / 2016 )
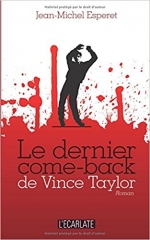
Vince Taylor n'en finit pas d'interroger notre modernité. Etrange de voir comment ce personnage si scandaleux et si vilipendé en son temps suscite encore fascination et émerveillements un quart de siècle après sa disparition. En son époque il fut stigmatisé comme le chanteur des blousons noirs, autant dire le rebut glaireux de notre société, ces rebelles qui n'avaient pour étendard que l'étamine de leur cuir noir, animés d'une colère que l'on définissait d'incompréhensible, alors qu'elle n'était que la manifestation de l'éternelle renaissance de la hargne des bagaudes et des partageux de tous les siècles, des dépossédés de toujours, à qui en cette aube des sixties l'on se préparait à tendre le plus odieux des pièges, celui de la renonciation de vos potentialités en échange de l'acquisition de dérisoires brimborions, manufacturés par le soin diligent de votre labeur. Le serpent qui ne crache plus son venin, se mord la queue. De poisson. De poison. Consommation, mon amour. Pour le désir vous repasserez, nous ne l'avons plus en rayon. Pour longtemps. Rock'n'roll, musique de cette frustration.
UNE BANDE DESSINEE
Deuxième bande dessinée consacrée à Vince Taylor, en noir et blanc. Une esthétique qui semble s'imposer d'elle-même. Mais un noir trop mat, indistinct en quelque sorte, qui donne à mon goût trop de valeur à la viduité d'un blanc clinique. Peut-être Marc Malès a-t-il voulu davantage signifier la cruauté entomologique de l'insecte sur la table de dissection que désigner le clinquant hétéroclite des sixties. Je préfère de loin la glaucité torve des gris de Giacomo Nanni du Vince Taylor n'Existe Pas. Mais ceci n'engage que moi, même si les goûts et les couleurs se discutent très bien.
ANTECEDENTS
Romancier, scénariste Arnaud Le Gouellec est aussi un amateur de rock. Ce qui ne l'a pas empêché de s'intéresser dans l'album Le Chanteur Sans Nom, illustré par Olivier Balez, à la vie de Roland Saville chanteur de charme masqué qui fut proche d'Edith Piaf – nous ne sommes pas loin de Vince. Tous deux ont récidivé dans le J'aurai Ta Peau, Dominique A, le lien avec Vince me semblant des plus fragiles...
BIO NON DEGRADABLE

La documentation sur Vince Taylor ( disques, photographies, films, articles de journaux, témoignages ) ne manque pas. A lire les premières pages, il semblerait qu'Arnaud Le Gouëllec ait fait le choix du récit chronologique, le bambin Brian s'amuse dans la cuisine près de maman. Ce qui est en même temps totalement vrai et complètement faux. Peut-être le problème s'est-il posé autrement dans la tête du scénariste, le long fleuve tranquille d'une vie mouvementée peut-il vraiment rendre compte de l'existence chaotique et tourbillonnante de Vince Taylor ! N'était-ce pas se confronter à un double déséquilibre, celui d'un début peu fulgurant, et d'une fin par trop triste, même si l'épisode acméen de bruit et de fureur au centre du bouquin ne manquerait pas de passionner le lecteur. Racine qui s'y connaissait quelque peu dans l'élaboration des tragédies n'a pas manqué de conclure son Andromaque par un épisode de folie dévastatrice...

Autre difficulté. Raconter équivaut à mentir. Puisque nous ne savons jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Arnaud Gouëllec n'a pas hésité, entre par effraction dans le crâne de Vince. Arnaud tend le micro à Vince et le laisse déblatérer. A sa guise. Le premier mot de Vince est bien l'affirmation du '' Je''. A partir duquel le jeu de la vie peut commencer. Mais c'est comme sur le divan du psychanalyste, les idées se bousculent, les images se superposent, les souvenirs arrivent en rafales, tout s'emmêle et se mélange. Le petit Holden écoute religieusement son grand-frère qui raconte ses missions de pilote durant le Blitz à Londres que déjà Vince est dans sa légendaire tenue de cuir noir, sur scène, en France... Vous ne savez pas mais le rock, c'est comme quand le rêve s'entrechoque dans les électrochocs du réel.
Les dieux de la Grèce antique nous l'ont appris, il ne saurait y avoir de cosmos apaisé sans l'antécédence d'un kaos génital. Les propos de Vince épousent un semblant d'ordre, le lecteur reconnaîtra les différences séquences, Londres sous la guerre, le départ pour l'Eldorado des States, les débuts anglais, la furia française, le long dérapage vers la mort. La Suisse finale hors de jeu tout de même.
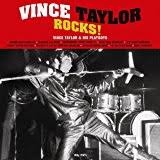
Et le rock dans tout cela. L'est donné en prime. Décor essentiel et subsidiaire, si le rock c'est ça, le ça ( groddeckique ) n'est autre que la folie fragmentatrice et dichoatomique de se vouloir être ce que l'on n'est pas, et même ce que l'on est. Question de va-et-vient entre soi et les autres. Erotisme sauvage et à l'arrache. Arnaud Le Gouëllec recherche les causes premières. Le rock en tant que seul bruit qui puisse recouvrir la peur panique du petit Holden terrorisé sous les bombardements londoniens. Le petit Holden ne réussira pas son brevet de pilote, mais il deviendra le hérock de sa génération. Plus il se traîne sur les plancher de la scène, plus il vole haut dans sa tête. Sa gestuelle féline, un démarquage des acrobaties aériennes. Loopings et piqués du pauvre !
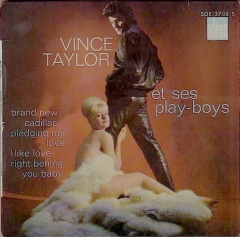
Sexe. Il serait difficile d'inscrire Vince Taylor parmi les précurseurs du féminisme. Pratique une sexualité brute. Revancharde nous explique Le Gouëllec, ces saletés de gamines qui se sont moqués de son peu de courage à sauter du plongeoir, n'en finiront pas de payer. Pas du genre à amadouer longuement la chatte des admiratrices avant de les pénétrer sans ménagement. Satisfaction primale du mâle. Vite fait, bien fait. Mal satisfaites. Un goût de goujat. Délicatesse porcine à balancer !
Drugs. Sans insister. Des médicaments d'inconfort qui vous confirment dans vos addictions. A votre vie. Car tout est là. Certains s'accrochent davantage que d'autres. Toutes les dérives tayloriennes, toutes les traboules vincenales, proviennent d'un fétus germinatif niché dans la cervelle, une espèce de cancer qui n'arrête pas de grossir. L a certitude d'être un être exceptionnel, d'avoir un destin – le dernier mot du livre – suffit de savoir lire les signes, in hoc signo vinces, et de se laisser porter par les évènements.
Un enthousiasme communicatif, une confiance absolue n'empêchent pas la peur. Vous prend et vous pend aux tripes. Comme la merde à l'anus. L'or noir du désir de l'envol conquérant vous pollue inexorablement l'existence. Vous vouliez soleil et vous appréhendez de n'être qu'une étoile filante. Vous vous mythifiez en ange noir du rock'n'roll et vous n'êtes que la chute d'Icare. Peter Brueghel l'Ancien vous avait averti, vous n'êtes que l'anti-pantomime exaltée et dérisoire de la médiocrité humaine.
Vince Taylor, vous n'êtes qu'une image fracassée de la démesure hominienne à vouloir égaler la puissance des Dieux, c'est pour cela que je vous révère. Rock'n'roll !
Damie Chad.
01 / 06 / 2018 / SAVIGNY-LE-TEMPLE
L'EMPREINTE
DOWNLOAD PROJECT # 3
U-BILAM / NAKHT
WILD MIGHTY FREAKS

15 / 16 / 17 / 18 Juin 2018, la fièvre monte dans les milieux métal, hard-core et assimilés, le Download Paris Festival ouvre ses portes à Brétigny-sur-Orge avec Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Foo Fighters et Guns N' Roses en tête d'affiche et plus de soixante groupes derrière, dont Laura Cox Band et Pogo Car Crash Control pour n'en citer que deux que Kr'tnt ! aime bien . En attendant ont été programmées trois soirées Donwload Project gratuites destinées à présenter la scène locale, à rameuter les fans et à faire monter la pression... le 06 avril au Rack'am de Brétigny , le 6 mai au Plan de Ris-Orangis, et ce 01 juin à l'Empreinte, trois lieux de concerts qui depuis des années accueillent et produisent ces formations extrêmement bruyantes... Beaucoup de monde donc, ce soir, plus de trois cents personnes, attirées aussi par le tirage au sort de pass pour assister au festival...
U-BILAM

Bulldozer. Rouleau compresseur. Sans concession. Impitoyable. Le metal dans toute sa lourdeur. Rythmique infernale. Un seul havre de paix dans ce tonnerre, un coup de caisse claire qui sonne comme un suicide, une fraction de seconde sauvée de l'écrasement du monde, mais ce n'est qu'une ruse machiavélique pour relancer la machine à détruire. Délire de triples croches comme grappins accrochés à la coque du dernier navire pour l'attirer au fond l'engloutir à tout jamais. Bilan très négatif quant à notre hypothétique survie terrestre quand vous entendez U-Bilam. La batterie comme un moteur à étouffements convulsifs. Propulse des ratées, des tassements, des entassements, des pulvérisations intermittentes de décombres, mais ce n'est pas le pire, comparé à ce qui suit c'est presque le bonheur. Les cymbales n'en finissent pas de tinter le froid de la mort, un glas cadavérique qui vous kriogénise avant que vous ayez eu le temps de respirer.
Basse et guitare de chaque côté de la scène comme zombies d'outre-tombe pour vous attendre à la porte du cimetière. La première perpétue l'agonie primale, la deuxième la l'accentue, toutes les deux ensemble tuent. Eclairs froids et découpages glacés, pas la moindre mélodie, pas la moindre harmonisation, des notes qui s'abattent comme des couperets de guillotine, des arbres qui craquent, qui tombent, qui s'entassent sans préavis et s'empilent sans fin. L'acoustique du néant vous abasourdit. Tornades de nuages de cendres à l'horizon immédiat. U-Bilam ne lambine pas pour vous apporter le spectre de la désolation.
C'est toujours dans les cas désespérés que certains en profitent pour faire pire que les autres. Une bête devant – ce n'est plus un homme – une force qui mugit. L'est le seul que l'avalanche sonore excite, se nourrit de catastrophes et il le clame sous les décombres. Hurle à la mort des étoiles qui s'éteignent une à une, entame une danse sauvage et frénétique, dans laquelle les deux cordistes le rejoignent, sautent de joie et piétinent allègrement vos dernières illusions. L'on entend les grognements et puis les grondements approbateurs de la foule dans la fosse aux lions sauvages qui commencent à se jeter les uns sur les autres. Car U-Bilam délivre une musique carnivore, qui pousse à la dévoration cannibalique, plus un gramme de chair, plus de nerf, juste l'empilement de squelettes de léviathans qui s'entrechoquent en un déluge vertébrique, pour signifier que plus rien n'existe si ce n'est le clapotement de l'univers qui se referme sur sa béance.
Trente minutes, montre en main, ont suffi à nos quatre cavaliers de l'apocalypse, aidé en cette sombre tâche par de simples samples, pour assommer le monde comme un goret à l'abattoir. Anéantissement terminal. Brutal.
NAKHT

Vous pensiez qu'il ne restait plus rien. Nakht est comme les pyramides d'Egypte. Immuable. Même l'éternité n'a pas de prise sur Nakht. Nakht a survécu. Pas pour rien qu'ils ont affiché le scarabée symbole d'immortalité comme logo en fond de scène. En rajoutent même deux moitiés en étendard flottant de chaque côté de la batterie derrière laquelle veille Damien qui tient ses baguettes croisées sur sa poitrine comme les insignes sacrés de pharaon. Silence sépulcral. Ce qui n'empêche pas la légion des damnés dans les abysses de s'agiter déjà. L'air se fait plus dense, lorsque le sample de l'intro s'élève majestueux tel la tête du cobra de l'uraeus gonflée de venin.
Christopher et Pierre, nouveau guitariste, ont droit à leur piédestal sur lequel ils se juchent, prêts à déclencher la foudre. Brusquement le néant se fissure et le monde devient plus noir, la cataracte Nakht s'envole, en tournoiements de vautours, et Danny bondit sur scène. Encapuchonné dans une espèce de sombre pèlerine médiévale qui lui donne l'aspect de la Mort, sans sa faux, mais armé d'un micro ravageur.
Est encore plus grand que d'habitude. Immense et gesticulateur, sa voix chargée de colère et de tonnerre. Ne cessera de hurler de tout le set. Dominateur et vindicatif. Incarnation magique de Seth l'épouvantable. Il apporte la couronne noire de la rage, la suffocation du dernier souffle et la gueule béante d'Apophis le bestial prêt à avaler le monde.
Damien démonise sa batterie, il est le soufflet de la forge et le battement intarissable du volcan cracheur de feu. Nakht est un bain de flammes lustrales qui carbonisent les volontés de ses fidèles, transformés en pantins mus par les commandements de Danny qui se ruent à sa guise les uns contre les autres, s'emmêlent et s'entremêlent, s'affrontent, s'éparpillent et tourbillonnent. Certains saisis par une transe collective sont jetés ou hissés sur la scène, Danny leur tend un bras secourable, ils dansent autour de lui, et puis ne supportant plus la présence irradiante du Messager se laissent happer par l'ombre marchante de leur destinée et plongent du haut de l'estrade dans la foule mouvante de laquelle ils refusent toute aide, car ceux qui ont approché la fournaise de Nakht n'ont désormais besoin de personne.
Des motifs orientaux se glissent tels des glapissements de chacals affamés dans les colonnes tumultueuses de la musique déferlante de Nakht. Toute supplique qu'on leur lancera ils l'avaleront, ne sont plus qu'un vestibule de désirs insatiables, descendront dans les abysses de votre âme et resteront à jamais enfermés dans la prison de votre esprit.
Ce soir Nakht a-t-il été divin ou dément ? Nous ne le saurons jamais. S'est répandu comme une nuée sanglante de soufre noir. Une pluie d'émotions et de beauté. Une brisure haletante sans défaut. Un grand groupe. Splendide.
WILD MIGHTY FREAKS

Après les deux tornades précédentes les Wild Mighty Freaks avaient intérêt à assurer. L'ont fait à leur manière. Troisième fois que je les vois, et trois apparitions différentes. Ne peuvent pas faire comme tout le monde. Commencent par rester dans les coulisses, dans le noir un grand écran blanc descend doucement et le clip de la tribu des monstres apparaît, un scénario improbable, mais ça remue salement, et la musique et les images. Une espèce de thriller incompréhensible, végétal et surréaliste,qui vous éclate le cerveau aussi sûrement qu'une capsule de LSD. Les cinq minutes de délire sont terminées. Noir total. Peut-être se passe-t-il quelque chose sur l'extrême-droite de la scène, mais je suis à l'extrême-gauche, maintenant l'est sûr qu'il y a une espèce de larve visqueuse qui rampe sur le plancher, la musique très forte, enfle, enfle, enfle, jusqu'à ce que dessus se greffe une voix splendide, moitié velours, moitié cactus, nous laissent encore dans l'expectative trois minutes et Crazy Joe entre enfin en scène micro en main. Une voix de maestro-caruso, un grain inimitable, Flex est à la guitare, Tonton à la batterie. La larve s'est enfin mise debout, s'occupe des samples. Juste le temps d'appuyer sur un bouton ou de pousser un curseur, prend le micro de temps en temps, l'est même douée mais ça ne dure pas trop longtemps. Comme s'il n'était pas du genre à abuser des bonnes choses. Le reste du temps que fait-elle ? Rien, elle déambule comme le balancier de la pendule. Le mec payé à ne rien faire. Mais il faut reconnaître qu'il le fait bien. Un cador. Une présence magistrale. Un look invraisemblable d'efféminé à queue de cheval qui ne se sépare jamais de son sac-à-dos, l'apparence d'un trans en partance pour on ne sait où, méfiez-vous, lorsqu'il tombera sa chemise il révèlera une musculature remarquable, toute l'ambiguïté provient de ce qu'il donne l'impression qu'il endosse son propre rôle qu'il est en train de se mimer lui-même, en fait c'est le seul musicos que je connaisse qui n'a pas besoin de jouer d'instrument, l'est son propre instrument, son corps lui suffit, il ne marche pas, il évolue, il ne se déplace pas, il danse sans prendre la peine d'esquisser un seul mouvement. Le gars qui marque des buts sans quitter le banc de touche.
Avec un tel zozo-zèbre surdoué les trois autres n'ont pas le temps à jouer les batraciens qui se dorent la pilule sur une feuille de nénuphar. Déjà ne sont que deux musiciens. Magnifiquement secondés par des samples certes, qui apportent au son une ampleur négligeable, mais question metal-music vous avez intérêt à aligner l'argenterie. Flex s'y emploie avec brio. N'est pas là pour assumer la rythmique. Son truc à lui, c'est l'apparition grandiose de Zeus tonnant sur son nuage, aux moments essentiels de l'action, vous envoie des riffs monumentaux, mortels comme les flèches d'Apollon qui anéantirent le redoutable Python. Autant le Yao se faufile l'air de rien sur la scène, lui fait tout pour qu'on le remarque, se campe au beau milieu, lève haut sa guitare, attend une semi-seconde de trop, genre attention les gars ça va tomber et il vous lâche une ondée dévastatrice à vous arracher les synapses. Saute aussi un peu partout, mouline comme un dératé, bref vous ne pouvez pas l'oublier.
Tonton – mais qui a pu donner un surnom aussi débonnaire à ce batteur à la frappe aussi dévastatrice ! L'est rivé à ses fûts, ne peut pas se permettre de grandes gesticulations, mais l'est le géant qui joue à la pétanque avec des icebergs. Tonitrue ample. Une frappe politique de celles qui bousculent l'establishment comme l'on dit. N'y est pas obligé mais apparemment ne sait pas faire autrement, éprouve la nécessité de couler un ou deux Titanic à chaque coup de heurtoir.
Vous entrevoyez le topo. Le boy qui se tortille comme une torpille au ralenti d'un côté, les deux forcenés qui vous catapultent si fort direct dans les oreilles que votre cervelle se retourne comme une crêpe dans sa poêle, ne vous inquiétez pas Crazy Joe va vous la saupoudrez au venin de mamba noir, et hop vous n'avez plus qu'à l'avaler tout chaud, tout brûlant. Excusez-moi dans mon émotion, j'ai oublié la moitié du mot, ne lisez pas hop mais hip-hop. Car non ce dingue de Joe ne djente ni ne growle comme un métalleux de base payé au smic sans prime de risque. Il hip-hope au delà de tous les espoirs de la hype. Attention pas un blaireau de rappeur qui vous découpe les syllabes une par une pour vous les présenter à la façon des tranches de mortadelle sous cellophane. Toute la différence entre un qui chante et beaucoup d'autres qui ânonnent comme à la maternelle. A gorge déployée. L'a des cordages vocaux en bronze, des filins d'acier flexibles et tenaces avec lesquels il vous ligote sans préavis. L'est et le serpent et le charmeur. L'empoche la salle dans sa poche en un tour de langue.
Les Wild Mighty Freaks font un triomphe. Plus que mérité. Une originalité certaine, metal tumultueux, hip-hop brillant, burlesque insidieux, z'ont plus plus d'une corde à l'arc de leur dé-lyre sonique. Superbe.
Damie Chad.
EVOLUTIONS OF MIND
U-BILAM
Z'ont apposé un sticker d'avertissement sur le plastique d'emballage, For fans of : Emmure – Attila – Whitechappel – Urbancore, vous voilà prévenus, si vous adorez Mozart et les petites musiques de nuit dites-vous que les légions des âges obscurs transbahutent une teinte de dark bien plus sombre.

Très belle pochette cartonnée, avec livret à l'intérieur est due à Etienne Hetzel et Océane Beci. Au dos un mur qui n'est pas sans rappeler celui du Pink Floyd ( curieuse référence ), mais d'un rouge pourpre, rideau de sang intérieur. Beau contraste avec la le bleu-nuit profonde du paysage de urbain dévasté qu'offre la couverture initiale. Belle image intérieure, feu de survie dans une ruelle déglinguée à l'image de notre monde.

Introduction : non précisée, mais qui servira de fil conducteur à cette évolution de l'esprit dont chaque morceau décrit une station. Une espèce de ritournelle grinçante qui vous met d'entrée mal à l'aise. Denied : La musique est beaucoup moins violente que le live. Pas mélodique mais lourdement obsédante. Mise un peu en arrière presque comme un contre-chant aux paroles, la primauté est donnée aux voix, des souffles d'ours inquiétants comme une menace mais qui ne sont que l'expression d'une profonde déréliction. Dialogue avec soi-même. Craintes et questions qui supposent dialogue intime et réponses. Guitares et batteries en sourdines prégnantes, le marécage des irrésolutions vous submerge. Une flambée de guitare sur la fin comme un fandango de désespoir. Anger : retour du motif en cavalcade cynique, la batterie écrase vos dernières espérances, une orchestration pesante qui ne couvre pas la voix qui crie, et le monde s'appesantit sur vous à la manière d'une camisole dont vous ne parviendrez jamais à vous dépêtrer. Un chuintement à l'oreille vous susurre que tout est fini, le leitmotiv se moque de vous, la voix grasseye de colère. Peine perdue. Se débattre tout de même. Expression : intro musicale obsédante à la manière des films expressionnistes allemands, les voix se rejoignent, celle vindicative qui dénonce et celle plus grave qui écrase tout. Se termine par un hachis final où chacun essaie de se reconstituer. Depression : beau comme une symphonie nihiliste, une prière métallique qui se subsume en cris de haine, un delirium vocal sans précédent, et une apothéose instrumentale crépusculaire, avec en dernier écho le rire cristallin et moqueur du motif introductif. Acceptance : le moment de l'acceptation. Souvent dans les scénarios des albums de metal l'on essaie d'offrir une fin sinon heureuse du moins empreinte d'une certaine sérénité. U-Bilam n'échappe pas à cette tentation. La modèrent toutefois par la puissance de la musique et la force du chant. Se méfient, ne sont pas naïfs.
Tous ces morceaux n'en forment qu'un. Forment une composition, aux thèmes savamment entremêlés. Le groupe fait preuve d'une finesse que le fort impact de sa prestation scénique ne laissait pas présager. Deux belles découvertes pour un seul groupe.
Damie Chad.
GUNS N'COOKIES
WILD MIGHTY FREAKS
Pochette ouvrante et cartonnée qui permettent de se faire une idées des tenues de scène arbordées par Wild Mighty Freaks. Indication d'importance le groupe est en train d'enregistrer un album.

The last time : rien à voir avec le titre des Stones, aucun morceau de l'EP n'est une reprise. Le son est assagi par rapport à la prestation live. Guitare et batterie ne rugissent pas autant et la voix de Crazy Joe et celle de Yao sont certes aussi belles mais il leur manque cette sauvagerie qui les porte et les propulse si haut sur scène. Freaks : grognements de gorets en début, et ensuite un flow assez délirant en lui-même, et Yao qui pousse la mémée du hip-hop dans les orties ulcérantes des refrains de la chanson populaire à vocation faussement mélodramatique, beaucoup d'humour et d'ironie, Crazy Joe vous enroule les R comme vous n'oserez jamais. Des monstres qui ne font pas peur, mais rire. Ce qui est parfois plus déstabilisant. Empty skies : démarrage en douceur, tout repose sur l'articulation plastico-phonique de Crazy Joe. Yao vous dessinent des arcs-en-ciel aussi veloutés que des dessins d'enfants, mais Crazy nous indique que la montée n'est pas aussi paradisiaque que cela. La pente s'avère plus abrupte que prévue et un brin décevante. Derrière les musicos ne vous tapissent pas le décor en rose bonbon. High : des arpèges de piano et montée progressive. Avec des paliers pour reprendre sa respiration, aïe; aïe, high ! Crazy Joe laisse la place à des chœurs emphatiques, mille violons électriques derrière, silence. Plus un bruit. Jungle : comme des cancannements de canards dans le tissu instrumental, erreur d'interprétation, Crazy Joe est perdu dans la jungle. L'on a l'impression vu sa colère qu'il se heurte davantage aux hommes policés qu'aux animaux sauvages. Des envolées instrumentales qui ne sont pas sans évoquer les Carmina Burana de Carl Orff, pour mieux faire ressentir la solitude et la lamentation du héros solitaire égaré dans la forêt carnassière de ses contemporains aux dents longues. Get out my way : six minutes de folie freakienne, tout le monde s'en donne à coeur joie. L'auberge espagnole du défoulement. Le meilleur de chacun, le morceau est bâtie en patchwork de montagnes russes. Vous permet d'entrevoir ce qui se joue dans les Wild Mighty Freaks sur scène, la musique qui fronce des vagues de colère, la voix qui aboie et s'éépanouit, d'incessants retours au calme pour mieux préparer la tempête.
Damie Chad.
RUN BABY RUN
2SISTERS
Désolé mais ce n'est pas un groupe de lesbiennes énamourées. Le disque ne conviendra pas non plus à Tante Agathe. Vous le comprendrez aisément à l'écoute, la fenêtre de réception du tir est étroite. 2Sisters c'est du bruit. Je n'ai pas dit du noise, que votre tympan sache faire la différence. Du bruit en barre. Directement importé de la ville aux moteurs qui flambent. MC 5 et Stoges dans le rétro et en ligne de mire. Des sauvageons prêt à monter sur le trottoir pour vous écraser, parce que sur les passages piétons ce n'est pas marrant.

Down : une voix féminine empreinte de douceur et caressante et mignonne en introduction. Profitez-en bien, parce que c'est la dernière que vous entendrez avant longtemps. Porte bien son titre, vous le descendent à bout portant, ne prennent même pas le temps de lui faire signer le chèque pour qu'il s'acquitte de la TVA des cartouches. Une tuerie de guitares au vibromasseur dans les oreilles et une voix enragée qui ne se la laisse pas conter, un pont instrumental explosé une ultime tuerie et c'est fini. Heureusement, vous n'auriez pas survécu davantage. Remember : souviens-toi de ce riff, z'ont peur que vous ayez la comprenette dure alors ils vous le répètent à foison et sans complaisance. Vous hurlent dessus et vous torturent avec le pique feu d'une guitare qui larsenne à mort et qui vous troue le cœur. Autre endroit aussi, si vous préférez. C'mon and dance / What have u done to me : commencent par le cri primal que l'on pousse généralement le jour de sa mort lorsque vous pénétrez par erreur dans la cage aux tigres. Vous n'êtes plus de ce monde et à la sarabande qu'ils mènent autour de votre cadavre il vous semble qu'ils vous le reprochent et qu'ils en sont tout de même heureux. Don't go : quelques voix de harpies, vous auriez bien envie de mettre les voiles, mais les 2Sisters s'acharnent à vous retenir. L'est sûr qu'ils ont des arguments contondants et que vous vous attarderiez bien mais vous savez qu'il ne faut jamais abuser des vilaines choses. Qui sont les meilleures. Zombie girl : méfiez-vous des filles, d'où qu'elles viennent elles provoquent de ces montées d'adrénaline que vous ne parviendrez pas à vous arrêter de crier et que si vous continuez les guitares y laisseront deux à trois cordes. Run baby ! Run : la vengeance des mecs, prenez une gerce et poursuivez-là de riffs monstrueux et de ricanements insidieux. Parfait pendant qu'elle hurle et piaille vous pouvez vous livrer à votre instrumental favori, un peu à la Link Wray, mais attention aux cramps sur les doigts. So fine : si bon, que l'on ne ne se retient plus, à fond les ballons dans les ouragans, le rock à la orang-outan dégoûtant, n'y a rien de mieux. Imaginez les Ramones, mais en beaucoup mieux. Johnny : tiens pour une fois la voix est mise en avant, c'est comme le choléra, ça ne dure jamais assez longtemps, alors les guitares vous pondent un solo aussi long qu'un œuf de ptérodactyle. Let me go : jungle-beat en folie, crème empoisonnée de guitare, vocaux urgentés, personne ne sait où ils vont, mais sont plus que pressés. Vous donnerez une image au batteur. L'a été particulièrement teigneux. I wanna be me : proclamation philosophique, les slogans les plus courts et les riffs les plus compressés sont les meilleurs. Quelqu'un au fond du studio a dû marcher sur la patte d'une guitare parce qu'elle s'est plaint violemment. Joker : le riff qui tue. 49 secondes un véritable serpent minute. En plus il y a un inconscient qui rit bêtement sans mettre se rendre compte qu'il ne luis reste plus que onze secondes à vivre. Baby wants some R'N'R : les vérités élémentaires doivent être inculquées avec force et brutalité. C'est la seule manière pour que l'humanité comprenne que sans le rock'n'roll elle est perdue. Les 2Sisters excellent en cette saine pédagogie. Leave me be : tiens le morceau le plus long du disque. L'est difficile de déterminer entre la voix et la guitare celle qui crie le plus. Relancent le concours. Ex-aequrock toutes les deux. Un accessit à la cymbale du batteur qui frétille comme une rabote. Wake up : s'il y a encore un gars qu'il est besoin de réveiller après cette tornade, vous me permettrez de douter de l'humanité.

Si vous aimez le rock, ce disque est indispensable. Dans le cas contraire allez vous faire foutre !
Damie Chad.
JAZZ MAGAZINE & CO
N° 705 / MAI 2018

Le titre m'a attiré : 1958 – 1968 De la folie du hard-bop à la révolte free, cela tombait bien, j'avais envie de lire quelque chose sur le free. J'ai déchanté à la maison. Z'avaient oublié de préciser le lieu : Paris. Zut moi qui croyais me retrouver à New York ! Remarquez ce n'est pas inintéressant, même marrant, les gars qui racontent leur rencontre avec le jazz et leurs premiers concerts in the capitaloso parisiano. Leurs difficultés à se procurer des informations, les galères de galettes introuvables, les rares émissions radio qui passaient leur musique préférée, tout à l'identique des rockers de l'époque, souvent branchés sur les mêmes stations, mais pas aux mêmes heures... un petit détour aux States avec Archie Shepp et ses visites à John Coltrane, et tout de suite après, l'on passe la frontière, dans le monde connu du rock, une double page sur l'année 1968 et la naissance de la Pop, et ensuite les chroniques de disques habituelles dans une revue musicale. De toutes les manières, ce n'est pas de cela dont je voulais parler.
Elle pèse la revue me suis-je dit en la retirant du rayonnage et instinctivement je retourne le package, péril jaune en la demeure, les Rolling Stones me tirent la langue. A moi qui ne leur ai rien fait. Je reconnais l'arme du crime. L'avais eu entre les mains en ce dernier octobre de l'automne 17, le numéro Spécial Rolling Stones de Jazz Magazine, m'étais dit qu'ils devaient avoir des problèmes de trésorerie pour qu'une revue de jazz se permette un fascicule de 100 pages sur the greatest band of rock'n'roll on the earth. N'ont pas tout vendu apparemment, vous le refilent en prime pour deux euros de plus avec leur 705...
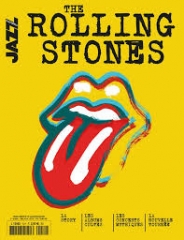
Le numéro a été conçu par l'équipe de Muziq – rappelons que cette revue fut créée à l'instigation de Frédéric Goaty qui est secrétaire de la rédaction de Jazz Magazine. Mensuel apparu en 1954 et qui fusionna et absorba en son sein la revue Jazzman née 1992 en tant que supplément du Monde de la Musique émanation en l'an grâce 1978, du journal Le Monde et de l'hebdomadaire Télérama. Continuons à ouvrir les tiroirs, Télérama appartient aujourd'hui au groupe Le Monde après avoir longtemps fait partie de La Vie Catholique. Des gens qui a priori n'éprouvent aucune sympathie for the devil. Le groupe Le Monde qui a pris le contrôle des publications de La vie Catholique est détenu par Xavier Niel ( Free ) et Mathieu Pigasse ( Banque Lazard, Les inrockruptibles, Radio-Nova … )... Je vous laisse découvrir les ramifications de l'iceberg... Quand je pense que nous, pauvre vermisseau Kr'tnt, n'avons même pas un actionnaire et que nous sommes dans la main de notre hébergeur Talkspirit comme la mouche accrochée à sa toile d'araignée, et que Talkspirit provient de l'initiative de Philippe Pinault directeur financier de Natifix, je me dis que rien n'échappe aux tentacules de la pieuvre...
Damie Chad.