KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 452
A ROCKLIT PRODUCTION
20 / 02 / 2020
|
HILLBILLY MOON EXPLOSION / TIMMY'S ORGANISM NICK TOSHES / JEAN-MICHEL ESPERET BLOOD AXIS |
Rock on the Moon Explosion

Les Hillbilly Moon Explosion ne facilitent pas les choses. Ils restent assis le cul entre cinq chaises : rockabilly, pop, fado, blue beat et western spaghetti à la sauce tomate. Ça tombe bien, vu qu’ils se réclament du melting pot. Ils passent d’un genre à l’autre sans coup férir et ne s’en sortent que parce qu’ils tiennent la dragée haute à la versatilité des choses.

Le fan de rockab se régale sur deux ou trois prestigieuses flambées, et même les deux big boogie blasts qu’Oliver Baroni prend au chant, mais ce même fan fait la grimace quand Emanuela attaque la cover d’un hit pop à la mormoille, du style «Call Me» de Blondie. Elle use et abuse du petit sucré de sa voix et frôle la catastrophe quand elle va chercher le chat perché de l’archiduchesse archi-chèche.

Par contre, elle met l’assemblée à genoux avec une brillante reprise du «Baby I Love You» des Ronettes. Elle s’y révèle spectaculairement juste. Elle tape en plein dans le mille et recrée la magie de ce vieux hit jadis imaginé par Phil Spector. Elle y passe en plus un mini-solo de scuzz fuzz sur sa mini-guitare customisée à paillettes. C’est sa façon d’en boucher un coin à tous les mauvais coucheurs.

Dommage que l’Anglais Duncan James ne chante pas plus souvent. On le voit faire son cirque au fond de la scène, avec ses faux airs de Christopher Lee. De la même façon que les Cramps se voulaient a eight-legged bopping machine et les Wildhearts a seven-legged rocking beast, les Moon Explosion se veulent the eight-legged melting pot aux roses. Les poins forts du set sont l’excellent «Live The Life» monté sur le riff de «Please Don’t Touch», chargé de rockab comme une mule, et «The Long Way Down», capiteux mélange de fado et de beat rockab. Ils tapent dans le garage avec «Down On Your Knees» et le heavy rumble de rockab avec «You Miss Something You Never Had». Et puis bien sûr les hot shouts d’Hooky Lee Baroni, «Heartbreak Boogie» et «Love You Better».

C’est avec leur rappel qu’ils finissent d’enfoncer le clou de leur melting pot et qu’ils emportent la partie haut la main. Et même très haut la main. Après «Baby I Love You», ils nous emmènent à la fête foraine pour un petit tour d’«Enola Gay» et Emanuela conclut avec une rengaine portugaise d’une infinie mélancolie. Alors on dit : «Chapeau !». Force est de s’incliner jusqu’à terre devant la manifestation d’un tel panache. C’est un peu comme s’ils effaçaient le souvenir des toutes ces premières parties qui nous parurent jadis si peu convaincantes.

Alors du coup, on ressort les albums de l’étagère, histoire de bien remettre les pendules à l’heure. Le tout est de savoir si on commence par les pires ou par les meilleurs.Tiens, les pires. On en dénombre deux : Damn Right Honey et French Kiss. Des deux, le moins pire est sans doute le premier.

Leur version de «Perfidia» sauve les meubles. C’est le hit d’exotica le plus exotique de l’histoire de l’exotica. Par contre, les photos du livret ruinent tout. Ils se prennent tous les trois pour des rock stars hollywoodiennes et le côté dérisoire de la démarche passe complètement à la trappe. Dommage, car ils attaquaient avec «Drive This Truck No More», big cocktail de heavy beat rockab et de voix sucrée. C’est un cocktail qui présente l’immense avantage d’être unique au monde. Alors ils en profitent. Ils adorent leur formule. Ils la peaufinent. Ils lui donnent les atours d’une princesse et font même entrer des cuivres sur le tard. Avec «Cool String Breeze», ils partent en mode cajun. Ils bouffent à tous les râteliers et pensent même à ramener des violons. Il n’y a pas de train dans leur «Westbound Train». C’est un pétard mouillé, une fausse alerte, avec cette voix qui refroidit au lieu de réchauffer. C’est leur problème numéro un. Elle peut glacer les sangs. On ne devrait pas dire ça, mais c’est une réalité. On claque des dents dès qu’elle arrive. C’est Oliver Baroni qui réchauffe l’album avec ses petits exercices de style en mode rockab. Puis on les voit se vautrer avec une reprise d’«I Hear You Knocking». Ils auraient mieux fait d’éviter de toucher à ce truc là. Il appartient à Dave Edmunds. Ils le massacrent, ils jouent la carte d’un mauvais son alors que Dave Edmunds y faisait au contraire des miracles. On atteint le comble le l’horreur avec «Motorhead Girl». C’est grotesque. Elle n’a aucune crédibilité. Ils sont à dix mille années lumières de Motörhead, même si sur scène elle porte un T-shirt Motörhead. Leur pop fait insulte à la mémoire de Lemmy. Heureusement, Sparky de Demented Are Go vole à leur secours avec «Northern Crown». Il les sauve du naufrage à coups de yeah yeah. Il surgit hors de la nuit pour zébrer d’un Z qui veut dire Zorro un album affreusement putassier. Sparky chante son gut out, c’est lui qui redore le blason de la Suisse, du chocolat blanc et des horloges en bois. Fabuleux Sparky ! Vas-y mon gars !

Et tout s’écroule avec French Kiss, qu’ils ont enregistré en collaboration avec Arielle Dombasle. Ça commence assez mal, avec un «Walk Italian» chanté à deux voix sur un beat rockab arrosé de trompettes blue beat. Certain disent : «Quel drôle de mélange !», et d’autres : «N’importe quoi !». Puis ça se gâte atrocement avec «My Love For Evermore». Les Hillbilly y coulent une réputation durement acquise. Les amateurs de rockab ne leur pardonneront jamais cette tarte à la crème. On descend encore dans l’horreur avec «Johnny Are You Gay». Rien qu’avec le titre, on frise l’indisposition. Ils ne se rendent plus compte de rien. L’appât du gain ? Allez savoir. Il faut surmonter une sorte de nausée pour continuer à écouter ce truc là. Jamais Jake Calypso ne se serait prêté à une telle mascarade. Au passage, ils réussissent même à massacrer le «Chick Habit» de Gainsbarre et se vautrent dans la médiocrité avec «Westbound Train». Tout sens artistique semble avoir disparu. Ils font même de la diskö avec «I’m Gonna Dry My Eye». Mettez-vous à la place des fans de rockab qui écoutent ça. Il y a de quoi sortir le fusil de chasse pour tirer dans le disk à bout portant. Baroni essaye de sauver l’album avec «Maniac Lover», et c’est tout à son honneur.

Après le musée des horreurs, voici venu le temps des splendeurs, avec notamment l’effarant Sparky Sessions paru l’an passé. Oui, Zorro Sparky déjà venu à leur secours au temps des calamités et qui avec cet album redore le blason du rockab contemporain. L’album est une bombe. Il faut aller directement sur «Stumble Through The Darkness», monté sur un riff de hard boogie et ce démon de Sparky rôde à la surface en poussant des yeah yeah yeah. On assiste à une fabuleuse descente de slap dans le boogie. Pure genius ! Ils font du deep throat slappé dans l’âme. L’autre coup de génie s’appelle «Can’t Take My Eyes Off You». C’est un vieux hit rococo de l’âge d’or - You’re just too good to be true - Ils rendent un bel hommage à cette merveille - I love you baby - C’est demented are go à gogo ! Ils remontent aux sources des Four Seasons et des Supremes, et ce démon de Sparky explose les sources. Ils terminent cette stupéfiante cover en mode apocalyptique. Autre reprise de taille : le «Baby I Love You» qu’Emanuela chantait en rappel, sur scène. C’est là où les Athéniens ooh-oohtèrent, elle rentre dedans comme dans du beurre et Sparky fait l’ogre au coin du bois. Ah comme c’est powerful ! Elle fait Baby I love you et Sparky fait c’mon baby. Il rentre dans le lard du couplet 2 avec une grosse voix d’Hulk atroce, mais quelle grandeur ! Tiens, encore une reprise spectaculaire : «Jackson». Pas un hasard, Balthazar, si Mr. G l’a programmé dans son mighty Dig It radio show. C’est une cover de premier choix, l’une de celles qu’on oublie pas. Belle version un peu blue beat, avec un Sparky éclaté au chant derrière Emanuela, le tout servi sur une solide pulsion rockab. À noter aussi un excellent «Broken Love» d’ouverture de bal et un beau hit rockab, «Teddy Boy Flick Knife Rock ‘N’ Roll». Sparky donne la réplique à Oliver Baroni, aw c’mon et Duncan James circoncit bien son solo jazz.

Très bel album que ce Buy Beg Or Steal paru en 2011, ne serait-ce que pour «She Kicked Me To The Curb», gorgé de tout le power rockab. C’est le boogie d’Oliver Baroni. Ce mec est excellent, il slappe son boogie jusqu’à l’os de l’ass et il manie bien les ding-a-ding-a-ding-a-ding de relance rockab. Autre énormité : «Goin’ To Milano». Ce slappeur né qu’est Baroni veille au bon grain de l’ivresse. C’est chanté à l’arrache, celle qui décolle le cut du sol. Magnifique élan digne de Tav Falco. Même genre de kitsch, avec ce mélange sucré salé qui fait la spécificité des Moon Explosion. Duncan James passe même un solo gras, histoire de. Emanuela finit par devenir érotique. Avec «Natascia», elle nous replonge dans un kitsch de tango à la Tav Falco et Duncan James illumine le tout d’un solo jazz. L’autre coup de bluff de l’album, c’est le fameux «Enola Gay» d’Orchestral Manœuvres In The Dark joué aussi en rappel sur scène. Ils nous emmènent à la fête foraine. C’est jumpé dans l’ass de la radio et ça dégage autant qu’un hit des Ventures, bien claqué par Christopher Lee. Oh on trouve d’autres bons cuts sur cet album, tiens par exemple le morceau titre d’ouverture de bal, monté sur une impeccable rythmique rockab. On peut dire la même chose de «Trouble & Strife». Ils sont toujours dessus et elle est toujours devant. Sparky vient faire le con dans «My Love For Evermore» et Emanuela finit par emporter la partie avec ses élans nubiles dans «Imagine A World». C’est terrifiant de présence humide. Elle drive aussi avec tact «Touch Me» et porte le kitsch nubile au délire, bien aidée par la coulée jazz de Duncan James. Il fait aussi un carton avec «Chalk Farm Breakdown», monté sur une sorte de big Memphis beat, avec un slap qui prédomine effrontément.

Autre album de poids : With Monsters & Gods, paru en 2016. On y dénombre pas moins de cinq pures merveilles, à commencer par «Depression», bien slappé derrière les oreilles. Ils virent ensuite garage avec «Down On Your Knees». Ils savent allumer la gueule d’un cut, même à la voix sucrée. Pas de problème. Ils nous sortent ici un vrai hit de juke. Retour au big rockab avec «Desperation». Baroni nous claque ça sec et net et sans bavure. Ils restent dans l’énergie du son pour «Love You Better». Baroni adore rocker le boogie dans l’os. Bel hommage à Hooky, the king of it all. Retour au big romp de rockab avec «You Miss Something You Never Had», une sorte de clin d’œil à Eddie Cochran monté sur un heavy drive rockab. On trouve aussi sur cet album la reprise de «Jackson» chantée en duo avec Sparky. «In Space» fait aussi dresser l’oreille car l’ambiance rappelle un peu celle du beat monster de Carter USM. Il faut cependant faire gaffe à ne pas trop glorifier Emanuela sur ce coup-là, car ça ne lui rendrait pas service. D’ailleurs, elle exaspère un peu sur «Temptation». Elle sucre un peu trop les fraises du Hillbilly. C’est à la fois ravissant et insupportable. Plutôt que de choisir Emanuela, les Moon Explosion auraient dû choisir Dusty Springfield ou Cilla Black. Le problème d’Emanuela, c’est qu’elle a parfois tendance à se prendre pour une femme fatale, une sorte de Diana Ross, mais si nos souvenirs sont exacts, ce n’est pas Diana Ross qui fit la grandeur des Supremes, mais Florence Ballard. Avec «Midnight Blues», ils jouent la carte Moon Martin, et le morceau titre nous renvoie aux délices du thé dansant. Retour fracassant au boogie avec «Heartbreak Boogie» et c’est hélas sur cet album qu’on croise la reprise de «Call Me» qui nous fit horreur lors du concert. Mais l’un dans l’autre, c’est un excellent album.

Tout aussi excellent, voici All Grown Up qui date de 2007. On peut y aller les yeux fermés. Dès «Need You To Stay», on sent l’omniprésence du blue beat, cette espèce de beat précipité qui finit par devenir captivant. On retrouve aussi le «Live The Life» qu’ils jouent sur scène, monté sur le riff de «Please Don’t Touch» et embarqué à la belle ferveur rockab avec des cuivres à gogo. Ils restent aux frontières du blue beat. Autre cut interprété sur scène : «The Long Way Down», un mélange de fado et de beat rockab. Elle chante ça à la langueur monotone et c’est excellent. Ils doivent être les seuls à savoir servir un tel cocktail. Il faut dire que d’album en album, Emanuela grandit et finit par impressionner. Ils jouaient aussi «Brow-Eyed Boy» sur scène. Elle drive cette merveilleuse petite pop à la plaintive convaincue. En réalité, les Moon Explosion sont un groupe très ambitieux et ils savent se donner les moyens de leurs ambitions. Après Eddie Cochran et Johnny Kidd, ils rendent aussi un superbe hommage à Buddy Holly avec «Tornado». En B, elle se couronne impératrice de l’exotica avec «Bamboo». Elle sait tirer ses s de fins de syllabes et chalouper des hanches sur un air de cha cha cha. Encore une belle aventure de beat rockab avec le morceau titre de l’album. Voilà leur formule gagnante : heavy beat rockab zurichois nappé du sucre d’Emanuela.

La pochette de leur premier album, Introducing The Hillbilly Moon Explosion, est assez bizarre : le logo est monté derrière le cul d’Emanuela. On dirait qu’elle est en train de péter. Mais elle reprend vite le contrôle de la situation avec le «Chick Habit» de Gainsbarre, jadis repris par April March et encore avant sanctifié par France Gall. Il s’agit bien sûr du hit yéyé «Laisse Tomber Les Filles». Alors Emanuela nappe de sucre le heavy beat rockab d’Oliver Baroni. Pur jus de petite greluche sucrée, c’est en plein dans l’esprit bien frais des bonbons à l’anis, et même assez pointu dans le suggestif. Et puis Oliver Baroni revient tout démolir avec ce qu’il faut bien appeler un hit rockab : l’implacable «Maniac Lover». Ce mec est assez authentique, il sait driver son truc. On peut même le taxer de slappeur fou, ça ne lui fera pas ombrage. Il sait amener son Lover. Admirable bravado. Côté reprises, on a une autre bonne surprise : le «Remember (Walking In The Sand)» des Shangri-Las. On entend même les mouettes. Les Moon Explosion soignent bien les détails. Ils savent charger la mule du pathos. Emanuela fait sa Mary Weiss et bizarrement elle bouffe le cut tout cru. Ils montrent qu’il savent faire du swing avec un «Raw Deal» bien paradoxé dans l’os du crotch. Oliver Baroni dispose de réserves naturelles aussi importantes que celles de Brian Setzer. Rien n’est plus difficile à réussir que les coups de swing. Ils repartent en mode Emanuela avec «I’m Gonna Dry My Eyes». Elle gère ça au petit sucré des fraises de sa jeunesse. Elle peut vite devenir pop, au sens de l’égérie. Puis ils nous resservent l’horrible «Johnny Are You Gay» qui sonne comme une vieille freluquette de Richard Anthony, une espèce de vieux twist bizarre monté sur le beat de Moon habituel. On se croirait dans une surboom des early sixties. Ils savent aussi manier le groove, comme le montre «All She Wants». C’est même une merveille de slop de slap. Back to the big ferveur avec «All I Can Do Is Cry» : mélange habituel de beat explosif et de sucre. Comme si Emanuela montait un taureau pour essayer de le dompter. Ah elle est bonne à ce petit jeu là. On garde le meilleur pour la fin : «Clarksdale Boogie». Oliver Baroni nous fait du Hooky pur et dur. Il a compris que le rockab et le boogie puisaient dans la même énergie, mais le boogie peut être encore plus hot, all nite long ! Voilà le pur jus de Baroni. Comme Jake Calypso, il connaît tous les secrets de la Mirandole. Il amène ça doucement à l’autel. Tu veux communier ? C’est là - Everybody boogie all nite long - Bien vu, Lord Baroni !

Encore un big album avec Bourgeois Baby qui date de 15 ans déjà, puisque paru en 2004. C’est même un album qui déborde d’énormités, à commencer par l’infernal «XKE», avec une Emanuela à dada sur le heavy beat rockab habituel. Elle finit par t’enlasser la cervelle. Le sucre se marie bien au beat et c’est même assez demented, comme dirait Sparky. Elle finit en vocalises de foolish girl. Le mélange du sucre et du bop fonctionne ici à merveille. On voit aussi qu’avec le morceau titre, Oliver Baroni sait pulser son train-train. Il passe ensuite au boogie à la Hooky avec «Dead Cat Boogie». Emanuela a raison de chanter qu’elle est une real kool kitty dans «Real Kool Kitty», car c’est vrai, et puis on prend en pleine gueule une grosse giclée de rockab avec «Get High Get Low». Hard beat on the run, comme dirait McCartney. C’est le Baroni de l’An Mil qui bat le beat pur et dur. Il est dans l’énergie du bop de base, il sait ravaler une façade, aw baby let’s get high. Excellent, pulsé au meilleur beat de rockab moderne. Puis ils passent au groove de round midnite avec «How Can You». Ces gens-là savent tout faire. Elle sait entrer dans le chant avec le meilleur tranchant possible. On la voit plus loin driver le mambo italiano de «Mambo Italiano». Elle y shoote toute sa gouaille de demented craze. Encore un fabuleux shoot de boogie rockab avec «Holy Coochie Coo». Il y mettent tout leur gut d’undergut et c’est peut-être là qu’ils se distinguent le plus, sur le boogie rockab qu’Oliver Baroni joue à l’exacerbée. Ils n’ont aucun problème. Ils sont très forts, il faudrait les féliciter. One two three four ! Et voilà «Boy In Blue», une virée à perdre haleine, nouveau shoot de rockab craze avec une Emanuela qui entre au ralenti dans le bop du moon. C’est très réussi. Et ça finit comme ça doit finir, avec un «Many Years Ago» en forme de groove de jazz de round midnite. Elle est juste, incroyablement juste.

L’air de rien, By Popular Demand figure parmi les bons artefacts de l’Explosion, rien que par la présence de ce «Spiderman» monté sur un vrai beat roackab et joué à la tension maximaliste - Look out/ Here comes Spiderman ! - Emanula fait son retour aux affaires dans «Nobody’s Babies», une samba rockab qui s’étend jusqu’à l’horizon. On comprend que le suave aigu de sa voix puisse ne pas laisser indifférent : soit on adore, soit on déteste. Ils retapent dans Gainsbarre avec «Pouppée (sic) De Cire Pouppée (sic) De Son». Ils savent parfaitement shaker les genres dans leur shaker d’argent : beat + rose bonbon, sucre + organdi. Elle fait bien sa France Gall. Ils claquent un «Won’t Somebody Love Me» au banjo punk et drivent «Bad Motorcycle» au bah-bah-bah ventre à terre. C’est très spectaculaire. Ils rendent aussi hommage à George Harrison avec un «Holy Hoochie Coo» qu’ils sous-titrent «1961 George Version». Si ces Moon Explosion n’existaient pas, il faudrait les inventer.
Signé : Cazengler, Morve explosion
Hillbilly Moon Explosion. Le 106. Rouen (76). 17 janvier 2020
Hillbilly Moon Explosion. Introducing The Hillbilly Moon Explosion. Crazy Love Records 2002
Hillbilly Moon Explosion. Bourgeois Baby. Crazy Love Records 2004
Hillbilly Moon Explosion. By Popular Demand. Crazy Love Records 2005
Hillbilly Moon Explosion. All Grown Up. Not On label 2007
Hillbilly Moon Explosion. Buy Beg Or Steal. Jungle Records 2011
Hillbilly Moon Explosion. Damn Right Honey. Goldtop Recordings 2013
Hillbilly Moon Explosion. French Kiss. Mercury 2015
Hillbilly Moon Explosion. With Monsters & Gods. Jungle Records 2016
Hillbilly Moon Explosion. The Sparky Sessions. Jungle Records 2019
Lampinen ne lampine pas
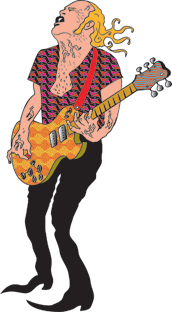
Timmy Lampinen ne traîne pas en chemin. On le sait depuis le temps des mighty Clone Defects, dont les deux albums ont sonné quelques cloches à la volée. Le bordel a commencé avec Shapes Of Venus, paru sur In The Red Recordings. Il fut un temps où on ramassait systématiquement tout ce qui sortait sur In The Red. On faisait aveuglément confiance à Larry Hardy, mais en 2002, il rompit le contrat de confiance en sortant l’album pourri des Piranahs, Electric Grit Movies. Après il fallut trier. Shapes Of Venus sortit vainqueur du tri.

Avant même d’avoir commencer à jouer, Tim Lampinen a tout bon : il vit à Detroit. Et pour entériner l’affaire, Shapes Of Venus sent bon la stoogerie. Les Clone enchaînent trois cuts qui pourraient sortir de Raw Power : «Stray Boy», «Still Poor» et «Fill My Fridge» - I’m a stray boy looking for you - On croit entendre le fameux walking cheetah with a heart full of napalm de «Search And Destroy». Tim martèle bien sa stoogerie. Et ça continue avec «Ain’t No New Buzz», un cut qu’Iggy aurait pu enregistrer à l’âge d’or. Avec «Rabid Animal Detector», l’indicible Tim passe au heavy blues de blues rock psyché-psycho, celui du Michigan, le plus chargé du monde. En B, les Clones vont plus sur la pop. Ils semblent s’intéresser à un pan considérable de la pop culture. Avec «Calm You Down», ils sonnent comme les Heartbreakers : même énergie, même sens du low-down. S’ensuit un «I Rock I Ran» battu comme plâtre, gorgé d’énergie, énorme shout de blasting brew. Quel album !

Ce n’est qu’un peu plus tard qu’on a découvert l’existence d’un autre album des Clone Defects, Blood On Jupiter, qui est antérieur à Venus. Et là, attention ! C’est du Detroit Sound gicleur ! On voit dès le morceau titre qui ouvre les hostilités que c’est battu à la sévère. Timmy et ses sbires sont des brutes ignobles. Ils attaquent à la manière du MC5, mais avec encore plus de sauvagerie. Ce Lampinen est un fou dangereux. Il faudrait que quelqu’un téléphone là-bas à Detroit pour demander à le faire enfermer. Il fabrique une sorte de frichti de garage épouvantable. Aucun barrage ne peut endiguer sa purée, même pas celui de Marguerite Duras. Il sort une purée à la fois fluctuante et complètement défenestrée. Il prend plus loin «Don’t Care If You Come» au pire boogie blast de Detroit. Il ne recule devant aucune crise d’épilepsie. Cet enfoiré joue aussi du piano dégénéré, comme on le constate à l’écoute d’«Eyeballs Poppin’». Il va trop loin dans la surenchère. Oh il tâte aussi du glam, comme on le voit avec «Little Ms Lori» et «Deep End». On croirait entendre des glamsters britanniques. On s’extasie de l’incroyable insistance du riff et du clap-handing. Toute l’artillerie du glam se pointe au rendez-vous - I need your love/ I want your love - C’mon ! Ce mec peut se comporter comme un démon, c’est en tous les cas ce que prouve «Tropically Hot». Il nous fait ici le coup du garage de Detroit, avec les clameurs stoogiennes. On est convaincu d’avance. Il trébuche même sur des pieds d’alexandrins. Cet ignoble Timmy est un sacré scavenger des bas-fonds de Detroit. Il existe un dicton populaire dans le Michigan qui dit : «Rien n’est pire ni plus atroce qu’un Lampinen». Alors faites gaffe...
Il se fait aussi appeler Timmy Vulgar. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Après l’expérience Clone Defects, ce monstre monte un power trio avec Blake Hill et Jeff Fournier et se lance dans une nouvelle aventure baptisée Timmy’s Organism. On entend le gargouillement d’organes avant même d’avoir commencé à écouter les albums. Et comme ce monstre se veut multi-cartes et qu’il peint, il barbouille ses pochettes d’albums d’art trash, certainement le trash le plus dégueulasse qu’on ait vu depuis les horreurs peintes par David Lynch ou les monstrueuses exactions scatologiques de Paul McCarthy.

La pochette d’Heartless Heathen paru en 2015 choque par son chaos de bleu et d’organes charcutées à vif, sans anesthésie. Quant à la musique, berk, c’est encore pire. «Get Up Get Out» sonne comme un vieux coup de mayo de mayem. Ça flirte avec l’incongru. Le batteur qui joue là-dedans est un vrai dingue. Jamais un mec n’a frappé ses fûts avec une telle violence. Ils jouent le morceau titre au gras du bulbe, ils visent l’extrême du garage qui tâche et ça cisaille à tout va. Cette immonde crapule de Lampinen achève son cut à coups de solo trash. Ah la vache ! Ils noient ce heavy blues de blues-rock qu’est «Mental Boy» dans du gras de distorse infecte et le wahtent jusqu’à l’os de l’ass. Tout est complètement saturé de son, ici. Ils attaquent «Wicked Man» à la frenzy d’accords des seventies, c’est encore une fois noyé de gras et joué au solo suspensif de génie pur. Ils n’en finissent plus de revenir au gut du bœuf. Ils tapent leur «Back To The Dungeon» à la sale distorse de petit délinquant qui pue le tabac et le sperme - Mixing up the potion/ Way down in the dungeon - Ils disposent des atouts majeurs : le son, la crasse, le gras, la braguette ouverte et les mauvaises intentions. L’atroce Lampinen profite de notre crédulité pour repasser un solo de gras double. Il travaille ses riffs au corps. Ce glam-stomp qu’est «Weather Woman» ne respecte rien ni personne et se situe au-delà de toutes les normes - Oh weather woman/ The sun is out - Ils jouent le garage de Detroit dans toute sa splendeur caviardée - Caught a cold/ Got da flu/ Pneumonia/ I’m sick and blue - Non seulement c’est claqué du beignet de crevette, mais c’est aussi suivi au filet de bave et ça donne une sorte de merveille apoplectique. Le solo sonne encore une fois comme une stoogerie définitive, un truc à se damner pour l’éternité. Lorsqu’ils attaquent «Hey Eddie», ils sont à bout d’énergie, mais ils se lancent tout de même dans une cavalcade insensée. Tim salue Eddie qui a choisi de quitter cette vie comme the antumn leaves that fall. Il redore le blason du Detroit Sound et se paye le luxe d’un shuffle sur le tard. Voilà encore un cut dynamité. Ça se termine avec «Wanted White Dove», amené au heavy groove, en mode gras double. On sent chez eux une prédilection pour la providence déliquescente. Tim Lampinen a le génie du gras, celui qui fait du bien par où ça passe. Il raconte dans la chanson qu’il soigne une mouette blessée et il la soigne si bien qu’elle lui sourit, et un jour elle devient son amante - Heal those ugly blues/ Hold your head up/ Save your love and truth - Il est extrêmement rare de voir autant de frénésie exacerbée sur un seul disque. Si vous n’y croyez pas, allez jeter un œil.

Paru en 2010, le premier album de Timmy’s Organism s’appelle Rise Of The Green Gorilla. La pochette est heureusement un peu moins agressive. L’atroce Lampinen parvient une fois de plus à proposer un album fascinant, ne serait-ce que par l’impact d’un cut comme «Gorilla Golden Pt 1», cut d’attaque frontale joué au son de destruction massive et saturé de menace sonique. Il fait même entrer les congas de Congo Square dans la danse. Avec «Ugly Dream», il pousse tout dans les orties. Lampinen ne fait pas dans la dentelle de Calais, il faut le savoir. C’est un Detroiter extrémiste, un vénérable pousseur de bouchon, une sale graine de violence, il adore faire craquer son jack et rire comme le diable, ha ha ha sweet dreams ! Avec «Pretty Stare», il se veut plus pop, mais solidement charpenté. Lampinen sait ramener de la viande dans sa caverne, même si sa viande n’est pas toujours très fraîche. On le voit descendre dans son gosier pour produire quelques effets déflagratoires. Retour de la grande violence percussive dans «Oafeus Clods». Oui, on croit entendre les tambours du Bronx. Il sait générer des éruptions soniques dignes du Krakatoa. On l’entend aussi répandre des couches de son infectueux dans «Building The Friend Ship». Comme d’autres aventuriers, il crée son monde. Parti de rien, comme Alexandre le Grand, il bâtit un empire à travers tout le Moyen Orient. Il tâte un peu d’electro dans «Give It To Me Babe», il sature tellement sa soupe qu’elle manque d’air, du coup. Méfions-nous de Lampinen. Même quand il fait joujou avec les instrus et les spoutnicks, il sature l’air. Il sature tout, même son empire. Il boucle cet album pugnace avec «The Traveler». Pour bien brouiller les pistes, il va chercher la beauté mélodique. Il ne veut pas qu’on le prenne pour un débile stoogien. Sa quête du hit vaut bien celle du Graal.

Quelques bonnes surprises guettent l’imprudent voyageur sur Raw Sewage Roq, le deuxième album de Timmy’s Organism. À commencer par «Cats On The Moon». De l’idée, que de l’idée ! Voilà un superbe panache de détritus de boogie-rock de bons potes. Ça bombe du torse, ça nivelle par le bas et ça chante au fond du studio. Quel impact ! Le coup de génie se niche en B : «Low Cut Surgery», encore un heavy romp de Roq saturé de guitare. Tim rebondit sur le beat bondissant. Extraordinaire approche ! Il adore partir en solo vers le néant et mine de rien, il sort la meilleure distorse du Michigan. Il faut aussi écouter l’excellent «Mind Over Matter» lancé aux clameurs d’Elseneur. On croirait entendre des Dolls du Michigan - My car radio baby/ It speaks to me - C’est un hit. L’idée est là. Avec «Bouncing Boobies», Tim fait l’apologie des seins - I took her to the movies/ Nipples like rugbys - Bien sûr, il chante ça à l’insidieuse, sur un beat impérieux comme une bite au printemps. Dans «Monster Walk», il balance un killer solo flash yeah yeah. Tim ne mégote pas avec le flesh du flash - Give the monster/ Somethint to eat - Et il revient à son cher heavy blues avec «Drunken Man». Il en profite pour couler un bronze de son atrocement beau et fumant, toujours dans la démesure du Michigan. Avec «Take The Castle», il semble faire un clin d’œil à Bevis Frond, car il s’embarque dans une histoire épique d’assaut.
Et comme si tout cela ne suffisait pas, il monte une nouvelle équipe de space-punk avec Brad Hales, Colin Simon et Johnny LZR qu’il baptise Human Eye. Quatre albums au compteur, avec des pochettes de graphiste fou. Tim sévit sur tous les fronts : son, image.

Leur premier tir sobrement intitulé Human Eye est complètement foiré. C’est pourtant sorti sur In The Red. Comme dirait l’autre, l’habit ne fait pas le moine. Si on voulait se montrer charitable, on pourrait parler d’album Dada, à cause d’une fâcheuse tendance à l’expérimentation. Tim cultive ses choux et ne cherche pas à plaire aux ménagères. Mais il se montre beaucoup trop aventureux. C’est un vrai bordel. On va fouiner en B mais quand on écoute «Sly Glass Foam», on baisse les bras. C’est sans espoir. Pas de son, pas de rien. On croit parfois entendre du mauvais Devo. «Chew Raw Meat» est à peu près le seul cut décent de l’album. S’ensuit un «Kill Pop Culture» bien subversif et bardé de clameurs d’accords de braseros.

Fragments Of The Universe Nurse vaut le rapatriement pour au moins une raison : «Gorilla Garden». Voilà du grand Lampinen gorgé de son et de wah, battu à la sauvage et joué au meilleur déboîtage de méthodologie. Une fois encore, il enfreint les règles et se donne libre cours. Il part en solo de gras double sous le boisseau. Il ne vit que dans l’excès, il n’en finit plus de créer son sale petit monde, il laborantine le tintouin, il organism son labour of love. Il nous sert une autre rasade d’énormité sonique avec «Rare Little Creature». Ce mec va là où bon lui chante. Oh et puis ce «Slot Culture» d’ouverture du bal d’A. Tim joue tout à l’idée conquérante. Il multiplie les effets de style et fourre le croupion de sa dinde de tortillette psychédélique. Il tape «Two Headed Woman» à la vieille mélasse. Ils sont quatre à touiller cette soupe du diable. Ils nous hantent, avec ce son épicé, pointu, bordélique, un peu rouillé et si spécial. Tim adore le psyché organique, comme on le constate à l’écoute de «Lightning In Her Eyes». Grâce à son imaginaire tentaculaire, il crée des mondes à chaque coin de rue, il invente même ce psychout liquide qui coule sur les doigts. Il faut entendre les phrasés de fournaise d’orgue dans «Dinosaur Bones». Infernal ! Pur jus de Detroit Sound.

Un drôle de vagin psychédélique orne la pochette de They Came From The Sky. Attention, cet album pue l’urgence sonique. Ça démarre avec «Alien Creeps», un heavy psych complètement irresponsable et visité par l’âme du diable, c’est-à-dire la guitare électrique de Timmy. Non seulement c’est balayé par de forts vents d’Oust, mais les rafales atteignent des proportions anormales. Et ça continue avec «Brain Zip», lancé au popotin lampinien. Le drummer bat le train et la machine fonce dans la nuit industrielle avec un panache clochardisé extrêmement séduisant. Tim joue son va-tout glou-glou habituel - Won’t you heal my pain/ Shine your light - Puis il revient à son cher génie avec «Impregnate The Martian Queen», pur stomp cocasse et industriel. Welcome in Vulgarland, le meilleur parc d’attraction des temps modernes. Le cut avance à marche forcée, stomping all over the world. Tim raconte qu’on lui a pris son sperme pour engrosser la reine et quand il revient sur terre, ses copains ne le croient pas - The Marian Queen/ She has a kid - Tim n’en finit plus de créer son sale petit monde avec du son, du texte, des idées et de la cocasserie juvénile. «Junkyard Heart» se montre digne de l’early Hawkwind, c’est en effet un spectaculaire brasero de tourmente sonique. Tim règne sans partage sur son empire de création purulente. Il s’élève jusqu’au ciel, dressé sur un piton noir. C’est joué à l’atmo foutraque d’une Arletty des bas-fonds d’Amérique. Terrific ! C’est littéralement bombardé de son. En B, on tombe sur «The Movie Was Real», un vrai chef-d’œuvre de boisseau ondoyé, une menace intrinsèque, un mauvais plan latent, une senteur mortifère. Tim sait ménager la chèvre de son chou. Il revient au heavy blues de blues-rock avec «Serpent Shadow». Il pèse de tout son poids dans la balance, il ne déçoit pas, il incarne le sonic trash du Miche, il annonce que Dieu descendra combattre the beast - Cast this creature in the lake of fire/ That he breathes - Solo d’étranglement pulsatif à la clé de sol par là-dessus. Avec un titre comme «They Came From The Sky», le cut est forcément épique et il passe un solo de trash pur en guise de cerise sur le gâteau.

Le dernier album en date de Human Eye est sorti sur Goner. Il s’appelle 4: Into Unknown. On a du son immédiatement, dès «Gettin’ Man». C’est la grande différence avec les disques prétendument garage qu’on croise ici et là dans les bacs. Tim Lampinen va chercher le meilleur gras double de l’univers connu - The worls is bad/ And it only gets worse - Il va droit au but, c’est inspiré et terriblement rockalama fa fa fa. Rien qu’avec cet amuse-gueule, l’album s’annonce comme un festin de roi. Voilà un «Immortal Soldier» surchargé de son, et du meilleur - I see in the sky/ See all the suns that have died - Et selon Tim, les anges ne restent pas longtemps sur terre. C’est encore une chanson d’adieu, à la mémoire d’un certain Tim Van Esley. «Buzzin’ Flies» goutte de jus - All these flies/ All these flies - Quelle horreur de trash punk ! Tim saccage tout. Trois belles pièces lampiniennes se planquent en B, à commencer par «Juicy Jaw», envoyé au punch de cave - You make stick out - complètement dévasté de la ciboulette avec un solo de congestion abdominale, évidemment. Back to the true heavyness avec «Faces In The Shadows», admirable heavy-blues préhistorique de faces in the dark. C’est l’archétype du genre, joué au meilleur gras-double de charcutier d’Auvergne. Dans «Outlaw Lone Wolf», Tim raconte l’histoire d’une vengeance. Après le massacre des habitants de son village, Lone Wolf part à la recherche du Blacksmith - Hell bent killing every man - Solo de jachère dégueulasse et Wolf coince le Blacksmith qui essaye de se faire passer pour son père. Mais Wolf l’abat comme un chien. Les histoires sont chaque fois fantastiques !

Back to Timmy’s Organism avec Eating Colors. Trois violentes sirènes guettent Ulysse. Alors attache-toi au mât, mon gars ! Un, «Lick Up Your Town». Detroit Sound de base et de rigueur, morve de guitare verte et beat serré. Ça bat sec et dru et Timmy chante à la petite stoogerie. Il enroule ses boucles. Il a de la suite dans les idées et pelote le cul rebondi de la bonne franquette. Deux, «Crawling Through The Future» : on croirait entendre Blue Cheer. Timmy connaît toutes les ficelles de la sainte trinité du gras double. La troisième bombe se trouve en B : «Revolution Eyes» - I see revolution/ In your diamond eyes - Lyrics de rêve, comme au temps des Stooges, fantastique attaque de ramalama comme au temps du MC5 - Get down on my knees yeah - Quel coup de bravado ! S’ensuit un «Wolfman Running» embarqué aux power chords de Detroiter - Skin/ Start/ To rip - Timmy crée bien son monde, comme d’autres avant lui. Ses départs en solo sont des petites merveilles d’anticipation malovélante. Il se montre bon même avec de la pop, comme on le constate à l’écoute de «Four Leaf Clover» : voilà un cut gratté à coups d’acou, joyeux et enlevé. Il boucle ce bel album jaune avec «Chemical Make Up», une sorte de long cut médicalement assisté. Timmy joue de beaux solos de congestion orbitale, il ne cherche pas à défrayer la chronique, elle se défraie toute seule, il agrège les gréements et appareille les continents, et il repart en solo alors que tout le monde a quitté la salle, et c’est là qu’il va jouer son meilleur solo de trash guitahhh. C’est tout Tim.

Ah tiens, en voilà encore un ! Il s’appelle Survival Of The Fiendish. Tout est là dès «Guzzle Gazoline» : la bécane, la brutalité du Detroit blitz et la guitare saturée à l’extrême. Ce démon de Tim Vulgar laboure ses champs comme mille charrues en folie. Il ressort ses vieilles recettes de fudge, ça coule de partout comme s’il branlait son rock. Avec ce genre de dingoïde patenté, on est obligé de métaphorer plus que de coutume, il faut incendier les mots au phosphore, car c’est exactement ce qu’il induit dans le conduit. Ses alright sont d’une véracité troublante, il ne rigole pas avec l’authenticité. Cet homme ne vit que pour la purée, c’est évident. Avec «Green Grass», il nous plonge dans sa vision des seventies, avec un son aussi ambitieux que peut l’être un clerc de notaire provincial. Il délire bien - Now I can live in peace/ Filled my turtle belly with a feast - Il attaque violemment sa B avec «Selfish Little Queen» - You’re a catastrophe of greed/ I ain’t blind to see/ Ya see ? - S’il monte un psychodrame, c’est uniquement pour l’exploser par la panse - I ain’t your king ! - C’est du Shakespeare de Detroit. Fantastique ! Il passe à la heavy melancholia de bitter pill don’t cha kill avec «Bitter Pill». Il se demande pourquoi la pill ne kill pas et il part la gueule au vent comme s’il chevauchait en tête de brigade sous le feu des artilleurs russes. Quelle bravado ! - Now I’m a zombie standing in line at the pharmacy - Solo surperbe - Lobotomize the poor/ Keep em down forever more - Sa guitare sature tellement qu’elle s’étrangle dans les poussées de fièvre. Il crée une confusion extrême avec «The God Of Comedy» et au beau milieu de cette confusion, il part en solo de wah-wah et explose le cortex du contexte. Il surjoue sa purée et déblatère à terre, les quatre fers en l’air. C’est très spectaculaire, il développe la même énergie que Pat Schizo. Les Timmys jouent tous les trois chacun dans leur coin comme Cream, et comme s’ils avaient chacun dix bras comme Khali. Les voix et les fumées évoquent le premier album de Black Sabbath. Tim Vulgar termine avec «Missunderstood». Il se plaint qu’elle le considère mal - In your eyes I’ve never done good - Et pour cause, Tim est un outcast - I will never change/ This is how I will stay/ I’m an outcast - Et c’est tant mieux.
Signé : Cazengler, Clown défèque
Clone Defects. Blood On Jupiter. Superior Sounds 2001
Clone Defects. Shapes Of Venus. In The Red Recordings 2003
Timmy’s Organism. Rise Of The Green Gorilla. Sacred Bones Records 2010
Timmy’s Organism. Raw Sewage Roq. In The Red Recordings 2012
Timmy’s Organism. Heartless Heathen. Third Man Records 2015
Human Eye. Human Eye. In The Red Recordings 2005
Human Eye. Fragments Of The Universe Nurse. Hook Or Crook Records 2008
Human Eye. They Came From The Sky. Sacred Bones Records 2011
Human Eye. 4: Into Unknown. Goner Records 2011
Timmy’s Organism. Eating Colors. Detroit Magnetic Tape Co 2017
Timmy’s Organism. Survival Of The Fiendish. Burger Records 2018
RESERVE TA DERNIERE DANSE
POUR SATAN
NICK TOSHES
( Allia / 2012 )
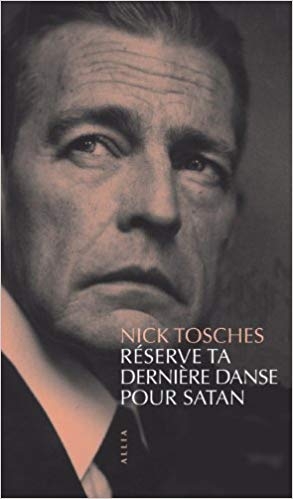
PART ONE – GENERALITES
Le bon vieux temps du rock ‘n’ roll ! C’était quand au juste ? Les débuts d’Elvis en 1954 ? Vous ne connaissez donc pas l’histoire des quatre-vingt-dix pour cent de l’iceberg ? Pas de chance pour vous, 1954 c’est juste le début de la fin. Sans vouloir remonter aux calendes grecques, officiellement cela vient au monde en 1945, oui l’on pourrait descendre jusqu’aux belles années du Delta, mais soyons sérieux, 1945 est une belle date, historique et musicale. Inutile de vous faire un cours d’histoire par contre aux lendemains de la guerre le jazz se trouve à la croisée du chemin. Vous avez ceux qui vont le dynamiter de l’intérieur et ce sera l’éclosion avec Charlie Parker et la génération Be Bop. Et puis les autres. Les hauts sommets c’est comme la peinture à l’huile c’est bien plus difficile. La peinture à l’eau c’est nettement moins beau mais c’est plus démocratique. Entendons-nous sur ce gros mot adoré des politiciens, essayons de le traduire en termes plus simples : n’importe quel bon à rien est capable de vous torcher une chansonnette sur un bout de trottoir ou de comptoir. C’est que l’on appelle du brut de brut. Faut obligatoirement passer par les industries de transformation pour la suite.
Si vous pensez vous retrouver en studio avec ingénieurs du son inventifs et musiciens de génie, vous faites fausse route, c’est un problème quasi-secondaire, tout le monde est capable de brailler dans un micro et les musiciens prêt à vous torcher un simili-arrangement entre deux sandwichs ce n’est pas ce qui manque.
Pensez aux choses sérieuses, une chanson n’existe que parce qu’elle passe à la radio. Vous avez donc vos entrées chez les disc-jockeys. Certes c’est eux qui drivent, mais vous leur fournissez le canasson. Qui lui vous appartient. L’est enregistré sous votre nom. Pas de méprise, aucune allusion au gars qui aurait composé le morceau. Vous avez sauté un étage. Celui des éditeurs, ceux qui détiennent les droits. Ceux qui empocheront le pactole.
Etrange comme au bout de la chaîne vous trouvez le fric ! Le pire c’est que généralement à l’autre bout de la chaîne se tient - ne soyez pas idéaliste, ne proposez pas l’Artiste - le fisc. Un monstre qui a encore les dents plus longues que vous. Bonheur inouï, pendant longtemps les agents patentés de l’Administration ne se sont guère préoccupés des chansonnettes. Personne ne venait fourrer son nez dans le marigot. Les crocodiles se débrouillaient très bien entre eux. Ce n’était pas non plus l’amour fou entre nos amphibiens, y avait de terribles bagarres et de sacrés coups bas pour les terrains de chasse, on lavait son linge sale - voire carrément crasseux - en famille… Hélas, sur notre terre le bonheur ne dure jamais longtemps. La réussite attise les jalousies. Au début des années soixante éclate le scandale de la payola, une méchante paella.
Mais reprenons au début. Le Be Bop d’un côté et le Rock ‘n’ Roll de l’autre. Du Rhythm ’n’ Blues si vous préférez. Les rescapés de l’aventure auprès de qui Nick Toshes mène l’enquête ne sont guère tatillons sur l’emploi des termes, vous pensez peut-être pureté R ‘n’ R ou authenticité R ‘n’ B, mais eux derrière ces deux appellations incontrôlées ils ne voient que l’argent qu’elles génèrent. Dès la fin du dix-neuvième siècle les affairistes blancs traditionnels ont manqué sinon de flair du moins de prospective. Ont laissé aux juifs et aux noirs le bizness de la chansonnette. Les juifs avaient le fric et les noirs une créativité stylistique différentes des patterns issus musicaux issus de la vieille Europe. Avec le Brill les juifs ont jeté les bases du modèle économique. Détenaient l’édition des morceaux et alimentaient les grosses majors de disques telle RCA Victor et Columbia qui proposaient au grand public de la musique sentimentale… Comme l’on ne gagne jamais assez une partie du catalogue était aussi dévolue à la musique des noirs. Pas bêtes pour trois sous, les noirs ont compris la combine. Se sont mis à créer leurs labels et surtout leurs maisons d’éditions.
Ensuite ça été la chasse aux titres et enfin aux disc-jokeys. Imaginez un aquarium remplis de requins. Tous les coups sont permis. Menaces, chantages, passages à tabacs, combines de haut vol… Pour ceux qui ont besoin d’appui financiers ou de porte-flingues opératifs, en dernier recours vous avez la mafia. Entre gens de bons sentiments l’on arrive toujours à trouver un arrangement. C’est-ce que Nick Toshes appelle les temps d’innocence du rock ’n’ roll. Tout le monde y trouve son compte, le gamin qui enregistre son disque, le D. J. qui le programme dans son émission moyennant une petite ( tout est relatif ) commission. Les patrons récoltent les droits. Tout baigne dans l’huile. Tout le monde a des goûts simples : de l’alcool, du tabac et des putes. Que voulez-vous de plus. Aujourd’hui vous collectionnez les labels mythiques qui se sont montés à l’époque : King, Vee-jay ( qui se sont adjugés les Beatles pour leurs premiers pas en Amérique ) ,Aladin, Sparks…
La jalousie est la rançon su succès. Des petits blancs aux idées larges se posent les bonnes questions : pourquoi est-ce que les blancs ne pourraient pas chanter eux aussi du rock ‘n’ roll ? Un gars futé, un certain Sam Phillips décroche le jackpot avec Elvis. Sur ce les gros cachalots radinent leurs fraises et RCA lance une OPA fracassante sur Presley. Le King ne tarde pas à engranger son premier million de dollars. Beaucoup de maille pour des chansonnettes. Le FBI, la politique et les impôts s’en mêlent… Le rock ‘n’ roll a perdu son innocence.

L’on soulève le lièvre. Pas besoin de le chercher bien loin. Tout le monde est au courant de la combine, sous la pression des commissions d’enquête les D. J. tombent dans le piège, ils reconnaissent, en toute bonne foi pour les plus naïfs, recevoir de la money pour passer les records… Alan Freed sera la victime expiatoire. Tout le monde se détourne du mouton noir. Crèvera tout seul chez lui en attendant son procès. Pas dans un deux-pièces-cuisine, non dans son ranch de… 700 hectares. Ce qui change un peu les perspectives. Pourquoi lui ? Parce que avec ses shows qui mélangeaient artistes noirs et blancs il dérangeait un peu, parce qu’il était un peu trop sûr de lui, un peu trop provocant, ne savait pas tout à fait la fermer quand il vaut mieux ne pas l‘ouvrir, l’a un petit peu cherché… Les perdants n’attirent pas la pitié.
Certains moralistes prétendront que l’expression innocence du rock ‘n’roll, s’avère toutefois un tantinet exagérée. Certes nos héros de l’ombre dont l’histoire a oublié les noms - Nick Toshes leur donne la parole - n’étaient pas des anges, parfois ce ne sont pas les bons musiciens qui sont crédités sur les pochettes, idem pour les chanteuses, et la photo ne correspond pas. Bien entendu personne - ceux qui étaient présents comme ceux qui n’y étaient pas - n’a touché le moindre dollar pour le titre qui s’est vendu à des centaines de milliers d’exemplaires. C’est la vie.
Si vous croyez que les profiteurs se sont arrêtés de travailler au milieu des années soixante, l’on peut citer les noms d’un tel qui s’est occupé de Madona, et d’un autre de Prince… Mieux vaut arrêter la liste. Et la payola continue sous d’autres formes… Tel groupe possède tel label, telle radio, telle TV… L’échelle a changé. Les principes restent les mêmes, les pratiques se sont en quelque sorte affinées et standardisées, l’on ne parle plus de dessous de table mais de promotion, de publicité, de contrats, d’accords mis au point par des bataillons d’avocats.
Question d’innocence, vaudrait mieux fermer les yeux. Dans les années cinquante, les petits labels ne quittaient pas le quartier qui les avait vu naître. Tout le monde se connaissait et se tenait à la culotte de l’autre. Vous pouviez faire un coup foireux, mais le boomerang vous revenait en pleine gueule, tôt ou tard. Cela permettait à chacun de s’y retrouver à condition d’y mettre un peu du sien. Il n’est pas de meilleure pédagogie que l’expérience. Les petits gars et les petites garces qui entraient dans la marmite étaient surveillés par les vieux brigands. L’on faisait attention à ce qu’ils ne se brûlent pas du premier coup les ailes. L’école de la vie, mais avec de bons maîtres soucieux de votre survie… Aujourd’hui c’est David contre Goliath revêtu d’une armure anti-fronde.
C’est du moins ainsi que Nick Toshes le raconte. Répète avec une certaine complaisance les propos des principaux activistes de l’époque. Ça sonne vrai de vrai. Vous avez envie d’y croire. Mais la croyance n’a rien à voir avec la pensée, assuraient les philosophes grecs. Ce qui est sûr c’est que ça se lit comme un roman. Avec victimes innocentes et malandrins au grand cœur. Pour tout dire il y a même un D. J. honnête.
Damie Chad.
*
Un rocker n’a jamais peur. Mais là, j’avoue avoir fait un pas arrière. Vous ne devinerez jamais ce qu’il y avait dans ma boîte à lettres : une enveloppe ! Ne vous gaussez point, pas une misérable pelure de moins que rien, non un véritable monstre, hors-norme. Le facteur avait dû se donner du mal, l’avait lovée amoureusement, à la manière d’un boa constrictor imperator, il en avait capitonné tout le pourtour intérieur de mon coffre à messages, en prenant bien soin de ne pas en fragmenter le contenu. En plus, ça pesait un max. Un bon kilogramme. Rien à voir avec les minimales vingt grammes réglementaires. En montant l’escalier je supputais le pire, une lettre d’insultes et de menaces envoyée par un ennemi enragé, je subodorais néanmoins le meilleur, une missive d’amour postée par une admiratrice inconnue qui me déclarait sa flamme et son impatience passionnée. M’a fallu débarrasser le bureau pour pouvoir la poser. J’ai jeté un regard suspicieux sur les timbres, cela venait de Suisse, sans doute un banquier qui me faisait don d’un fond de lourde valise de billets de cinq cents dollars - au poids, plus d’un million - mais mes hypothèses se sont effondrées lorsque au dos de l’envoi j’ai lu le nom de l’expéditeur.
Pas n’importe qui. Jean-Michel Esperet. Un bienfaiteur de l’humanité-rock qui nous a légué une superbe biographie de Vince Taylor. Jean-Michel Esperet est un esprit curieux, n’a-t-il pas organisé dans un autre de ses livres une rencontre improbable entre Vince Taylor et Jean-Paul Sartre, ne nous a-t-il pas aussi fait part en deux de ses ouvrages de ses idées critiques un tantinet diaboliques sur notre monde et sa modernité. Tout cela, nous l’avons soigneusement répertorié dans nos chroniques. Jusque-là Jean-Michel Esperet était resté dans ce qu’il faudrait se résoudre à appeler le littérairement correct. Mais là, manifestement, rien qu’aux sidérantes dimensions de l’enveloppe je compris qu’il avait entrepris de dépasser les bornes de la démesure humaine. J’ai donc extrait de sa gangue enveloppeuse l’objet de ma curiosité, long comme trois cent soixante-six jours sans pain. Ceci n’est pas une comparaison, jugez-en par vous-mêmes, c’était un… calendrier.
HAPPY LEGS YEARS 2020
¨Literary ¨ Edition
ZIOLELE FEAT JAMIE

Les esprits primesautiers hausseront les épaules, un calendrier au moins c’est vite vu, vite lu. Certes ils n’ont pas tort, mais il y a calendrier et calendrier. Celui-ci s’apparenterait plutôt au Double assassinat de la rue Morgue d’Edgar Poe, entre la mort et l'amour la distance à enjamber n'est jamais grande, mais ici il s’agit non d'un double mais de douze assassinats. Considérés comme un des beaux-arts ajouterait Thomas de Quincey.
Chacun se distrait comme il peut. Nous avons tous nos marottes innocentes. Le passe-temps de Jean-Michel Esperet ici reconnaissable sous le pseudonyme de Jamie consiste à doctement deviser sur des morceaux de femmes. Sereinement découpées en deux parties que je m’abstiendrai de qualifier, n’étant pas mathématicien, d’égales. En tout cas ne nous est présenté ici que l` inférieure. Cet adjectif avant tout géographique se doit d’être dépouillé de toute nuance péjorative. Cette activité ludique n’est pas sans rappeler ces numéros de cirque durant lesquels une femme ( de préférence jeune et jolie ) allongée dans une caisse de bois se voit proprement sciée en deux par un magicien généralement secondé par son aide non moins jolie et charmante que la sanglante victime. En homme galant Jamie a préféré laisser à sa demoiselle d’apparat la noble tâche d’accomplir l’irrémissible et toutefois jouissif forfait de la double séparation, c’est donc elle qui s’est chargée du soin de manier la scie séparative, en l’occurrence ici un appareil photographique. Cette artiste de la découpe dénommée ZioLele est qualifiée dans une courte présentation d’Anne-Emmmanuelle de Bonaval de ¨ feminist photographer ¨.
Sans doute est-il temps de se pencher sur les legs-d’œuvres de l’artiste. Bottines, escarpins, talons aiguilles, bas résilles. J’oubliais les jambes. Fines. Elégantes. Souvent cachées ou recouvertes. Seul le mois de juillet vous offrira en coin de photo un prélassement de jambes dénudées échappées d’un fessier même pas nu. Beaucoup de jambes conquérantes qui s’éloignent, paires de ciseaux qui s’amusent à couper le désir qu’elles suscitent. Celle d’avril est pointue comme une tête d’aspic menaçante et celle pommelée de décembre évoque les dessins d’une mue de boa qui s’écarte de sa victime, l’on n'aperçoit qu’une main d’amant mortuaire qui gît dans les draps blancs d’un lit désormais inutile.
Point d’affriolance ou de frivolité dans les photos de ZioLele. Pas des vues saisies au viol hasardeux de la beauté. Des mises en scène froides dénudées de tout sentimentalisme. Chez ZioLele la femme ne cherche pas à vous taper pas dans l’œil, si elle pouvait vous le crever d’un coup de talon elle ne s’en priverait pas. Au mois de mai, le large coutelas irradiant de lumière qu’elle tient d’une main ferme vous incite à ne pas lui laisser faire ce qui lui plaît. Sans doute aimeriez-vous remonter vers la source chaude du sexe, mais par ses prises de vues ZioLele vous incite à baisser les yeux, votre désir s’incline vers le sol, l’amazone est impitoyable, elle dévoile davantage d’asphalte, de goudron, de carrelage que de chair. Peut-être parce que la rareté multiplie la demande et crée la cherté de l’absence. Le fruit fuit. Ou alors il parlemente mais donne l'impression qu'il ment beaucoup plus qu'il ne parle. Aucun pied invisible ne régule l'offre et la demande.

Nous sommes loin de ces calendriers que les sympathiques routiers étalent dans la cabine de leur camion. Les amateurs de pom-pom girls risquent d’être déçus. Il y a une explication à tant de froideur, à tant de refus. Anne-Emmanuelle de Bonaval nous la fournit en sa courte présentation. Si la photographer is feminist c’est parce que le writer qui légendifie les photos est misogynist. Artistes antagonistes. Attention l’on sent qu’ils se sont amusés, qu’ils se sont affrontés, un peu comme quand on est enfant on joue à bataille fermée, chacun pose sa carte en espérant qu’elle sera la plus forte. Ni le chat, ni la souris ne veulent perdre la face. L’enjeu est clair : pas de chatte mais le sourire. Il semblerait que Jamie-Esperet parte perdant. Il n’a que quelques mots à opposer aux grands espaces occupées par les photos. Mais ZioLele n’a pas abusé de l’exubérant chromatisme des teintures. Etrangement chez elle la couleur tend vers le blanc comme si elle voulait que se détache avant tout le compas des jambes dressées comme les mystérieux jambages de quelques lettres isolées victorieusement calligraphiées.
Les trois Horace furent opposés aux trois Curiace. Le combat était à armes égales, mais à ces aigres-douces paires de gambettes agitées comme des sabres d’abordage Jamie-Esperet n’a que la dague pointue de sa langue à opposer. A l’amour qui se refuse il oppose l’humour qui fuse. Je vous laisse découvrir ces petits dialogues, encore plus courts que celui des Mimes des Courtisanes de Lucien. Rédigés en anglais, l’idiome de la perfide Albion qui frise le non-sense et la cruauté sadique. Car le sexe est cru et cruel. L’amante et l’amant, auprès du lit - avant, pendant, après - il n’y a pas d’heure pour ne pas taire les vacheries. Bien sûr c’est Elle qui attaque, et Lui qui répond. Mais ce n’est pas un long duel. Il sait que c’est à la première répartie que l’on cloue le bec de la lutteuse, au premier coup que l’on embroche - symboliquement - l’ennemie. Joue fair-play, il reconnaît ses défaites, même les plus piteuses. Mais il a l’art de les présenter de telle manière qu’Elle en soit en partie responsable. N’est-ce pas Aristote qui a dit que toute chose possède une cause.
Le problème empédocléen c’est que au-delà de toutes les différences les sexes s’attirent autant qu’ils se repoussent. Et ici, tous deux sont décidés de rester sur leur quant à soi. Mais ces ¨ je te hais, moi non plus ¨ font partie d’une parade dans lequel les deux protagonistes cherchent à garder le premier rôle. Ces réparties de jambes-en-l’air orales auxquelles nous invite Jamie-Esperet nous aident à croire qu’elles nous éloignent de notre part animale, qu’elles nous rendent davantage humains en nous permettant de goûter le sel de notre intelligence, puisque nous sommes capables de rire de nous-mêmes.
Damie Chad.
BLOOD AXIS
DAY OF BLOOD
MAX RIBARIC
( Camion Noir / Septembre 2012 )
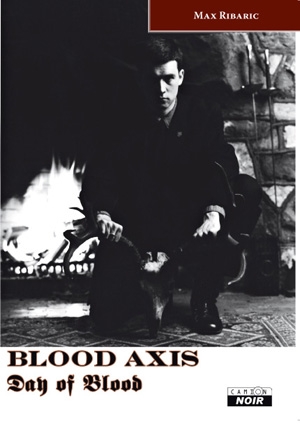
Non il ne s’agit pas d’une erreur adjectivale. Noir c’est noir comme l’affirmait Johnny Hallyday, ce camion n’est pas blanc même si nous avons à plusieurs reprises chroniqué en notre blogue plusieurs livres de la Collection Camion Blanc, même que notre Cazengler à nous s’est chargé de la traduction de plusieurs ouvrages, notamment le There’s one in every town de Mike Farren consacré à Gene Vincent, et dirigé avec maestria Le Petit Abécédaire de la Crampologie, tout ce que vous n’auriez jamais aimé savoir sur les Cramps, toutes ces choses vénéneuses que vous ne pouvez vous empêcher de feuilleter chaque soir avant de vous coucher afin de cauchemarder toute la nuit. Peut-être avez-vous éprouvez le même étonnement que mon immodeste personne le jour où un exemplaire de la collection Camion Blanc, vous est passé pour la première fois entre les mains, mais pourquoi cette couleur blanche bien trop innocente pour qualifier les turpitudes du rock ‘n’ roll. Le noir ne serait-il pas mieux approprié !
Simplement parce qu’il existe une collection parallèle qui porte ce titre. Camion Noir parce que certainement certaines propensions humaines ne méritent aucune lumière. Chez Camion Noir vous trouvez par exemples maints volumes sur les serial killers, des documents, des lettres, des récits qui pourraient déclencher chez vous de fautifs désirs. L’on a aussi pensé aux rares parmi vous qui auraient des prétentions intellectuelles, des reproductions de vieux grimoires alchimistes des siècles passés qui vous demanderont des années d’étude juste pour comprendre la signification du titre. Autre sujet d’expériences diverses, la magie. Surtout la noire. Moins la blanche. La rouge uniquement si elle a la couleur du sang. Camion Noir s’intéresse aussi aux mouvements ésotériques, par exemple aux sociétés secrètes qui ont proliféré durant la période nazie. Thèmes marécageux par excellence. Les livres de Camion Noir sont réservés aux esprits avertis. Sont à manipuler avec précaution.
Camion Noir propose aussi quelques titres dévolus à des groupes de rock extrême. Musicalement et politiquement. Pour le premier adverbe pas de problème, pour le second c’est là où le bât blesse, comme disent les ânes. Que le rock soit fun ou hard ne choque que les oreilles fragiles. Mais que le rock s’aventure en politique, beaucoup préfèrent faire semblant de ne pas voir. Il est des itinéraires qui empruntent des chemins d’une orthodoxie radicale que la majorité réprouve.
Michael Jenkins Moynihan est né en 1969 à Boston. L’est un des enfants aimés de cette middle class américaine sans histoire. Un avenir anonyme tracé d’avance s’offre à lui. Mais il est des individus qui ne sont pas comme les autres. L’on ne sait pour quelles raisons. Le monde dans lequel il vit, lui semble fade et mensonger. Gamin, deux films impressionnent fortement son imagination, Orange Mécanique et Rosemary’s baby… enfin des personnages qui haïssent le monde embourgeoisé dans lequel ils vivent et qui professent des idées en accord avec leurs actes. A douze ans il devient fan de punk et de hardcore, mais l’anarchisme de ces groupes lui apparaît très vite comme une façade, une pause, qui n’est pas vraiment vécue de l’intérieur et qui ne débouche sur aucun acte de révolte significative. L’adolescent sèche les cours, s’enferme chez lui, lit beaucoup, est fasciné par tout texte qui aborde des thématiques violentes notamment le personnage de Charles Manson, le satanisme, et l’histoire des fascismes européens…
COUP DE GRÂCE
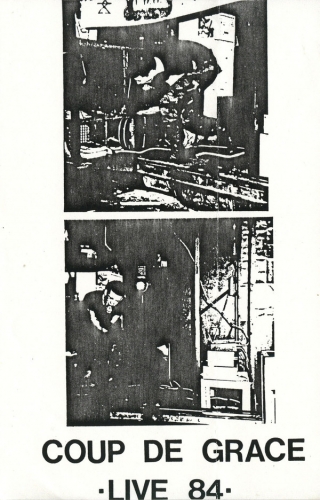
Ce sera le nom de son premier projet. Pour le nommer il ouvrira un dictionnaire au hasard, cette manière de faire est étrangement similaire à celle qui prévalut pour le baptême de Dada. Avec Coup de Grâce Mickael Moynihan met au point et adopte sa méthode ( comprendre ce vocable en le sens où Paul Valéry l’emploie pour signifier le génie de Léonard de Vinci ) dont il ne se départira jamais. Il n’a que quatorze ans mais il détient les clés de la conquête ( propagande ) et le Graal ( expérimentation ). Dans son garage, il produit du son, il bidouille, il traficote, à partir de ces vrombissements glougloutiques que l’on entendait en faisant défiler le curseur d’un poste de radio sur les ondes courtes, et qu’il passe sur de vieux magnétos sur-enregistrés en décalé, auxquels il ajoute des notes de guitare acoustique et de ces synthétiseurs pour gamin que tout le monde possédait. Ces premières créations seront diffusées sous cassettes. Mais la musique ne suffit pas. Il faut travailler l’esthétique de la pochette. Et bientôt s’impose la nécessité d’un livret. Son but n’est pas de donner des explications mais d’accrocher d’hypothétiques auditeurs, de leur donner l’envie d’entrer en contact avec lui. Le texte est une chose, mais la façon dont il est présenté est peut-être encore plus importante, plus décisive. Les couleurs rouge, noire et blanches seront privilégiées, ce sont celles de l’alchimie et aussi de l’iconographie nazie. Recherches graphiques expressionnistes, utilisation de symboles archétypaux empruntés aux propagandes fascistes et aux vieux engrammes païens.
Coup de grâce se terminera en 1989. Moynihan entre dans sa vingtième année. Ce qui pourrait apparaître comme un jeu d’adolescent attardé, une espèce de fourre-tout idéologique de bas étage et une création artistique de bric et de broc lui a permis d’atteindre ses objectifs. Il n’est plus isolé. Il a reçu du courrier, il a rencontré des frères d’armes, il possède une certaine expérience musicale non négligeable, il a donné quelques concerts, il a voyagé, il a tissé un réseau commercial de vente par correspondance qui lui a appris la corrélation qui existe entre la force de persuasion d’un objet ( phonique ou imprimé ) et sa charge esthétique. En plus de tout cela, il n’a cessé de lire ( philosophie, religions, poésie, histoire ), de découvrir, de compiler des documents, de traduire, de se questionner, d’apporter des réponses…
BLOOD AXIS ( I )

Dès 1990, le nouveau projet nommé Blood Axix est sur les rails. Ce sera celui de la maturité. Coup de Grâce trahissait en son titre le nihilisme et l’arrogance de l’adolescence. Il s’agissait d’en finir définitivement avec le vieux monde. Ou tu changes, ou je te tue. Rien n’a changé et la société est encore vivante. Michael Moynihan a compris que le refus solitaire de l’individu ne suffit pas. Que l’on n’en viendra à bout qu’en proposant un véritable projet. Pas un nouveau contrat social mais une philosophie qui permette de se tenir debout. De ne plus subir. Chacun se doit de devenir un axe de sang, l’axe vital par excellence, que c’est seulement ainsi que l’on réunira une élite chargée de l’œuvre sacrée de destruction. L’on est en plein romantisme fasciste. Les photos de Moynihan ne sont pas sans évoquer l’outrecuidance martiale des jeunesses mussoliniennes et nazies. Ce sont des soldats. Prêts à se battre. A mourir, mais surtout à vaincre. Blood Axis possède son emblème, la croix potencée des croisés à mi-chemin imaginal et symbolique entre l’emblème nazi, la croix de Malte et le logo du groupe Occident. La Kruckenkreuz.
A proprement parler Blood Axis ne produira qu’un seul véritable album The Gospel of Inhumanity ( 1996 ) mais qui reste un des piliers fondamentaux de la musique industrielle. Un disque se rage et de destruction. Qui marquera les esprits. Peut-être parce que dans le kaos sonore délivré se décèle un chemin vers un autre pays, un pays qui a toujours existé, qui n’est plus, mais dont on a la prescience de son existence.
Le groupe participera aussi à plusieurs anthologies composées de formations de mêmes types, rares sont celles capables de rivaliser avec lui… Ces disques ( CD, DVD, CD-Rom, vinyles ) très souvent édités par Blood Axix sont agrémentés de luxueux fascicules et tirés à petit nombre d’exemplaires… De même seront offerts des Lives enregistrés lors de tournées européennes et américaines. Parfois les concerts sont annulés ou précédés de manifestations organisées par des groupes antifas.
BLOOD AXIX ( II )

Le groupe évolue. Des musiciens vont et viennent. Mais la musique change. La réflexion de Michael Moynihan s’est approfondie. Son aspect physique n’est plus le même. Certes il a pris de l’âge. On sent un apaisement. Il n’est plus le va-t-en guerre du début, le soldat intraitable s‘est métamorphosé, le militant idéologique a mûri. Il n’a rien renié mais la nostalgie des groupes fascistes de l’entre-deux guerres, n’est plus de mise. La donne n’est plus la même. L’Allemagne et l’Italie des années 20, ne sont plus des exemples, l’Europe a été la première victime des deux guerres mondiales, une véritable guerre civile dans laquelle elle s’est coupée de ses racines les plus profondes. Le pays, le grand pays, reste celui des anciens Dieux, nordiques, grecs, et même peut-être certains aspects de la spiritualité chrétienne… Mickael Moynihan tient des discours de philosophe. Des propos empreints d‘une sagesse éruptive… Peut-être la venue d’Annabel Lee y est-elle pour quelque chose. Elle lui donnera un fils, et apportera au groupe une véritable connaissance de la musique classique. Elle joue du violon, et de l’accordéon. Il ne faut pas parler d’influence mais de conjonction. Le bruitisme culturo-phonique de la musique industrielle cède le pas à un néo-folk industriel qui aux avalanches sonores préfère désormais des morceaux plus traditionnels. L’on ne mixe plus des discours idéologiques, l’on exalte de préférence des poèmes… Une musique qui se donne pour mission de rétablir une ouverture avec le vieux fond du paganisme européen originel.
Le livre s’achève en 2007. Son auteur italien Max Ribaric a pu puiser directement aux archives accumulées par Mickael Moynihan. Une véritable somme iconographique et textuelle. Par contre les lyrics du groupe qu’ils soient en anglais ou en allemand ne sont pas traduits. Certains lecteurs penseront qu’il s’agit d’un ouvrage de propagande ( pré-pro-post-) fasciste... Sa lecture s’en révèlerait alors d’autant plus nécessaire.
Damie Chad.