KR'TNT !
KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 572
A ROCKLIT PRODUCTION
SINCE 2009
FB : KR’TNT KR’TNT
27 / 10 / 2022
GALLO’ S POLE & FARLOWE A LA BOUCHE
HAROLD BRONSON / MATT PATTON
DREAM SYNDICATE / JACKIE DAY
MISCELLEN / BLIND UNCLE GASPARD
ROCKAMBOLESQUES
Sur ce site : livraisons 318 – 572
Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :
http://krtnt.hautetfort.com/
Gallo’s Pole & Farlowe à la bouche

Ce n’est pas Chris Farlowe qui a cassé sa pipe en bois, mais Jean-Yves Gallo, un ami de très longue date. Au temps où nous étions lycéens, mon frère et moi le surnommions ‘Gallo’s Pole‘ en écho au «Gallows Pole» qui se trouve sur le Led Zep III et qu’on adorait écouter ensemble. Depuis 1966, nous n’avons quasiment jamais cessé de partager nos passions. De tous les spécialistes du rock rencontrés au cours de six décennies, Jean-Yves fut sans le moindre doute le plus évolué, le plus brillant et le plus élégant. Il a su créer autour de lui une véritable communauté de pensée. Ce n’est pas un hasard s’il est le dédicataire des Cent Contes Rock. Ces contes furent écrits spécialement pour lui, car nous avons bavé ensemble sur les trois-quarts des mythologies qui les alimentent. Le conte qui suit est tiré d’un Volume 2 à paraître. En fait, c’est Jean-Yves qui a vu Chris Farlowe dans le magasin, et il me fit jadis un récit si drôle de cette «rencontre» que l’idée m’est venue de la développer pour lui donner une suite et d’inverser les rôles pour en faire le conte présenté ci-dessous. Ça devait être une surprise.
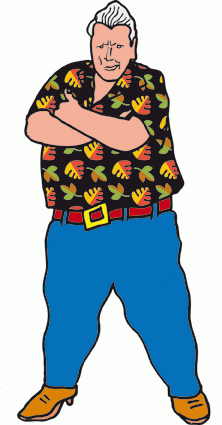
Farlowe à la bouche
Lorsque vous descendez à la station Angel du métro londonien et que vous remontez Upper Street jusqu’à Islington Green, vous trouverez facilement Call To Arms, une boutique proposant des pièces de collection provenant de l’Allemagne nazie. C’est en tous les cas le trajet que je suivis, par une belle matinée de printemps.
Comment en étais-je arrivé là ?
J’avais depuis longtemps mes habitudes chez les disquaires d’occasion de Golborne Road et dans les officines de marchands de photos et de vieux magazines de rock. Alors qu’un jour je fouillais dans un carton de photos originales, se trouvait juste en face de moi, de l’autre côté de l’étal, un gigantesque personnage d’allure peu avenante. Sa figure massive, charpentée autour d’un long nez droit, semblait contenir toute la rogne du monde. Il se dégageait du personnage une sorte de brutalité, comme s’il était à la fois un soudard du moyen-âge, un féroce guerrier peau-rouge et un barbare russe issu des steppes les plus reculées. Ses lèvres entrouvertes laissaient apparaître de très grosses dents. Ses mains, son torse, la largeur de ses épaules, le volume de son crâne, la longueur de ses bras, tout en lui semblait hors de proportion. Il lorgnait les photos une à une, l’œil noir et un pli mauvais au coin des lèvres. Se sentant observé, il leva les yeux vers moi et me foudroya littéralement du regard. Je dus relâcher la photo inédite de Brian Jones que je venais de dénicher et prendre la fuite.
Je revins toutefois le lendemain questionner le marchand. Il me semblait avoir reconnu Chris Farlowe. Je voulais en avoir le cœur net. Le marchand confirma que Chris Farlowe faisait effectivement partie de ses clients réguliers.
— Vous vous intéressez à lui ?, me demanda-t-il, amusé.
— Oh, je connais très bien ses disques... Mais il n’a pas l’air commode...
— Il a toujours été comme ça. C’est un être... comment pourrais-je dire... un peu sauvage... et même assez fantasque... Pas mondain pour deux ronds. Exactement à l’opposé d’un McCartney. Ne restez pas sur une mauvaise impression. Essayez d’aller le voir et de parler avec lui. Je vous assure qu’il est passionnant. Il fait partie des vrais pionniers du British Beat. Si vous gagnez sa confiance et que vous réussissez à le brancher sur l’époque où il jouait au Star Club de Hambourg, vous allez vous régaler, je vous le garantis.
— Mais comment voulez-vous que j’aille le voir... Je ne connais pas son adresse...
— Vous trouverez sa boutique sur Islington Green...
— Il tient une boutique ? Une boutique de quoi ? De disques ?
— Oh pas du tout. Lorsque vous verrez une vitrine ornée d’une immense croix gammée, entrez. Vous le trouverez au fond, assis derrière un comptoir.
— Pourquoi une croix gammée ? Je ne comprends pas...
— Il vend des objets nazis aux collectionneurs.
Je mis plusieurs jours à prendre une décision. Finalement, la curiosité finit par l’emporter.
J’éprouvais depuis longtemps une réelle admiration pour ce mec-là. Depuis l’époque où j’avais découvert ses deux fantastiques albums parus sur Immediate, le label d’Andrew Loog Oldham : 14 Things To Think About et The Art Of Chris Farlowe. Chris Farlowe se situait exactement au même rang que Rod Stewart et Steve Marriott. Ayant découvert par hasard à quoi il pouvait ressembler physiquement, je compris qu’il pût avoir cette voix hors du commun. Sa version de «Think» des Rolling Stones me fit souvent l’effet d’une montagne en flammes. Il donnait à cette pop-song d’apparence banale une allure monumentale. Quand Jagger lui demanda d’interpréter «Out Of Time», Chris Farlowe en fit l’hymne du Swingin’ London. Il ne fit qu’une bouchée du «Summertime» de George Gershwin, asticotant ce classique du jazz de c’mon d’antho à Toto. Il y barytonnait et la seconde d’après explosait en plein ciel. Grâce à ses deux albums et à une poignée de singles, Chris Farlowe donnait vraiment l’impression de régner sur Londres. Avec un morceau comme «Looking For You», il supplantait les stars de Motown dans l’art de chauffer le r’n’b à blanc. «Looking For You» fut l’un des plus beaux jerks de cette époque si riche en jerks. Comme par magie, il transforma l’«It’s All Over Now Baby Blue» de Dylan, en r’n’b dévastateur. Cette version outrancière semblait destinée à choquer le bourgeois. Pour Chris Farlowe, transformer les tubes en reprises pharaoniques semblait être un jeu d’enfant. De la même façon que Mark Lanegan, Chris Farlowe savait transformer le plomb en or. Sa reprise du «Rocking Pneumonia» d’Huey Piano Smith frisait la démence. S’il chevauchait l’«In The Midnight Hour» sur un énorme drive de basse, c’était uniquement pour humilier Wilson Pickett. Il fit subir le même sort à Otis en torchant une version ahurissante de «Mr. Pitiful». Chris Farlowe savait aussi écrire des chansons. Avec «Treat Her Good», il sortait un son Pretty Things à la puissance dix. Il fit aussi une version renversante de «My Way Of Giving», un classique des Small Faces. Chez Chris Farlowe, tout n’était que démesure : le registre vocal, la gouaille, la hargne, la classe, le son des basses. Sa version de «Satisfaction» atteignait le comble de la vulgarité. Aucun chanteur anglais n’avait cette prestance de soudard, cette classe d’aristocrate des bas-fonds. Il troussait tous ses morceaux comme les jupes des filles, à la hussarde. «We’re Doin’ Fine» prenait l’allure d’un bolide piloté par Mad Max. Et puis il y avait aussi l’effarante reprise de «Reach Out I’ll Be There», le hit suprême des Four Tops, qu’il chantait avec une sorte d’application morbide. Il partagea avec Rod Stewart l’immense privilège d’interpréter «Handbags And Gladrags», une fantastique chanson composée par Mike d’Abo. Il ne fut jamais possible aux amateurs de décider laquelle des deux versions était la meilleure, celle absolument grandiose de Chris Farlowe, ou celle, dégoulinante de feeling, de Rod The Mod.
J’arrivai enfin devant la vitrine décorée d’une croix gammée. Intimidé, je n’osai pas entrer et continuai mon chemin. Un quart d’heure plus tard, je revins à hauteur de la boutique, et fis semblant d’examiner les objets disposés dans la vitrine. Je fouillai du regard le fond du magasin et, comme l’avait indiqué le marchand de photos, je ne vis personne. Finalement, je pris mon courage à deux mains et entrai. Une clochette tinta. Je fis quelques pas jusqu’au centre de la pièce, et attendis, à demi paralysé de terreur. Des mannequins alignés le long du mur semblaient m’observer. Ils portaient les uniformes nazis qu’on voit dans les films de guerre. Les uniformes noirs d’officiers SS avaient quelque chose de particulièrement oppressant. Au fond se trouvait un grand comptoir drapé d’un gigantesque drapeau nazi. Surgie d’un recoin noyé dans l’ombre, une voix me fit sursauter :
— Vous cherchez quelque chose de spécial ?
Et je vis apparaître la tête monstrueuse de Chris Farlowe.
— Non non... Rien de particulier. Je suis entré par hasard.
— Tiens, tiens, mais je te reconnais, toi, little red rooster. Je t’ai vu l’autre jour fouiner chez Harold... Tu collectionnes quoi, au juste ?
— Oh rien, monsieur Farlowe, je suis français et je viens à Londres pendant les vacances scolaires acheter des disques et quelques photos...
— T’as de l’oseille, fooking rooster ?
— Juste de quoi acheter quelques disques d’occasion et loger dans un hôtel à South Kensington, monsieur Farlowe...
— Regarde cet uniforme d’Oberstleutnant de la Waffen SS... J’ai vendu le même à Keith Moon la semaine dernière. Je peux te faire un prix, little prick...
— Je vous remercie, monsieur Farlowe, mais je n’en ai pas les moyens. Il me reste environ 30 £...
— Tiens, jette un œil là-dessus, fooking rooster...
Il sortit de sous son comptoir un objet enveloppé dans un chiffon et prit un air de conspirateur :
— Look out ! Voilà une pièce extrêmement rare... Je te la montre, juste pour le plaisir des yeux...
L’emballage défait, une petite trompette apparut.
— Voilà un clairon SS. Tu vois, là, gravé dans le métal, l’aigle du troisième Reich !
Je commençais à regretter de m’être embarqué dans cette aventure. Je n’osais plus aiguiller la conversation sur le vrai but de ma visite. J’avais déjà perdu trop de temps. L’atmosphère sordide du magasin commençait à m’indisposer. Une odeur de mort et de camomille régnait dans la pièce. À demi paniqué, je décidai une fois encore de prendre la fuite. Pas de taille à me frotter aux géants du Swingin’ London. Je prétextai un train à prendre, remerciai Chris Farlowe de son accueil et sortis du magasin en hâte. Je courus jusqu’au métro et tentai vainement de surmonter la nausée qui montait en moi. Je dus ressortir du métro pour aller vomir au coin d’une rue.
De retour au lycée le lundi suivant, je fis part à mon copain Jean-Yves du détail de cette mésaventure.
— Tu sais pas qui j’ai rencontré à Londres ?
— Non.
— Chris Farlowe !
Ses yeux s’arrondirent comme des soucoupes.
— Putain, c’est pas vrai !
— Ben oui... On est devenus potes. Tu verrais ce meeeeec ! La claaaaaasse ! T’as même pas idée !
— Oh si... Je connais ses deux albums sur Immediate par cœur !
— Ah mais là, les disques, c’est vraiment que daaaalle, Jean-Yves ! Y faut voir le mec en chair et en os... Lui parler... Lui serrer longuement la main... Y te domine d’au moins un mètre et te plante son regard de mérou, comme ça, là, dans le blanc des yeux. Si tu soutiens son regard, y t’adopte. C’est le test.
— Il t’a adopté ?
— Ben ouais. Mais j’savais pas que c’était un test. J’ai pigé après.
— Mais tu l’as rencontré où ?
— Dans son magaze... Y vend des reliques du troisième Reich... Une boutique complètement dééééémente ! Une vraie caverne d’Ali Baba, oh, tu verrais l’bordel ! Putain, j’aurais eu du blé, j’aurais acheté une casquette d’officier SS pour foutre un peu la merde au lycée ! Et une paire de bottes de fantassin... Tu verrais comme elles sont balèèèèèèèzes ! Wouahhhh les bottes !
— Mais pourquoi il vend des objets nazis ?
— Passe qu’y l’a la claaaaaasse ! Chris Farlowe cultive une es-thé-tique, tu piges ? Les amateurs viennent du monde entier lui acheter des dagues en or massif, des ailes de stukas et des chenilles de Panzers ! T’aurais vu tout ce bordel, la boutique elle grouillait de gens. T’avais des tas de vieux qui venaient de partout, d’Uruguay, du Paraguay, du Guatemala, du Japon, d’la Suisse, avec des rouleaux de billets de 100 dollars dans les pattes, comme ceux qu’tu vois dans les films avec la mafia, et y avait aussi d’autres mecs comme Keith Moon, Lemmy, Vivian Stanshall et Brian Jones qui essayaient des brassards par dessus leurs vestes en velours !
— Comment peut-on imaginer un endroit pareil ?
— Déééééément ! Absoluuument déééééément ! J’ai discuté pendant deeees heures et deeees heures avec le père Chris... Y m’a raconté ses souvenirs d’Hambourg, quand y jouait au Star Club avec les Thunderbirds. Y m’a dit qu’y jouaient cinq sets toutes les nuits et comme cet enfoirééé de boss du Star y leur filait pas un rond, y devaient aller tirer d’la bouffe dans des supermarchés ! Tu vois le déliiiiire ? Y m’a dit aussi qu’y partageaient l’affiche avec des lascars comme Fats Domino, Chuck et Jerry Lee ! J’te dis pas les anecdotes qu’y sortaiiiiit, putain ! Ça pleuvait d’partout ! Un vrai déluuuuuge ! J’aurais dû prendre des notes, putain, y’en avait trop ! Quand y l’a fermé son bouclard, y m’a emmené boire une pinte au pub. Quand j’dis une pinte, ah la la la, c’est une façon de parler ! Tu sais quoi ? Ben le patron y lui a claqué direct dix pintes sur le bar et dix verres de bourbon ! Chris y les a tous siffléééééés, les uns après les autres, bière, bourbon, bière, bourbon. Pif paf pouf ! Tout cul sec ! Puis y l’a fait signe au patron qui m’a servi la mêêêêême chose. Dix de chaque ! C’était l’second test...
— C’est encore pire que de passer le concours d’admission dans les Hell’s Angels !
— Atteeeends, putain, c’est pas fini ! Le père Chris y m’a demandé si j’savais jouer de la gratte ! Jui ai dit oui, sans réfléchir. Y m’a embarqué aussi sec vers le fond du pub où se trouvait une petite scène et m’a carrément collé une Fender dans les pattes. On a fait tous les deux quelques chansons pour le public d’habitués. Baby baby baby you’re out of time, tu vois l’truc ? J’avais du mal à m’concentrer sur les accords, parce que j’arrêtais pas d’le regarder. Le père Chris sur scène, ça vaut l’jus, t’as même pas idée ! Tu verrais comment qu’y bouge ! Y fait un pas de côté, comme ça, et y remue le torse en rythme, han han, d’avant en arrière, han han. T’aurais dit Hercuuuuule ! Ce mec c’est une montaaaaaagne de punch ! En chantant, y tend le bras et pointe le doigt sur les gens du public, comme si y s’adressait directement à eux. Carl Palmer qui passait par hasard est v’nu faire le bœuf avec nous, alors t’as qu’à voir !
— Celui d’Emerson Lake and Palmer ?
— Ben oui, évidemment, mais avant, tu sais qu’y l’était batteur dans les Thunderbirds ? Après, j’leur ai payé une tournée. J’te dis pas la muuuuurge ! Le père Chris m’a d’mandé si j’avais un endroit où pieuter. Évidemment, j’ai saisi la perche. Y m’a emmené chez lui. Et voilà comment j’me suis retrouvé dans le saint des saints. Tu vois un peu le déliiiiiire, Jean-Yves ?
— Tu ne vas quand même pas me dire que tu t’es fait enculer pour goûter au nec plus ultra du Swingin’ London ?
— Ah la la, toi, faut toujours que tu tournes tout en dérision ! Bon, devine ce qu’y m’a fait bouffer ?
— Des œufs au bacon ?
— Ben non !
— Je ne sais pas, moi... Des haricots blancs ?
— Pfffff...
— Des toasts avec de la marmelade ?
— Non ! Des rations de l’armée allemande !
— Non, là tu déconnes... Elles étaient encore bonnes ?
— Super boooooonnes ! Des sardines à l’huile, du pâté de foie et du corned-beef, le tout arrosé de schnaps. On descendait la bouteille au gouuuulot, comme sur le front russe ! Après, y s’est mis torse nu pour me montrer ses tatouages. Wouaaaaaah ! Tu verrais le bordeeeel ! Sur la poitrine, y s’est fait tatouer une grosse tête d’Hitler, avec des yeux qui louchent. Et dans l’dos, un aigle, comme celui des enseignes de régiments.
— Il t’a pas montré sa bite ?
— Mais t’es jaloux ou quoi ? Pourquoi tu poses ce genre de question à la con ?
— Parce que Pamela raconte qu’il a une tête de Mickey tatouée sur la bite et les deux oreilles sur les couilles...
— C’est qui Pamela ?
— Une groupie qui a écrit ses mémoires...
— N’impooooorte quoi ! Comment tu fais pour avaler des conneries pareilles ? Bon, bref... On a parlé tout le restant de la nuit. Jui ai même parlé d’toi. Jui ai dit que t’étais un spécialiste des Creation, des Fleur de Lys et des groupes Mods. Alors y m’a dit qu’y serait heureux d’te rencontrer, la prochaine fois qu’tu déboules à Londres. Y l’arrêêêêêêêtait plus. Y s’levait pour aller mettre des albums de Johnny Burnette et de Muddy Waters sur le pick-up. On jouait de temps en temps au bras de fer. J’voyais les veines de son cou gonfleeeeeer. Comme ce mec a du fair-play, y m’laissait parfois gagner. Au matin, j’étais riiiiiiincé. Y m’a emmené prendre un breakfast au coffee-shop du coin. On a sniffé un ou deux rails d’Ajax et on est r’partis pour une journée d’folie. On a pris un taxi pour aller chez Andrew Loog Oldhamme qui nous a reçus comme des priiiiiinces, whisky, herbe, coke, pills, acide, tout l’bordel ! Chez Andrew, le pote Chris y l’a passé un coup de fil. Devine à qui ?
— Sais pas, moi... Brian Epstein ?
— Mais non... Mick Jagger ! Bon, bref, on arrive chez lui. Tu verrais la baraaaaaque, avec des chandeliers et des Rolls garées devant l’perron. Jagger nous r’met la rincette, whisky, herbe, coke, pills, acide. Y m’a même donné des 45 tours des Rolling Stones que personne connaît, mais j’les ai oubliés là-bas, autrement, j’te les aurais filés. On sonne à la porte, et devine qui c’est qui s’pointe ?
— Sais pas, moi... La reine d’Angleterre ?
— Mais noooon ! Paul McCartney, tout vêtu de blanc et pieds nus, comme sur la pochette d’Abbey Road, alors t’as qu’à voir ! Mais tu sais, la vraie star, là-dedans, c’était mon pote Chris, haut comme une tour du moyen-âge. Les autres y n’en finissaient plus de lui dire combien y l’admiraient. À un moment, Chris leur a dit que j’étais un super frenchie. Alors, Paul et Mick m’ont donné leurs numéros de bigo perso. Maintenant, quand j’me pointerai à Londres, plus besoin de m’faire chier à trouver une chambre dans un bed and breakfast. Et tu sais c’qu’on a fait, après ?
— Non...
— C’est pourtant pas difficile à deviner !
— Vous êtes allés voir Brian Jones ?
— Ouiiiiiiiii !
— J’en étais sûr...
— Supeeeeeer Brian Jones ! Décadent, avec plein de sitars dans l’salon. Un vrai gentleman, gentil, prévenant, très cultivé, coiffé comme toi. Jui ai demandé si j’pouvais gratter quelques accords sur sa belle Vox Teardrop blanche. Pas de problèèèèèème. Gratte mon gars ! J’ai fait «Satisfaction» et «The Last Time». Mon pote Chris y chantait les paroles. Brian m’a félicité et m’a offert plein de drogues. Pour le remercier, jui ai conseillé de lire l’ouvrage de Barbey d’Aurevilly consacré au dandysme, tu sais, Du Dandysme Et De George Brummel. Y m’a écouté avec beaucoup d’attention. Jui ai dit qu’y trouverait dans ce précieux bréviaire des conseils pour parfaire ses manières. Avant que nous n’partions, Brian a chaudement remercié Chris de lui avoir présenté un frenchie aussi commak. Pendant les cinq jours où j’suis resté avec Chris, ça... n’a... pas... ar... rê... té une minute. Jour et nuiiiiit ! Y m’a présenté la crèèèème de la crèèèème du gratin londonien, des mecs comme Steve Marriott, Ronnie Lane, Keith Richards et Anita Pallenberg, Pete Townshend, Jimmy Page, Vincent Crane, et tout un paaaaaquet d’autres...
— Tu vas te faire chier comme un rat mort, au lycée, avec des mecs comme nous...
— C’est évident. Mais d’un autre côté, ça me permet de souffler un peu. Faut être vachement costaud pour partir en virée avec un mec comme Chris Farlowe. T’as qu’à essayer, tu vas voir ! Fais comme moi, commence par aller faire un tour sur Islington Green. Tu lui dis que tu viens d’ma part. De la part de fooking rooster !
Signé : Cazengler, Chris Fallot
Jean-Yves Gallo. Disparu le 8 octobre 2022
Harold on, I’m comin’ ! - Part One
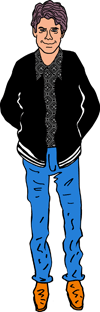
Tous les amateurs de belles boxes connaissent Rhino et tous ceux qui ont poussé le bouchon un peu plus loin connaissent Rhino Handmade, des disques impossibles à choper car parus en tirage limité et vendus uniquement sur le web. Comme Bomp!, Rhino est un label devenu mythique qui ne tombe pas du ciel et qui ne sort pas non plus de la cuisse de Jupiter. Dans les deux cas, il s’agit de labels créés en Californie par des kids obsédés de rock et qui partent de triple zéro. D’un côté Greg Shaw (Bomp!), et de l’autre le duo Richard Foos/Harold Bronson.
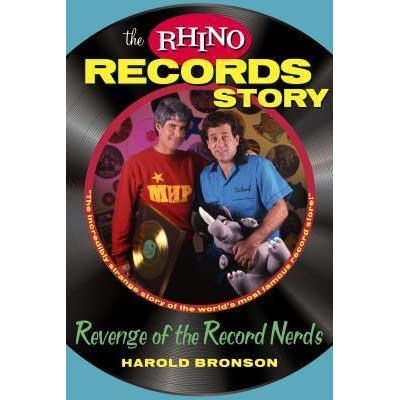
Harold Bronson nous raconte dans The Rhino Records Story: Revenge Of The Music Nerds l’épopée Rhino, histoire de rappeler aux ceusses qui ne le savaient pas encore, que l’histoire des labels - comme d’ailleurs celle des studios - est aussi importante que celle des artistes. Dans l’étagère, il faut ranger le Rhino book à côté de l’autobio de Jac Holzman (Follow The Music), celle de Jerry Wexler (Rhythm And The Blues), et des books de base, Peter Guralnick (Sam Phillips: The Man Who Invented Rock ‘n’ Roll) Roben Jones (Memphis Boys: The Story Of American Studios) et bien sûr tout Robert Gordon, oh et puis il ne faut pas oublier les Anglais.

Rhino avait pour particularité d’être un label de réédition. Ils payaient des licences aux grands labels pour rééditer les artistes qui les intéressaient. Les plus beaux coups de Rhino sont la Buffalo Springfield box, la Fun House box des Stooges, les Monkees boxes, les cinq boxes inspirées par Nuggets (Nuggets 1, Nuggets II, Children Of Nuggets, puis, sans Bronson, Love Is the Song We Sing: San Francisco Nuggets 1965–1970 et la cinquième Where the Action Is! Los Angeles Nuggets: 1965–1968), et une multitude d’autres rééditions qui s’étalent sur une période de 25 ans. Il faut bien comprendre que Bronson et Foos sont des enragés, et comme ils sortent des objets de qualité, ça marche. À partir de là, il est facile de tracer un parallèle avec Ace en Angleterre. C’est exactement le même état d’esprit.

En dehors de sa passion pour le rock, ce qui caractérise le plus Bronson, c’est sa bonne bouille. Une bouille d’ado attardé. Le genre de mec auquel on fait confiance les yeux fermés. Il rappelle d’ailleurs dans son book qu’une de leurs préoccupations principales, en tant que directeurs associés Foos et lui, était le bien-être du personnel. Ça marchait si bien que Foos et Bronson durent à l’apogée du Rhino system gérer 150 personnes. Ils développaient les techniques de gestion du personnel très avant-gardistes pour l’époque : association aux bénéfices et aux process créatifs. Ils avaient compris le truc de base : un salarié bien dans sa peau bosse mille fois mieux que celui qui ne l’est pas. Ce n’est pas une question de rendement, c’est une question de bon sens.
Dans son intro, Bronson tient à rappeler qu’ils sont partis de rien : ils ont ouvert un record shop sans aucune aide financière. Comme il a beaucoup d’humour, Bronson compare Foos à Albert Einstein, mais un Einstein qui serait né à Pittsburg et qui plutôt que de s’intéresser aux maths et à la physique, se serait intéressé à l’absudist humor and rock’n’roll. Bon observateur, Bronson observe que ce qui a forgé l’humour de Foos, c’est d’avoir grandi dans un environnement extrêmement structuré. Foos prend à une époque Abbie Hoffman comme modèle et applique à la lettre ce qu’Hoffmann enseigne dans son book, Steal This Book. Foos et ses amis poussaient le bouchon très loin : pour ne pas payer les billets d’entrée dans les concerts, ils entraient en marche arrière par les sorties de secours. Quand ils mangeaient au restau, il n’était bien sûr pas question de payer l’addition.

La boutique Rhino Records devient vite un endroit réputé. Un jour, un mec d’Atlantic leur amène des Pretty Things qui viennent d’enregistrer Silk Torpedo. Comme personne ne veut interviewer les Pretties en Californie, on demande à Bronson de les interviewer, mais ça ne se passe pas très bien, Phil May et Jack Green sont mal à l’aise dans l’arrière-boutique Rhino. L’interview n’est jamais parue. C’est aussi l’époque où Phast Phreddie Patterson et ses potes viennent mettre leur fanzine Back Door Man en dépôt. Bronson note que ces kids en black leather originaires de LA’s South Bay sont rough around the edges et fans Iggy Pop et de Blue Oyster Cult. C’est à ce genre de petits détails qu’on jauge la qualité d’une ambiance. Kim Fowley traîne aussi dans le secteur et invite Bronson à venir voir the first public showcase des Runaways le 12 septembre 1975, non pas au Troubadour ou au Whisky, mais in Phast Phreddie’s parents’ sunken living room in north Torrence. Bronson avoue avoir adoré le concept, but they weren’t very good.
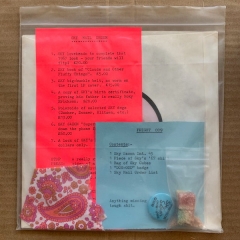
Un jour au magaze (hello Laurent), débarque Sky Saxon. Tout le monde serait ravi de voir débarquer Sky, mais pas Bronson. Il s’en explique. Comme tout le monde, il est fan des Seeds et il se souvient d’avoir rencontré Sky pour la première fois au Troubadour en 1971 - Saxon ressemblait au comédien Jerry Lewis, visage bien dessiné, menton fendu et voix nasale. Quand je l’ai rencontré, il avait encore his rock-star good looks - Puis Bronson essaye de lui organiser un concert à l’UCLA, «but he wasn’t together enough to make it happen» - la formulation est superbe, inutile de la traduire, elle tient debout toute seule - Sept ans plus tard, quand Sky débarque au record shop, il n’est plus le même, avec ses cheveux raides, il semble beaucoup plus âgé qu’il ne l’est en réalité, de vingt ans, nous dit Bronson qui le compare à Old Witch dans Tales From The Crypt. La comparaison est bonne. On se souvient d’avoir arriver vu Sky un soir au Trabendo sur des jambes flageolantes, mais une fois sur scène, il ne flageolait plus du tout. Donc Sky se pointe au magaze, et d’une voix de burned-out hippie, il explique à Bronson qu’il s’appelle désormais Sunlight et qu’il vient de passer quelques années dans une communauté à Hawaï. Sky ramasse les chiens dans la rue parce que DOG est l’anagramme de GOD. Sky vient chez Rhino pour placer son single «Beatiful Stars» qu’on a tous acheté à l’époque. Bronson devient soudain féroce : «Je lui en ai acheté quelques-uns pour me débarrasser de lui.» C’est vrai que les mecs trop barrés sont parfois difficiles à supporter. Il faut savoir le faire. C’est même dit-on un métier. Il est marrant, Bronson, car il arrive à supporter plus facilement Wild Man Fisher, qui est encore plus barré que Sky. Fisher est même l’un des premiers artistes signés sur Rhino. Go to Rhino Records !

En tant que disquaires, Foos et Bronson sont attirés par tout ce qui est obscur à cette époque de surabondance, et pouf, il cite des exemples : Losing You To Sleep de Tommy Hoehn, Take A Sad Song de Godfrey Daniels, Whiz Kid de David Werner, les deux albums de Big Star, Zuider Zee, Van Dyke Parks, Michael Rother et The Moon avec David Marks qui avait joué dans les early Beach Boys. Ils sont aussi bien sûr amateurs de la scène locale : Beau Brummels, Byrds, Turtles, Doors, Love, sans oublier les Lovin’ Spoonful et Paul Revere & The Raiders.
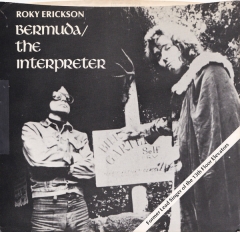
Au rayons des grands barrés Rhino, voici Roky Erickson. Rhino sort en 1977 un single magique, «Bermuda/The Interpreter» et Bronson nous décrit le Rocky dans un restau (the International House of Pancakes, ça ne s’invente pas) où après avoir dit qu’il était un alien commença à se barbouiller la figure de sirop de myrtille. Le lendemain, dans un autre restau, Roky se lève soudain et se met à chanter à tue-tête «President Ford is a square queen».
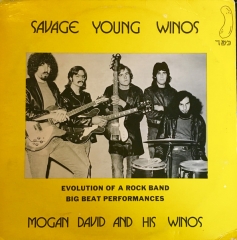
Bronson fait aussi partie de Mogan David And His Winos. Il existe un album qu’on ramassait à l’époque et qu’on revendait, car en dépit d’une pochette attirante (ils portent tous du cuir noir sur la photo) le contenu n’est pas de taille à conquérir l’Asie Mineure. Bronson avoue avoir voulu parodier les Beatles de l’époque Tony Sheridan et The Savage Young Beatles. L’album fut tiré à 1000 ex. Une grosse partie du pressage fut envoyé en France et jamais payée. Et puis un jour, on retombe dessus, dans le bac d’un disquaire parisien, alors on le re-ramasse. La pochette est toujours aussi belle, les cuirs noirs, la Rickenbacker. Harold Bronson est debout à côté du batteur. On ne sauve l’album que pour deux choses : «Street Baby» et la version toute pourrie de «The Last Time», en B. C’est Harold qui chante. Mais par contre, on se régale du jeu vif et alerte de Paul Rappoport, le guitariste. C’est lui qu’on entend dans «Love Potion Number One». «Street Baby» est du pur proto-punk et c’est uniquement sur ce cut que les Winos ont bâti leur légende, à l’époque. Le son de la B est comme on l’a dit tout pourri. Dommage, car ils ont un choix de reprises intéressant, notamment le «Last Time» signalé plus haut. Ils auraient presque le son, aw no ! Rappoport fait encore un carnage dans la cover de «Communication Breakdown». Ce mec est bon, il peut tenir la cocote de Jimmy Page.
Comme ils commencent à se lasser de la vente au détail, Foos et Bronson envisagent de monter un label. Bronson a trois modèles en tête : Apple Records, dont il apprécie la politique d’ouverture. Ensuite, Bizarre Records, fondé par Zappa et son manager Herb Cohen, qui en signant des artistes non conventionnels (Wild Man Fisher, Captain Beefheart et The GTOs), ouvraient la voie. Et puis bien sûr Elektra, où la dimension artistique prévalait sur les enjeux commerciaux - Qu’on soit capables ou non de suivre ces exemples n’était pas la question. Ils illustraient simplement nos aspirations.

Rhino est donc le personnage principal de ce gros book frétillant de vie. Bronson ne nous épargne aucun détail, il donne les chiffres, nous explique les mécanismes, nous montre comment ils sont obligés de bosser avec Capitol, puis de se faire racheter par Warner Bros. Il nous explique qu’en 1987, par exemple, ils génèrent 14 millions de $ de chiffre, ce qui est énorme pour un petit label. Ils viennent de sortir le nouvel album de Monkees (Pool It) et ont passé un deal avec Bearsville qui leur rapporte beaucoup, grâce aux rééditions de Todd Rundgren et de Foghat. Ils ont alors cinquante personnes en charge. Foos et lui continuent de parier sur la qualité des Rhino Records plutôt que sur les profits, c’est leur credo. Ils comprennent vite fait qu’ils doivent cesser de signer des nouveaux artistes, car chaque fois, ils se plantent et perdent de l’argent. En 1990, ils font 32 millions de $ de chiffre. Ils font notamment un carton avec la réédition de l’album live de Betty Wright (Betty Wright Live). En 1991, ils passent un deal avec Atlantic. À cette époque, Ahmet était encore au label, but in a reduced capacity. Alors Bronson est triste de ne pas trop fricoter avec lui : «Ahmet semblait ralenti par l’âge, mais ça ne l’empêchait pas de picoler (But that didn’t stop his drinking).» Val Azzoli glisse cette anecdote dans l’oreille de Bronson. L’épisode se déroule lors d’un meeting : «Après avoir sifflé douze vodkas, Ahmet a signé un lounge band au Grand Hyatt. Ils se sont pointés au bureau le lundi matin chez nous, à Atlantic, et on a dû les dédommager pour s’en débarrasser. Ce genre d’incident se produisait deux fois par an.»
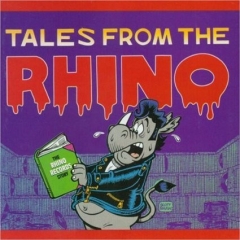
Pour bien mesurer l’importance de ce que représentait un label comme Rhino à l’époque, il est essentiel d’écouter Tales From The Rhino Records Story, un double CD qui offre un panorama assez complet du label et qui grouille de puces en or. Le disk 1 s’appelle ‘Novelty’. Ambiance Dada garantie, car ça démarre en force avec les deux pires traces du Dadaïsme américain, The Temple City Kazoo Orchestra et un Wild Man Fisher complètement fêlé. On croisera plus loin une cover de «Whole Lotta Love» par The Temple City Kazoo Orchestra : gag suprême ! Pur Dada jive ! Tzara Foos chante avec son monocle ! On tombe aussi sur le «Nose Job» de Mogan David & His Winos, un cut qui figure sur l’album évoqué plus haut. C’est un exemplaire unique au monde de gaga Dada. Au rayon farces et attrapes, voici Rockin’ Ritchie Ray et «Baseball Card Lover», une parodie d’Elvis - Baby show me a card - C’est atrocement moqueur. Au même rayon, voici Grefilte Joe & The Fish avec une parodie de Lou Reed : «Walk On The Kosher Side». Avec cette compile, on est au royaume des pastiches. Le meilleur exemple, c’est encore The Qworymen avec «Beatle Rap», hello lads ! Number nine ! C’est d’une incroyable véracité. Puis ils plongent avec The Seven Stooges dans la marmite de so messed up, mais au comedy act («I Wanna Be Your Dog»). Avec Bruce Spingtone, les Rhino se marrent bien («Bedrock Rap - (Meet) The Flintstones»).

Le disk 2 s’appelle ‘Rock’. Complètement une autre ambiance, puisque ça démarre avec le «Bermuda» de Roky Erickson - Master/ Master ! - Pas de meilleure introduction au génie libertaire des Rhino boys. Il semble d’après les liners que ce soit Harold qui ait enregistré le «Punk Rock Christmas» joliment glam des Ravers. On retrouve aussi Harold et ses Winos avec «All The Wrong Girls Like Me», une sorte d’hommage aux Herman’s Hermits. On passe aux choses sérieuses avec The Malibooz et «I Won’t Be Too Young», une power-pop des enfers, une belle révélation. Les mecs qu’on entend chanter sont Walter Egan et Lindsay Buckingham. Encore mieux : The Honeys avec «Running Away From Love», fast pop d’excellence carabinée, doublée de petit raunch féminin. On retrouve aussi les Beat Farmers avec «Bigger Stones». Vieille tarte à la crème. Pas de voix, ça ne peut pas marcher. Désolé les gars, d’autant qu’Harold y croyait dur comme fer. Par contre, House Of Freaks, c’est une autre paire de manches ! «40 Years» sonne comme de la pure magie, two house painters from Richmond, Virginia, nous doit le mec du booklet. Les House Of Freaks ont de l’allure. L’autre bonne pioche de Rhino, ce sont les Pandoras, avec «In And Out Of My Life (In A Day)». Pur gaga Rhino. Harold les comparait aux Bangles, plus pop, comme on compara jadis les Rolling Stones aux Beatles. Les Pandoras firent leur premier album chez Bomp, leur deuxième chez Rhino et allèrent après chez Elektra pour enregistrer un troisième album qui n’est jamais sorti. Autre bonne pioche Rhino : The James Harman Band avec «My Baby’s Gone» : excellent et même énorme ! Même chose pour Little Games, un projet monté par Harold. Terri Nunn chante «Ain’t Nothing But A House Party» et derrière c’est le Family Stone Greg Errico qui bat le beurre. Plus loin, on tombe sur le «Carolyn» de Steve Wynn, the crack of it all. Il a des allures de Bob Dylan. Fabuleux entertainer ! On apprend au passage que Steve Wynnn est un ancien employé du Rhino Record Store et qu’il a monté Gutterball avec House Of Freaks. On croise ensuite NRBQ avec «A Little Bit Of Bad», very big sound - A little bit of bad sounds good to me ! - Une pure merveille absolutiste. Et ce divin panorama se termine avec la reformation de Mogan David & His Winos et «I’m An Adult Now», pur jus de proto-punk expiatoire !
Pour tous ceux qui sont férus d’industrie musicale, l’autobio d’Harold Bronson est une mine d’or, car il ne cache rien. Quand il évoque des artistes plus longuement que ceux évoqués plus haut, il leur consacre carrément un chapitre. C’est bien sûr le cas pour les Monkees, les Turtles et The Knack. Tu trouveras l’éloge Bronsonien des Monkees dans ‘C’est Parti Monkee Kee - Part Three’ et prochainement, celui des Turtles dans ‘Turtlelututu Chapeau Pointu’. Vu leurs poids respectifs, ces deux groupes font l’objet de chapitres autonomes.
Les trois autres grands chapitres de ce book sont consacrés à Fear And Loathing In Las Vegas, Frankie Lymon et Tommy James. C’est là où Foos et Bronson deviennent fascinants car ils poussent leur passion pour certains artistes jusqu’à vouloir faire des films et donc ils créent Rhino Films, alors qu’ils n’ont pas vraiment les épaules financières pour se lancer dans ce type d’opérations à gros budgets. Mais ils le font et la façon dont en parle Bronson est passionnante, car il s’agit chaque fois d’une conduite de projet, avec tout ce que ça implique : naissance de l’idée, composition d’une équipe, évolution financière du projet, mésaventures et finalement réalisation et parution. Dans les trois cas, Bronson fait des miracles. Il est autant fasciné par Hunter S Thomson que par Frankie Lymon et le couple Tommy James/Morris Levy. On a l’impression d’entrer avec Bronson dans l’univers des intelligences supérieures, un monde de lumières diffuses et de sonorités bizarres, du genre blurp blurp.

Pour Fear And Loathing In Las Vegas, Bronson commence par approcher l’auteur, l’infréquentable Hunter S Thompson. Puis il cherche l’acteur : plusieurs choix, John Cusack, Brad Pitt, Keanu Reeves, Sean Penn, Nicholas Cage, Kevin Spacey. À part Cusack, ils sont trop chers. Ce sera Johnny Depp qui veut absolument le rôle, au point d’aller séjourner chez Thompson et de mimer ses attitudes, notamment sa façon de parler en murmurant de façon inaudible. Depp accepte le rôle pour $500,000 ce qui nous dit Bronson est largement en dessous de ses cachets habituels. Depp plait beaucoup, car il fume dans les endroits où c’est interdit et descend des packs de bières en réunion. Il faut ensuite un réalisateur. Le premier choix se porte sur Jeff Stein qui a tourné le docu The Kids Are Alright. Puis c’est Alex Cox, qui a fait Repo Man et Sid And Nancy. Bronson le trouve créativement très limité. Le montage du projet est à l’image du film, complètement barré. Pur jus de Rhino. Cox ne s’entend pas bien avec Hunter : il commence par refuser la saucisse qu’Hunter lui a fait cuire. Pourquoi ? Parce qu’il est végétarien. Il refuse aussi de s’asseoir à côté d’Hunter pour voir le foot à la télé. Hunter ne veut pas de Cox, mais Cox fait comme si tout allait bien. Il va même rencontrer Depp dans son club, le Viper Room, sur Sunset Strip et Depp lui dit qu’il ne travaillera pas avec lui. Il faut donc dédommager Cox ($62,500 et $46,800, ça va vite, les ardoises au cinéma) et trouver quelqu’un d’autre. On suggère alors le nom de Terry Gilliam. Plus facile à financer car plus connu. Bronson indique que le budget du film s’élève à $19 million. Gilliam produit un script qui est accepté. Bien sûr, Gilliam va exploser le budget de $2 million. Mais bon, on tourne. Bronson donne encore quelques chiffres : Thompson ramasse un cachet de $300,00, Del Toro qui joue le rôle de l’avocat Dr Gonzo $200,000, Gilliam et Depp $500,000. Mais commercialement, le film ne marche très bien. Trop de dope. Il est présenté à Cannes en 1998. Bronson dit qu’il n’aime pas le film : «Je pense que Terry est passé à côté. L’esprit du book de Thompson est le fun, alors que le film n’est pas funny. Terry a rajouté des éléments qui ne sont pas dans le book et qui n’apportent rien à l’histoire, comme par exemple le casting de nains.» Bronson ajoute que Depp a poussé trop loin son imitation de Thompson - Sa dedication était admirable, mais l’effet raté, trop cartoonish, avec des mouvements stéréotypés et une façon de parler trop neutre - Bronson indique en outre que le projet s’est terminé par un procès avec un co-financeur, Alexander, qui coûte $200,000 à Rhino, ce qui fait qu’ils ne gagnent quasiment rien avec ce projet. Pour Bronson, c’est l’un des pires moments de sa vie. Il a aussi maille à partir avec l’agent de Depp, une gonzesse féroce. Et d’une façon encore plus diplomatique, il remet Gilliam en place, car la collaboration a été rude, un vrai bras de fer : «Terry Gilliam peut être affable et charmant. Vu le nombre de désastres financiers dont il est responsable, on ne peut que lui souhaiter de mieux profiter de ses opportunités.» Bronson indique aussi que Gilliam et Depp ont viré Rhino du tournage, alors qu’ils sont à l’origine de projet. Depp jouera encore une fois pour Hunter dans The Rum Diary, un film qui coûte $45 million et qui se solde par plusieurs millions de pertes.
Fear And Loathing In Las Vegas est un film qu’on voit et qu’on revoit, même si effectivement Gilliam mord le trait, mais c’est pour ça qu’on le paye. Comme le book de Thompson est le book des excès, Gilliam en fait le film de tous les excès. C’est une véritable apologie des drogues et il n’est pas surprenant que ça ait planté. Too much is too much, mais il y a des moments superbes. Ils attaquent sur la route du Nevada à la mescaline et au sunshine acid. En arrivant à l’hôtel, Depp/Duke voit les lézards partout. Pur génie de Gilliam qui parvient à mettre en scène un acid trip qui vire au cauchemar reptilien. Puis ils se tapent de l’éther et vont tous les deux, Duke et Gonzo, dans un casino, et c’est la porte ouverte à tous délires. L’un des pics de Fear est la scène de la baignoire, avec un Gonzo sous LSD. C’est la drug-scene la plus géniale de l’histoire du cinéma, sur fond d’Airplane, avec «White Rabbit». Ils s’installent ensuite au Flamingo et retombent dans les excès hallucinatoires. Depp se balade dans une pièce remplie d’eau jusqu’au genoux affublé d’une longue queue de reptile. C’est encore le summum du délire, surtout quand il attaque la fiole d’adrenochrome, avec des petites mimiques facétieuses, il est au sommet de son art, la tête couverte d’une petite serviette orange. Il ressemble à une bigote espagnole sous acide. Le film est alors hors de contrôle, ça dépasse toutes les espérances du Cap de Bonne Experience. Have you ever been experienced ?

La passion de Bronson pour Frankie Lymon le conduit à lancer le tournage d’Only Fools Fall In Love. Frankie Lymon fut le premier teen rock’n’roll star. «Il n’avait que 13 ans quand son groupe the Teenagers fut catapulté en 1956 à la sixième place des charts avec «Why Do Fools Fall In Love». Les teenagers achetaient le disque parce que les chanteurs étaient aussi ados. Les autres stars du rock’n’roll à l’époque était beaucoup plus âgées.» Et il cite les noms d’Elvis, de Bill Haley, de Fatsy et des autres qui ont tous plus de vingt ans. Et c’est là qu’entre en scène George Goldner. Bronson a bien compris qu’on ne peut dissocier l’artiste de son découvreur. Frankie fut un chanteur et un danseur exceptionnel. Il est vite devenu un phénomène avec quatre titres dans le Top 50. Billy Vera : «Frankie was the best kiddie performer and singer there ever was.» À 12 ans, Veronica Bennett entend Frankie à la radio et inspirée par lui, elle va devenir Ronnie Spector. Dans les années 50, bien avant les Who et les autres, Frankie se fait virer des hôtels pour avoir secoué des bouteilles de bière et pour mauvaise conduite. Puis il se met à picoler et c’est Jimmy Castor qui le remplace sur scène quand il oublie de se pointer. Le manager des Teenagers n’est autre que Morris Levy. Quand Morris voit que les Teenagers sont jaloux de Frankie, il casse le groupe en deux, mais ça ne marche pas. Et puis en 1959, Frankie mue et sa voix change. Il devient une sorte de crooner et perd la magie. Il passe à l’héro en 1959. On connaît la fin tragique de l’histoire : overdose en 1968, à l’âge de 25 balais. Quand Rhino rachète le catalogue de Roulette, Bronson commence à vouloir faire un film sur Frankie. D’autres ont essayé, comme Martin Scorsese, mais ils se sont vautrés.
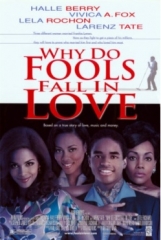
Alors, oui, il est indispensable de voir le biopic produit par Rhino et réalisé par Gregory Nava : Why Fools Fall In Love. L’angle que choisit Bronson pour raconter l’histoire est du pur Rhino : il part des trois veuves qui tentent de récupérer devant un juge l’héritage du pauvre Frankie. Pour des raisons commerciales, Nava soigne l’esthétique des trois veuves, Zola Taylor, Elisabeth Waters et Emira Eagle. Il soigne aussi son Frankie : une vraie gueule de blackos glamour, alors que dans la réalité, Frankie n’est pas terrible : on le voit chanter à la fin dans un doc d’époque et on ne peut vraiment pas dire qu’ils soit beau, avec ses yeux gonflés. Mais my Gawd, comme il bouge bien. Tous les plans scéniques reconstitués pour le biopic sont des chefs-d’œuvre : il faut le voir, le Frankie, danser avec une extraordinaire frénésie tout en doo-woppant comme un beau diable. Ces sont les trois veuves qui racontent son histoire. Elisabeth est la première à épouser Frankie en 1961, elle raconte l’audition des Teenagers dans le bureau de Morris Levy chez Roulette, swing énorme, les Teenagers ne sont pas tous blacks, ce sont des gamins qui ont grandi ensemble, chapeautés par un certain Richard Berry qui les accompagne au piano. Bronson réussit à faire entrer Little Richard dans le film : en tant que témoin, il vient déposer au tribunal. En 1956, il faisait partie de la tournée avec les Platters et Frankie Lymon. Tout ça se tient très bien, Little Richard met du poids dans la balance du film. Lors de l’Alan Freed Show en 56 à New York, toute la salle ondule quand les Platters chantent sur scène. Puis c’est au tour des Teenagers de monter sur scène et Frankie casse la baraque, il jette sa veste bleue dans la foule et il fait le grand écart en twistant son doo-wop. Puis les choses se dégradent au sein des Teenagers lorsque que paraît le single «Why Fools Fall In Love» crédité Lymon/Morris. Frankie entame alors une love story avec Zola Taylor, la chanteuse des Platters et l’épouse n 1965. Frankie passe très vite au junk et ça crée des tensions. On voit les Shirelles sur scène en robes vertes, puis Frankie s’écroule sur scène. Alors Elisabeth fait la pute pour lui. C’est Zola qui relance la carrière de Frankie en 1965 en Californie, l’occasion de le revoir danser et chanter pour l’émission Hullabaloo. Il refait sa Soul de doo-wop au frantic dance craze de trash twist. L’épisode Nola se termine mal et Frankie disparaît. Il part à l’armée et revient en 1968 à New York frapper à la porte de Morris Levy qui le traite de loser, d’has-been et qui l’envoie promener. Out ! Alors le pauvre Frankie fait une petite overdose. Morris Levy et Little Richard assistent à ses funérailles. Au tribunal, les avocats accusent Levy d’avoir barboté tout le blé de Frankie. On estime la somme à quatre millions de dollars. Bien sûr, les trois veuves ne vont rien récupérer, juste de quoi payer leurs avocats. Cette histoire tragique est tellement classique que Bronson a eu raison de prendre des libertés avec la réalité. C’est l’apanage des créatifs.

Bronson rêvait aussi de filmer la vie de Tommy James et bien sûr de Morris Levy. Il commence par rappeler qu’«Hanky Panky» fut à l’origine un cut des Raindrops, c’est-à-dire Jeff Barry et Ellie Greenwich. Barry n’aimait pas «Hanky Panky» qu’il qualifiait de «terrible song». Et pourtant, quel hit ! On a tous jerké là-dessus, à l’époque. Bronson ne lésine pas sur sa fascination pour Morris Levy : «Morris (Moishe) Levy était un Damon Runyon character : grand, trapu, bourru, avec des manières héritées de la rue. Rude enfance : son père et son grand frère sont morts quand il était très jeune. Il a appris les vertus du music-publishing quand il était co-propriétaire du Birdland jazz club à Manhattan.» Chaque fois que Bronson commence à brosser un portrait, c’est un peu comme s’il démarrait un scénario. Puis Levy monte Roulette et quand un artiste vient lui demander ses royalties, il répond : «Royalty ? You want royalty, go to England.» Non seulement il est intimidant, mais il est lié à la famille Genovese, c’est-à-dire la mafia. Tout cela est détaillé dans l’excellente autobio de Tommy James, Me The Mob And The Music. Bronson rappelle que Levy est mort d’un cancer du foie en 1990, sans jamais avoir purgé un seul jour de taule, alors qu’il avait été condamné pour extorsion. Tommy James rappelle aussi qu’à la fin de sa vie, Morris Levy avait une très grosse ferme, «une laiterie de plusieurs millions de dollars. Il transformait tout ce qu’il touchait en or. Il me dit un jour : ‘Pourquoi tu ne cherches pas une ferme dans le coin ?’ Il m’a trouvé une grosse ferme in upstate New York. Il a fait le premier paiement - avec l’argent de mes royalties - et j’ai pris l’emprunt à ma charge.» Puis Levy lui propose un job d’A&R chez Roulette. Évidemment, au bout d’un an, plus de sous. Alors Tommy James envoie son comptable qui revient en tremblant de chez Levy. Bronson sait qu’il tient un vrai personnage pour son film. En plus, l’histoire se déroule dans un contexte explosif : en 1972 éclate la guerre des gangs à New York et les Gambinos prennent le contrôle de la ville. Levy et Nate McCalla quittent le pays pour un an et s’installent en Espagne. Mais Bronson ne trouve pas de partenaire pour financer le projet qui tombe à l’eau. On peut se consoler avec l’autobio de Tommy James qui d’ailleurs fonctionne comme un film, tellement c’est bien foutu.

Parmi les films Rhino, il faut bien sûr citer Daydream Believers - The Monkees Story, qui fut un succès et dont on parle abondamment dans ‘C’est Parti Monkee Kee - Part Three’. Bronson évoque aussi Dick Dale: «Âgé de quarante ans, Dick était un très bel homme. Ce que j’appréciais le plus chez lui, c’était son énergie positive et ses aphorismes. Mais je n’aimais pas trop son anti moi-je. Il parlait de lui à la troisième personne. C’était peut-être dû au fait qu’il s’appelait Richard Monsour.» Bronson dit aussi que Dick et sa femme avaient un type d’échange très curieux, pas loin du baby talk - Magnifique et voluptueuse, Jeannie suçait une sucette - Bronson nous redit aussi ce qu’on savait déjà : Dick n’aimait pas ses albums studio pour Capitol, parce que le power du groupe sur scène y brillait par son absence. Puis Dick va basculer en enfer : il va perdre sa belle maison, vivre un sale divorce et finir dans une caravane garée devant la maison de ses parents. Il se fera un peu de blé grâce aux rééditions de Rhino. Puisqu’on est dans les monstres sacrés, Rhino se rapproche aussi de Phil Spector. Cette fois c’est Richard Foos qui fait les frais des excentricités de Totor. Finalement, Totor ne fera pas affaire avec Rhino mais avec Allen Klein et ABKCO (le fameux box-set que tout le monde a acheté à l’époque) - Quand ils ont passé leur accord, Klein et Spector s’amusaient du fait que les deux hommes les plus haïs dans le music business avaient réunis leurs forces.

Rhino voulait aussi signer les Go-Go’s, mais IRS leur a brûlé la politesse. Foos et Bronson essayent aussi de signer Wall Of Voodoo. Chou blanc. Ils réussissent à signer les Beat Farmers avec un budget ridicule ($6,000) et à leur grande surprise, ils vendent 50 000 albums. Mais le manager du groupe signe ailleurs pour un deuxième album, sans avoir, nous dit Bronson, «la courtoisie de passer un coup de fil pour nous prévenir». Rhino signe aussi les Pandoras et sort l’album Stop Pretending.
La fin de l’autobio n’est pas réjouissante. Comme Rhino appartient à Warner, Bronson explique qu’en 2005, il est poussé vers la sortie, pour des raisons banales : dans une très grosse boîte, la réduction de la masse salariale fait monter la cote des actions en bourse. Il n’a même pas eu droit au pot de départ, alors qu’il est co-fondateur. En 2001, il n’avait pas reçu de bonus. Quand il revoit par hasard le dirigeant qui l’a viré, Bronson a envie de lui demander pourquoi il a fait ça, mais il connaît la réponse : pour mettre un homme à lui à sa place. Foos va dégager deux mois plus tard. Bronson aurait préféré que Foos parte en même temps que lui, mais bon, ainsi va la vie. Plus grave encore : les noms de Bronson et de Foos ont disparu du Rhino website. On appelle ça de l’éradication managériale. Il ne doit rester aucune trace. Ouf, heureusement que Bronson a écrit son livre.
Signé : Cazengler, Harold bronzé
Harold Bronson. The Rhino Records Story: Revenge Of The Music Nerds. Select Books Inc 2013
Tales From The Rhino Records Story. Rhino Records 1994
Mogan David And His Winos. Savage Young Winos. Kosher Records 1973
Terry Gilliam. Fear And Loathing In Las Vegas. DVD 1998
Gregory Nava. Why Fools Fall In Love. DVD 2017
Patton en fait des tonnes

En vingt ans, Matt Patton est devenu une sorte de Sam Phillips de l’Alabama Sound. Bassiste émérite, on le retrouve dans les Dexateens et les cinq derniers albums des Drive-By Truckers (d’English Oceans jusqu’à The Unraveling). On le retrouve aussi dans les parages des grandes personnalités de la scène alabamienne, Lee Bains III et Dan Sartain. Mais c’est en tant que producteur de Jimbo Mathus, de Tyler Keith, d’Alabama Slim et de Bette Smith qu’il fait merveille. On le retrouve aussi en studio avec Leo Bud Welch, Paul Wine Jones, J.D. Wilkes et Candi Staton, pardonnez du peu.

Dans les années 2000, les Dexateens faisaient partie de l’excellente écurie Estrus, un label qui formait alors avec Crypt et In The Red une sorte de triumvirat définitif. Avec leur premier album sans titre, les Dexateens sortaient du lot. Ils ramenaient dans leur son un mélange détonnant de gaga-punk et de Southern rock, et on en prenait plein la barbe dès «Cardboard Hearts». Rien qu’avec l’immédiateté de sa violence et ses wild riffs d’Alabama, Cardboard raflait la mise. Elliott McPherson et John Smith croisaient le fer de leurs guitares et l’épatant Patton leur bourrait le mou au bassmatic. Et ça repartait de plus belle avec «Elrod». Ils avaient la fièvre chevillée au corps, ils balançaient de l’honey dans leur pétaudière, ils fonctionnaient comme une chaudière à deux temps et on allait tous se planquer aux abris quand arrivait le solo incendiary. Leurs descentes étaient des modèles du genre. Avec «Still Gone», ils jouaient encore au maximum des possibilités, en allant plus sur les Stooges et les Dolls, leur heavy boogie déferlait puissamment, mais sans la voix d’Iggy. Juste la tension nerveuse. Ils gavaient encore leur «Shelter» de son et explosaient littéralement le boogie down de «Settle Down». On entendait la fuzz de Tim Kerr sur «Cherry» et ils battaient encore bien des records d’agressivité sonique avec la doublette «Bleeding Heart Desease»/«The Fixer». Ils donnaient l’impression de forcer le passage, comme s’ils se taillaient un passage dans la jungle.

Tim Kerr est encore dans le coup, pour leur deuxième album paru l’année suivante, Red Dust Rising. Il est crédité en tant que Chancellor. Bon autant le dire tout de suite, cet album est moins dense que le précédent. On sauve cependant deux choses. «Bitter Scene», car c’est le la Stonesy d’Exile à l’état pur. Et «That Dollar», où les Dexateens noient leur extravagance alabamienne dans un gigantesque bouquet de chœurs. C’est une merveille de Southern gothic - I’m so far away - Ils cultivent l’éclat mordoré. Sinon ils proposent l’habituel brouet de heavy blues rock saturé de guitares fluides. Les deux guitaristes n’en finissent plus de croiser le fer. C’est une tradition dans la région. On savoure la belle fin vénéneuse de «Diamond In The Concrete». On s’éprend aussi très facilement du joli déroulé de gusto d’«Anna Lee», un véritable plâtras d’acide alabamien, une authentique purée de gaga-punk blues grumelée d’accords rouillés. Avec ces mecs, on touche au nerf de la guerre du Southern Sound, c’est une zone sensible, si innervante, ils chantent leur «Devoted To Lonesome» au sursaut de spasme épisodique, mais baby love, comme c’est bienvenu ! Impossible de faire l’impasse sur «Take Me To The Speedway». C’est très très. Dans le genre très, on ne fait pas mieux. Ils sont vraiment très. C’est important de le savoir. Il faut dire que leurs explosions sont très très. Le très, ça change tout. Les Dexateens sont le grand groupe très d’Alabama.

Avec leur troisième album, Hardwire Healing, les Dexateens montrent des signes alarmants de faiblesse. Si on emmène un cut sur l’île déserte, ce sera «Fyffe», car en voilà un qui sent bon la ferveur rurale, racé et pas commode, un brin menaçant, du genre à rôder dans les parages. Leurs gros accords claquent comme des allers et retours. Ils attaquent aussi leur «Naked Ground» à la bonne franquette, avec ces deux guitares qui interactent in the flesh. Tout se passe sous la ceinture de l’Alabama, ce sont des riffs locaux, aigus et fiers, ça dexateene dans les bois. Ils proposent aussi un «Makers Hound» visité par des vents de guitar slinging pour le moins extraordinaires. Mais chaque morceau semble soigné et on perd l’unité de ton qui fait la grandeur des albums d’Estrus. On perd aussi la patte de Tim Kerr. Au fil des cuts, on voit qu’ils s’épuisent, ils n’ont pas de jus, pas de compos, pas de rien. «Own Thing» sonne comme une petite power pop de MJC. L’album tourne rapidement à la déroute. «Outside The Loop» sonne comme un dernier spasme et ils renouent enfin avec l’énormité. Leur coup de Loop est assez déterminant. Ils traitent ça au soft groove d’Alabama et on leur donne le bon dieu sans confession.

Pas de surprise avec le Singlewide paru en 2009 : passé «Downlow» et sa belle niaque d’Alabama, l’album somnole. Ils ont définitivement abandonné le gaga-punk blues du premier album pour mûrir dans une espèce de country-rock classique, parfois bien foutu («Hang On»). les Dexa dexateenent, ils bossent à l’arpège retardataire. Leur big country-rock de company suit son cours avec «Same As It Used To Be», c’mon c’mon, avec un peu de lave qui coule dans le fond du son. Ça reste extrêmement Southern, ils s’isolent dans leur excellence, celle d’un country-rock intimiste qui devient extrêmement élégant («Granddady’s Mouth»). Tout est bien joué, tout est traversé d’éclairs, un peu comme chez les Drive-By Truckers. Ils terminent avec «Can You Whoop It», il y tombe un déluge de guitares et ce final cut s’envole assez facilement.

C’est Jim Diamond qui produit There Is A Bomb In Gilead, le premier album de Lee Bains III & The Glory Fires. Ils portent bien leur nom les Glory Fires puisque l’album s’ouvre sur un véritable feu d’artifice : «Ain’t No Stranger». Nous voilà dans le Bains ! Bon Bains d’accord ! Lee Bains sait lancer sa horde d’Alabamiens, il est dessus, c’est un chef né, sa façon de lancer l’assaut est une merveille et tout le monde s’écrase dans les fourrés avec des guitares killer. C’est exceptionnel de son, d’enthousiasme et d’envolée. Le problème, c’est que la suite de l’album n’est pas du tout au même niveau. On oserait même dire qu’on s’y ennuie. Ils ramènent pourtant des chœurs de Dolls dans «Centreville», ce qui les prédestine à régner sur l’underground alabamien, mais après le soufflé retombe. Plof ! Ils végètent dans une sorte de boogie rock sans conséquence sur l’avenir de l’humanité. Ils font du heavy revienzy de bonne bourre, comme les Gin Blossoms et tous ces groupes de country rock américain qui rêvent d’Americana, mais qui n’ont pas l’éclat. Avec «The Red Red Dirt Of Home», ils deviennent très middle of the road, c’est sans appel, le destin les envoie bouler dans les cordes, c’est trop country rock. Il ne se passe rien, comme dirait Dino Buzzati face au Désert des Tartares (attention, à ne pas confondre avec le fromage).
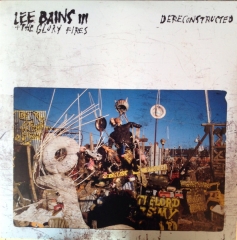
On reste dans les mains lourdes puisque c’est Tim Kerr qui produit Dereconstructed, paru sur Sub Pop en 2014. Dès «The Company Man», on est bluffé car les Bains développent une violence inexpugnable. Wow ! Et même deux fois wow ! Ils attaquent le rock à la racine des dents, ils te paffent dans les gencives. S’il fallait qualifier leur rock, on dirait in the face. C’est une horreur, une véritable exaction paramilitaire, toute la violence du rock est là, avec une voix qui te fixe dans le blanc des yeux, c’est d’une extravagance sonique qui dépasse les bornes. Alabama boom ! Ils font une autre flambée d’Alabama boomingale avec «Flags», c’est extrême, à se taper la tête dans le mur, tu ne peux pas échapper aux fous de Birmingham, Alabama. Oh mais ce n’est pas fini, tu as plein de choses encore sur cet album béni des dieux comme ce «The Kudzu & The Concrete» vite brûlant, viscéral, immanent, doté d’un power dont on n’a pas idée et d’un final apocaplyptique, ça balaye même les Black Crowes d’un revers de main, alors t’as qu’à voir. Toutes les guitares sont de sortie sur «The Weeds Downtown», toutes les guitares dont on rêve, c’est une sorte de summum du paradis rock, fooking great, dirait Mark E Smith, explosif, dirait le grand Jules Bonnot. On reste dans la violence alabamienne avec «What’s Good & Gone», encore une fois bien claqué, plein de son, extrêmement chanté, au-delà du commun des mortels. Si ces mecs n’étaient pas basés en Alabama, on les prendrait pour des Vikings, à cause de leur power surnaturel, poignet d’acier, rock it hard, mais avec l’aplomb d’une hache de combat. Ils développent un genre nouveau qu’on va qualifier d’outta outing, si tu veux bien. Même leur morceau titre est ravagé par des fièvres de délinquance, une délinquance de la pire espèce, celle qui rampe sous la moquette pourrie de ton salon. On savait que Tim Kerr était un génie de l’humanité, alors on peut rajouter le nom de Lee Bains dans la liste. Il est là pour te casser la baraque, son «Burnpiles Swimming Holes» t’envoie rôtir en enfer sur fond de Diddley swagger, c’est à la fois violent et beau, Lee Bains multiplie les exploits. On s’effare encore de «Mississippi Bottom Land» et de l’excellence de sa présence, de l’indécence de sa pertinence, fuck, ces mecs ramènent tellement de son que ça gonfle le moral de l’avenir du rock à block. Grâce à Lee Bains dis donc, l’avenir du rock navigue au grand large et respire à pleins poumons.
Matt Patton joue sur les deux premiers albums de Leo Bud Welch, Sabougla Voices et I Don’t Prefer No Blues. Comme Leo Bud Welch est un gros morceau, on lui consacre un chapitre ailleurs. On y reviendra sous peu.

Matt Patton joue aussi sur le troisième album de Paul Wine Jones, Stop Arguing Over Me. La grande particularité de Paul Wine Jones est qu’il sonne parfois comme Captain Beefheart. Ça saute aux yeux dès «Watch Me». Quel incroyable croisement des cultures Detroit/Delta/Beefheart. Oui, car cet album est enregistré à Detroit, en plein hiver, sous la neige, chez Matthew Sweet. Paul Wine Jones et ses deux musiciens n’ont ni manteaux, ni gants, ni chapeaux, mais ils sortent un son terriblement dévastateur, low-down et prodigieusement inspiré. Même chose avec «Down South» qui referme le bal de la B : voilà encore du primitif foutraque à gogo, presque sauvage, en tous les cas très beefheartien dans l’essence - The midnight train/ Goin’ down south - Le tain s’emballe fabuleusement, ça sonne comme «Click Clack», même énergie, même coup de génie. Matthew Smith fait sonner les premiers cuts de l’A comme ceux de Why Don’t You Give To Me, l’album de Nathaniel Mayer qu’il produisit jadis à Detroit. Même son en profondeur, avec une électricité qui se perd dans l’écho du temps. Avec le morceau titre, Paul Wine Jones fait son Hooky. Il balance là un vieux coup de boogie blast. Par contre, «Ain’t It A Shame» sonne plutôt comme l’un de ces longs cuts lancinants de Junior Kimbrough, avec une africanité qui remonte à la surface par la jambe du pantalon. Puis Paul Wine Jones repart en mode Hooky dans «Damn Damn Fool». Quel excellent preformer ! Il tape aussi dans le slow groove entreprenant avec «I’m So Lonesome». Voilà le son typique des groovers californiens de la grande époque, emmené par une bassline tagada très présente. On croirait entendre Harvey Brooks !
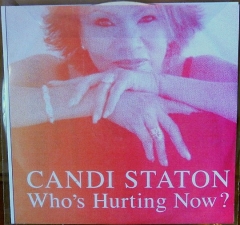
Attention, le Who’s Hurting Now? de Candi Staton est un très bel album. Il ne faut surtout pas le prendre à la légère. L’ordre des titres imprimé au dos de la pochette ne correspond pas du tout à celui des titres gravés sur le vinyle. On entre dans une sorte de magie dès «Breaking Down Slow». On sent la voix qui a macéré dans le temps. Candi est admirable de sensibilisme patenté. Son art se perpétue dans le temps. Elle continue se sortir de son gosier la meilleure deep Soul du Deep South, comme au bon vieux temps de muscle Shoals - Little by little you’re breaking down - Elle s’enfonce toujours plus profondément dans le deep - I’m breaking down slow - S’ensuit le morceau titre qui est un heavy groove majeur. Elle règne sur le vieil empire du deep groove et personne ne viendra plus lui disputer sa couronne, oh no no no no no. Elle retrouve sa vraie voix de Soul Sister pour cutter «I Feel The Same», un bon vieux boot de r’n’b rampant et solidement orchestré. Elle chante avec tout le chien de Tina, well well well, mais avec un style très personnel - Please believe me I feel the same - Oui, on la believe. On se régalera de «Lonely Don’t» qui ouvre le bal de la B, un balladif chanté dans l’intimité d’une féminité douce et chaude - Oh lonely don’t let me down - Et elle boucle ce bel album avec un «I Don’t Wanr For Anything» digne de Mavis Staples.

S’il en est un qui intrigue au plus haut point, c’est bien Jimbo Mathus. On plonge de temps en temps dans sa discographie tentaculaire pour faire un test et on en tire parfois des conclusions mitigées. Comme c’est le cas avec Incinerator qui bénéficie pourtant d’une belle pochette, mais c’est enregistré à Nashville et non à Memphis. Il démarre avec «You Are Like A Song», un heavy Nashville jazz bond de gospel blues. Mais il vous faudra attendre «Alligator Fish» pour trouver de la vraie viande. C’est gratté en connaissance de cause, au raw to the bone. Jimbo est un requin, il allume son cut au solo de folie pure, il baigne dans son jus, et ça tourne à la fantastique dégelée de puissance trash. Jimbo Mathus fait l’actu à sa façon, sans jamais forcer le passage. On le sait présent. Il est là. C’est le principal. Il fait pas mal de cuts qui ne servent à rien, mais ce n’est pas grave. Il est capable de coups fumants comme «Born Unravelling», un heavy balladif décontenancé allumé aux miss my baby de big atmospherix, c’est-à-dire au piano et aux chœurs de gospel. Il cultive l’esprit du Deep South. Dommage que le fin de l’album parte en eau de boudin. Les compos se veulent plus ambitieuses, on quitte le bord du fleuve et la vie sauvage en plein air. Jimbo jimbotte, il peut même devenir un peu pénible. Dommage, on aimait bien son côté planche pourrie.

On trouve aussi Tyler Keith dans les parages de Matt Patton. The Last Drag est un album qui en dit encore long sur heavy Matt et ses copains. Dès «You Can’t Go Home», on est frappé par l’ampleur du son. On se croirait à Memphis, on croirait entendre Jack Yarber ! Matt on bass et Jimbo on harp, fantastiques Alabamecs ! Ils ont le son, c’est une évidence. En fait, ils sonnent comme les Oblivians. Tyler Keith arrache «Take Me Home» du sol comme le ferait Greg Cartwright. Nouvelle férocité en ouverture de bal de B avec «In The Parking Lot», très pulsé au bassmatic, suivi de «Scarlett Fever», big fat rock flamboyant avec toutes les clameurs inimaginables, des coups d’acou, du beurre et du bassmatic, tout est en excédent. Ils montent «Down By The...» comme un cut des Cramps et cette belle aventure se termine à l’Obliviande avec «Have You Ever Gone Insane», Just perfect ! C’est plein d’allure, plein d’allant et d’avenants, sans doute le grand album que n’ont pas enregistré les Oblivians.

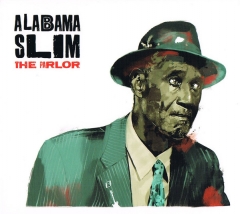
L’album d’Alabama Slim qui vient de paraître sur Cornelius Chapel Records (le label des Dexateens) est une sorte de modèle du genre : l’album d’un vieux blackos produit par un blanc, mais un blanc qui sait se tenir et qui ne la ramène pas avec ses guitares psyché, car oui, Alabama Slim chante le blues sur The Parlor. Matt Patton respecte le vieux Slim et du coup ça sonne comme l’un des grands albums de John Lee Hooker. Dès «Hot Foot», on est dedans, Matt et Jimbo s’effacent, c’est Alabama Slim qui swingue ses notes sur sa guitare primitive, c’est puissant, taillé pour la route, hole in my heart, il joue ça au miss you babe. Sur le «Freddie’s Voodoo Boogie» qui suit, Little Freddie King claque des notes qui réveillent le fantôme d’Hooky. Fantastique shoot de voodoo boogie ! C’est absolument dément ! - Baby you got the voodoo put on me - Primitif, toujours primitif, on croirait entendre du early Hooky. Alabama Slim va dans le heavy blues avec «Rob Me Without A Gun». Il sait de quoi il parle, oooh just stumble my mind, il ramone son heavy blues à sec et il revient dans le boogie d’Hooky avec «Rock With Me Momma», c’mon, c’est du all nite long, hey hey babe, I love the way you rock. Pur sex ! C’est bien qu’un mec comme Matt l’accompagne. Pas de take over, pas d’intrusion ni de détournement, pas d’ego de petit cul blanc dégénéré dans la balance, Matt respecte le son et l’espace d’Alabama Slim. Il chante son «Forty Jive» au mieux des possibilités du groove et il revient au cœur du mythe d’Hooky avec «Someday Baby». C’est le son, on assiste à une fantastique résurgence du son de base, Alabama Slim joue son solo à la ramasse de la déglingasse, c’est du non-solo éclatant de non-m’as-tu-vu. Ah si seulement Clapton savait jouer comme ça ! Il termine cet album envoûtant avec «Down In The Bottom» qui est comme son nom l’indique un fantastique heavy blues, un vrai rêve de bottom, il y descend pour de vrai, Alabama Slim ne frime pas, oh yeah, c’est du claqué de la dernière heure.

Matt Patton produit aussi les Williamson Brothers dont l’album sans titre est paru en 2021. Il y joue aussi de la basse, bien sûr. Gros départ en trombe avec «Take Back The Summer». T’as intérêt à aller voir sous les jupes de ces mecs-là, car il y a du spectacle. C’est violemment secoué du cocotier, ils jouent le push in the push, tu en prends pleine la gueule, comme on dit à Terre Neuve au moment des tempêtes. Petite cerise sur le gâtö : c’est hanté par le bassmatic de Matt the crack. Adrian & Blake Williamson ramènent un son de présence fondamentale et ont un sens de l’attaque qui les distingue du commun des mortels. Les frères Williamson roulent ma poule, ils sont dans le vrai, l’incroyablement vrai. Ils amènent «Pressure’s On» au big riffing d’absolute beginners, c’est encore du big fast rock d’Alabama starters, monté sur un rebondi de gaga rootsy, chanté au crutch de délinquency. Ils ont l’une des plus belles niaques d’Amérique, ils savent balancer des giclées de guitares. Ils jouent le rock intempestif et on a la big prod de Matt, as usual. Encore du power à gogo avec «Kick & Scream». Cette fois, ils soutiennent leur cut à l’orgue dylanesque et développent une énergie considérable. Ça s’achève sur un final d’orgue en forme de punch-out demented. Ils terminent ce Patton album avec un «Losing Faith» qui sonne encore une fois comme une aubaine inexpugnable. Leur sens aigu de la clameur les honore.

En 2019, Matt Patton produit aussi l’album Bloodroot des Bohannons. On est tout de suite séduit par le heavy sludge de «Sleep Rock», les Bohannon Bros t’éclatent le rock vite fait, ça joue à la revoyure, c’est du pur jus de Black Dial Sound. Tout ce que produit Patton est du golden stuff, Matt et Marty Bohnannon jettent tout leur Bohannon dans la balance. On a là l’un des grands disques américains de 2019. Avec «Girl In Chicago», ils ramènent le power du pounding. Même les arpèges sont survoltés. Quant au beurre, inutile d’en parler ! C’est du stomp. Et le bassmatic gronde comme un lion en cage. Puis ils perdent un peu le fil, c’est dommage, ils font un peu de heavy rock à la Neil Young («Refills») et du heavy cousu de fil blanc («My Dark Boots»). Mais bizarrement, avec les Bohannon, ça passe bien. Ils s’arrangent pour passer des solos de destruction massive et pour maintenir leur pop-rock à un bon niveau. Ils font leur petit biz.

Matt Patton joue aussi de la basse sur l’album d’Adam Klein paru en 2019, Low Flyin’ Planes. Les premiers cuts de l’album laissent une mauvaise impression : tiens, encore un péquenot qui se prend pour un songwriter et qui fait n’importe quoi, le genre de son qui reste dans la moyenne ennuyeuse. Quand on regarde sa photo au dos du digi, ça n’aide pas : coiffé d’un chapeau blanc, il gratte sa gratte. À part les fans de Matt Patton, qui va aller acheter ça ? C’est un son qu’on a déjà entendu mille fois, tous les Américains grattent la même pop d’acou à la con, ils restent enracinés dans leur petit pré carré, mais si on écoute plus attentivement, on s’aperçoit que Matt the crack donne une certaine allure à l’ensemble. Au bout de trois cuts, ça menace même de dégringoler dans l’excellence. Alors la voilà l’excellence, avec «Too Cool For School», chauffé au folk-rock, avec une niaque extraordinaire, et on retrouve la patte de Matt, cette énergie qui n’appartient qu’à ces mecs-là, c’est wild et libre comme l’air, absolute balèze blast de country fair, c’est Matt the crack qui porte le son. Très beau cut encore que ce «Dog Days», coulé comme un bronze au petit matin, superbe, fumant et odorant, ce mec taille sa route. Comme dirait Alain Delon, Monsieur Klein fait des siennes. Sur «Pretty Long Time», il sonne exactement comme Nikki Sudden. Puis il amène «Sport» au big heavy Klein. Alors on applaudit Matt bien fort.
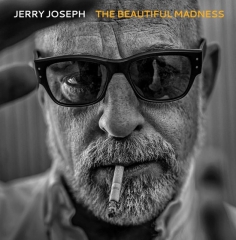
Attention à ce big album de Jerry Joseph qui s’appelle The Beautiful Madness. Sur la pochette, le pépère n’a pas l’air frais, mais ses chansons vont te faire tourner la tête. Surtout «Sugar Smacks» qui sonne comme le real deal. Laisse tomber Auerbach et les autres opportunistes, c’est Patton et tous ces mecs-là qu’il te faut. «Sugar Smacks» est balayé par des vents stupéfiants, meet you baby, à son âge, il cherche encore les ennuis, il tape ses lyrics vite fait au help me back, c’est puissant, heavy et profond - Take me back / To my sugar smacks - Jerry Joseph est le Dylan de l’underground moderne. Patton est là, mais c’est Patterson Hood qui produit et qui gratte sa gratte. Patton gronde sous la surface du son de «Good», encore un cut d’une exceptionnelle intensité. The rasping voice de Jerry Joseph rappelle celle de Graham Parker, mais dans ce contexte, c’est encore autre chose, les coups de slide paraissent surnaturels et Matt Patton relance à la basse. C’est follement inspiré, avec ces coups de slide aériens et le bassmatic dévorant du grand Matt Patton, c’est grounded to the earth - It’s coming back on me/ I know ! - Stupéfiante énergie ! Jerry Joseph développe son petit biz, on sent le souffle dès «Days Of Heaven». Il chante son rock avec une voix de vieux qui a la vie chevillée au corps. C’est sans doute la présence des Drive-by qui donne des ailes au vieux dans «Full Body Echo». Il tape plus loin un heavy balladif avec «(I’m In Love With) Hyrum Black», que Patterson Hood qualifie de «Mormon Outlaw Cowbow Song». Il défend bien son bout de gras, au moins autant que les Drive-by - He smelled of blood in the desert - Il raconte une vraie histoire de l’Ouest. On redescend dans le Sud avec «Dead Confederate», un dead confederate qui à l’âge de 80 ans ne lâche toujours rien - Wish they’d just leave me alone - Il explose plus loin son «Eureka» au day that he died you know/ You were going back to Eureka. Dans le booklet, Patterson Hood raconte comment il a fait la connaissance de Jerry Joseph à Portland, Oregon, en 1999, puis il donne tout le détail des sessions d’enregistrement de cet album chez Matt Patton, à Walter Valley, Mississippi.

Joli nom pour un groupe que celui de Dead Fingers. Leur album sans titre est paru en 2012 sur Big Legal Mess Records, ce qui veut dire ce que ça veut dire : produit par Bruce Watson. Dead Fingers est un duo de Death Country à la Blanche, Taylor Hollingsworth mêle sa voix d’anguille vermifugée à celle de Kate Taylor Hollingworth pour le meilleur et pour le pire. Leur drive à deux voix est excellent, leur son sent bon la charogne du désert. Il faut attendre «Against The River» pour les voir s’énerver un peu. Les gens du Sud savent mettre le feu quand il faut. Taylor Hollingworth passe des killer solos flash, il n’a besoin de personne en Harley Davidson. Ils sont impayables lorsqu’ils chantent à deux voix mêlées, «On My Way» est excellent et plein de jus. Puis il prend «Lost In Mississippi» à la petite voix humide. Ce mec chante comme un démon. Il est rejoint par des chœurs très moites, c’est encore fois excellent, bien moisi, avec des coups d’harp. Il amène ensuite «Never Be My Man» à l’envenimée de la big disto et des coups de bottleneck. C’est tout simplement énorme. Ils disposent de gisements de ressources extraordinaires. Affaire à suivre.
Signé : Cazengler, échec et Matt
Dexateens. The Dexateens. Pickmark Records 2004
Dexateens. Red Dust Rising. Estrus Records 2005
Dexateens. Hardwire Healing. Rosa Records 2006
Dexateens. Singlewide. Skybucket Records 2009
Paul Wine Jones. Stop Arguing Over Me. Fat Possum Records 2016
Bette Smith. The Good The Bad And The Bette. Big Legal Mess Records 2017
Jimbo Mathus. Incinerator. Big Legal Mess Records 2019
Candi Staton. Who’s Hurting Now? Honest Jon’s Records 2008
Tyler Keith. The Last Drag. Black & Wyatt Records 2020
Alabama Slim. The Parlor. Cornelius Chapel Records 2021
Williamson Brothers. Williamson Brothers. Dial Back Sound 2021
Bohannons. Bloodroot. Cornelius Chapel records 2019
Adam Klein. Low Flyin’ Planes. Cowboy Angel Music 2019
Jerry Joseph. The Beautiful Madness. Cosmo Sex School 2020
Dead Fingers. Dead Fingers. Big Legal Mess Records 2012
L’avenir du rock
- Syndicate d’initiatives (Part Five)
Alors qu’il s’était bien juré de ne plus jamais le faire, l’avenir du rock a fini par accepter de participer à un débat télévisé, dans le cadre de l’émission «Vous l’Avez Dans l’Os», suivie régulièrement par des dizaines de millions de gens à travers le pays. Cette semaine, le thème du débat est «L’inexorable déclin de la civilisation». Sur le plateau de télé, alors que tous les intervenants tirent des gueules d’enterrement et déballent posément leur sinistre argumentation, l’avenir du rock sourit. Choqué par tant de désinvolture, l’animateur l’interpelle :
— On dirait que ça vous fait rire, avenir du rock, de voir notre société s’effondrer sous nos yeux, de voir nos valeurs républicaines flotter dans le caniveau...
— Non, je n’irai quand même pas jusque-là. Ce sont les têtes que vous tirez tous qui me font marrer. Vous êtes tous tellement lugubres, on dirait que vous faites un concours... Alors on imagine la gueule des gens derrière leur télé ! Déjà que les gens ne sont naturellement pas très gais, alors à vous voir, ils vont battre tous les records de déprime !
— Vous ne faites donc pas le même constat que vos voisins ?
— Pas du tout ! Cette médiatisation de la déprime est une insulte à l’intelligence de l’Homme. Il n’y a pas que la politique, l’économie, la santé publique et le chômage, dans la vie. Vous semblez oublier le plus important !
— Nous attendons votre réponse, avenir du rock !
— Le Syndicate !
Les autres invités se mettent soudain à gueuler. Gros bordel sur le plateau !
— Ce monsieur se fout du monde ! Il ose faire l’éloge de la CGT ! C’est un provocateur ! Sortez-le d’ici ou nous quittons le plateau immédiatement !
L’avenir du rock se gondole dans son fauteuil. Il n’a jamais vu des gens aussi cons. L’animateur tente désespérément de ramener le calme. Un général invité pour parler des guerres qui menacent les frontières s’est levé :
— Monsieur l’avenir du rock, vous êtes un traître à la nation ! Vous mériteriez d’être fusillé !
L’avenir du rock n’en peut plus. Il en pleure de rire. Il les supplie d’arrêter leurs conneries.
Madame Bignolle, invitée pour témoigner des graves problèmes des petits retraités, est la plus virulente. À travers ses larmes de rire, l’avenir du rock n’en revient pas de voir cette grosse femme en mini-jupe le menacer du poing :
— Vous faites honte à la télévision, avenir du rock !
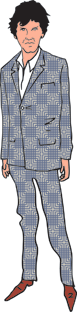
Le Syndicate que l’avenir du rock proposait comme un plâtre sur la jambe de bois médiatique est bien sûr le Dream Syndicate. C’est un coup d’épée dans l’eau, puisque tous ces cons n’iront jamais écouter le nouvel album du Dream Syndicate, mais d’autres gens, surtout ceux qui ne regardent pas la télévision, ne manqueront pas de le faire et vivront un petit moment d’extase. Un moment d’extase + un moment d’extase = une vie bien remplie et, un sourire gourmand au coin des lèvres, l’avenir du rock ajoute qu’il existe encore des kyrielles de moments d’extase en devenir. Car les grands artistes ne vont pas disparaître de sitôt. La preuve ? Steve Wynn continue d’enregistrer de très beaux albums.

Tiens, justement, very big album que ce These Times paru en 2019. L’extrême musicalité des Dream ne faiblit pas, comme le montre «The Way In». Même attaque qu’avant, même acid freak-out de guitares, ça sent bon l’engagement. Ils se jettent dans leur son avec un aplomb en or. C’est du ferraillage Paisley réactualisé. Sacré Wynner, il ne perd rien de son prodigieux allant, comme le montre «Put Some Miles On». Il sait rester tendu et actif, il drive son schisme au nez et à la barbe des chapelles, il est unanime et complet, tenace et azuré de son. Tout est dans tout, mais lui n’est dans rien, il chante au nez et à la barbe des pâquerettes avec un sens de l’inhérent qui peut troubler les âmes sensibles. Il ne vit que pour l’échappée belle. On ne rêve plus que d’une chose : du Dream forever. Avec «Black Light», il sort un son qui se prête à tout, principalement à l’escapade en haute montagne. Il explose le concept de la black light et les notes de Jason le démon se perdent dans la stratosphère. «Bullet Holes» se veut infiniment plus pop. Ce diable de Wynner chante comme the last dandy on earth. C’est du très haut niveau, il va loin, it’s alrite, avec ce balladif émerveillé. Il passe à l’apesanteur apesantie avec «Still Here Now». Il sait de quoi il parle, en tant que vétéran, et derrière lui Jason le démon dépote son naphta. Ils jouent à l’acid freak-out californien, ils décapent le mur du son, Jason fissure l’atome au beautiful remugle, what a guitar muggler ! Comme l’indique son titre, «Speedway» file ventre à terre. C’est du big Wynn gagné d’avance, bien cogné dans les encoignures avec un Jason le démon en embuscade. Ces gens-là n’en finissent plus de jouer avec le feu. Fantastique plâtrée d’excellence ! Avec «Recovery Mode», le Wynner repart en mode vainqueur. C’est sacrément anthemic. C’est même de la heavy psychedelia, fine et racée, chantée dans les règles du lard fumant. Avec «Space Age», le Wynner va droit dans l’extrême onction. Les guitares ne pardonnent pas. Ils terminent avec «Treading Water Underneath The Stars». Perché sur l’épaule du cut, Jason le démon va fondre sur sa proie. Aw quelle rapacité ! Tout se passe entre les oreilles, juste en dessous des étoiles. Ces mecs relèvent de l’indestructabilité des choses du rock.

Et si The Universe Inside était le meilleur album du Dream Syndicate ? Comme ils optent pour les morceaux longs, alors nous aussi. «The Regulator» dure vingt minutes. Combien ? Oui vingt minutes. Ah bah dis donc ! Ils se basent sur un riff de basse et mettent le cap sur le psyché intrinsèque. Attention, Steve Wynn n’est pas un amateur, il sait ramener les brebis au bercail. Quel fantastique rameneur de brebis égarées ! Les Syndicalistes jouent à la folie des forges qui n’ont jamais existé en Californie. Leur son coule dans l’air du temps, c’est une fabuleuse dérive absconse émaillée de rots de basse - I’m the regulator - Steve Wynn fait son vieux robot de la Caisse d’Épargne. Ce routier de la transe acid sait ce qu’il fait, il part en mode groove de non retour, ça se remplit comme une crique d’une marée de son et d’esprit, dans le style de Cubist Blues, mais avec encore plus de temps et d’élasticité, ils réussissent le prodige de swinguer l’espace temps, on ne sait même plus où ils sont passés, il doivent se trouver par là, ils battent tous les records de nonchalance et s’enfoncent dans la dimension syndicaliste, ils jouent à contre-courant des modes, donc à l’envers du temps, leur rock devient philosophique, tu es barré avant même d’avoir pu dire un mot, c’est le trip du Syndicat, un trip gratuit à la Syd Barrett, un sax vient te nettoyer les oreilles et te rafraîchir et puis le génie de Steve Wynn n’en finit plus de nous sécuriser, cet homme est beaucoup plus puissant qu’on ne le croyait. Il utilise le groove interminable pour nous faire voyager dans les meilleures conditions, les virages et les montées se succèdent. Le sax sonne comme un accent de vérité. Pas besoin de prendre un truc pour écouter cet album. L’acide est dans le son. Le sax aussi, il est dans les montées et les descentes. Le Syndicat se montre aussi décisif que Sun Ra ou les Spacemen 3. Alors Steve Wynn fout la gomme et le sax démonte la gueule de Dieu qui se penchait pour regarder de plus près, la musique monte toute seule en température, elle n’a plus besoin de personne en Harley Davidson. Grâce au sax, le groove transgresse les genres, ça grouille de remontées souterraines inexplorables, les perceptions s’écartèlent à vouloir tout brûler, ça se fibrille dans l’underground planétaire et tout se disloque dans des concoctions diffamatoires. Steve Wynn pulse le son à la folie Méricourt, sa dérive échappe au regard, il se grille commercialement mais il s’en fout, seule compte l’envolée déterminante. Évidemment, on s’étonne quand ça s’arrête. Ils repartent avec «The Longing», une nouvelle élongation du domaine de la lutte Syndicale montée sur un beat si bienvenu. Steve Wynn réussit le prodige de rôder dans le timbre de sa voix. Il est encore plus à l’affût qu’à l’époque de ses débuts. Et pendant ce temps, Jason le démon promène son cul sur les remparts de Varsovie. Il y joue ses notes de la planète Mars et s’amuse à narguer l’apesanteur. La basse ramène la bouffe au cut Moloch. Une fois encore, ils jouent les prolongations. Si on ne devait retenir qu’un seul cut pour la postérité syndicale, ce serait sûrement «Apropos Of Nothing». Car c’est un cut très séduisant, ils sont là dans une énergie anglaise, dans une sorte de nonchalance. Cut merveilleusement beau, comme visité par la grâce. Steve Wynn dispose d’une modernité d’esprit qui lui permet de réussir ce genre de coup d’éclat. Incroyable exercice de style. Ils jouent ça au fin du fin. Ils embarquent «Dust Off The Rust» pour Cythère avec une big into de basse, puis ça vire hypno à la Babaluma. Jason le démon en profite pour voyager dans le son. On entend des cuivres dans le fond du cut. Cet album est un voyage extraordinaire. Rien à voir avec le Syndicalisme habituel. Ils sont dans un délire de transe hypno cuivrée de frais. Les grooves sont parfois un peu gratuits, mais ils ne sont que prétextes à dérives. Ils terminent avec les remugles de sax de «The Slowest Rendition». Steve Wynn revient au chant. On sent le meneur. Ça joue dans les clameurs du soir. Mais le story-telling de Steve Wynn ne fonctionne pas à tous les coups - I can hear those bells again - Il est dans un processus hallucinatoire, il a du temps. C’est toujours plus facile quand on a du temps. Ce dernier cut est relativement inexistant. On l’écoute uniquement parce qu’on aime bien Steve Wynn. Consciencieux, il reste jusqu’au bout.
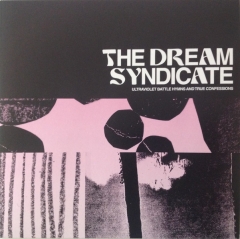
Joli retour du Wynner cette année avec Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions. Nouveau Dream come true et attention, «Where I’ll Stand» est heavy dès l’abord. Le Wynner te tombe aussitôt sur le râble, tu dis amen car ton sort est scellé. Allez, on a va le redire encore une foie : Steve Wynn a du génie. Mais tout le monde le sait. Avec son Stand, il développe une apocalypse de son extrême, il vise la sinécure du rock atmosphérique, ça te tombe dessus, tu ne peux rien faire. Steve Wynn te tourne autour du pot depuis quarante ans et ça continue, il est devenu une sorte de tenant de l’aboutissant du rock californien, ça pleut de partout et tu remercies Dieu d’avoir crée le Wynn. Et bizarrement l’album se met à fléchir, avec une série de cuts moins décisifs, un brin new-wave, que Wynn chante à l’appuyé. La magie s’éclipse, il tente le coup des syllabes appuyées, très appuyées, et du coup, on voit qu’il chante d’une voix de vieux. Chant fripé de vieux Wynn. Il faut attendre «Every Time You Come Around» pour renouer avec le Wynn qu’on admire. Belle clameur de Dream, back to the big sound ! Ouf ! C’est même du haut vol de downtown Wynn, il crée sa magie avec une bassline dansante, retour à la grandeur du rock américain, et notre Wynner international réinvente la magie hypnotique du Velvet. On entend aussi Jason le démon faire des siennes dans «Trying To Get Over», fast oh so very fast. Voilà tout.
Signé : Cazengler, Steve wine (cubi)
Dream Syndicate. These Times. Anti- 2019
Dream Syndicate. The Universe Inside Anti- 2020
Deam Syndicate. Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions. Fire Records 2022
Inside the goldmine
- Le jour de Jackie Day viendra
Robert Mitchoum et son bataillon étaient coincés sous le feu de l’ennemi, à Omaha Beach. Les boches canardaient sec, Mitchoum voyait les rafales découper en rondelles ceux qui avaient été fauchés sur la plage. Tchakatchakatchak, une vraie boucherie, des mains, des pieds et des éclats d’os volaient partout. Mitchoum en mordillait de rage son résidu de cigare. Fucking boches !, grommelait-il. Les balles sifflaient dans tous les coins, impossible de bouger, au moindre mouvement, on recevait une bastos en pleine gueule. Un vrai tir aux pigeons. Pour la première fois de sa vie, Mitchoum s’était fait piéger comme un bleu. La honte de sa vie ! Il se tourna vers le radio, allongé derrière lui, mais le radio ne bougeait plus. Mitchoum le retourna et vit qu’il avait reçu un pruneau en pleine terrine, fucking boches, il en avala son résidu de cigare et faillit s’étrangler. Il ramena le poste radio vers lui pour lancer un SOS :
— Ici Tango Charlie, can you hear me Major Tom ?
— Cinq sur cinq, Tango Charlie... À vous... Qui qu’y a ?
— Quoi qui qu’y a ? Troisième bataillon cloué sur Omaha, 3/4 des hommes à terre, all fucked up, envoyez l’aviation, bordel de merde !
— Faut demander ça au D-Day boss, baby !
— Quoi ?
— D-Day boss !
— Hein ?
— Touchez ma D-Day boss, monseigneur, eh eh eh...
Mitchoum se mit à chialer. Dans la radio, l’autre se mit à chanter comme Sœur Sourire :
— D-Day boss bosse bosse bosse/ S’en allait tout simplement/ Routier pauvre et chantant, la la la lalala...
Outré, Mitchoum sortit son flingue et vida le chargeur sur le poste de radio.

Bon, Jackie Day n’a de commun avec Omaha que le mot Day, rassure-toi. Il n’empêche que The Complete Jackie Day - Dig It The Most, compile parue sur Kent en 2011, sonne comme une sorte de D-Day de la Soul. Car Jackie Day ne chante pas, elle débarque pour libérer tout un continent. Kent nous régale encore une fois d’une histoire extraordinaire. Cette fois, c’est Jim Dawson qui s’y colle. Vas-y Jim ! Mais ça commence mal, car il nous raconte que les singles de Jackie Day se vendent une fortune sur Ebay, plusieurs milliers de dollars ! Heureusement Kent nous fait faire des économies avec sa compile. Plus besoin d’aller braquer une banque.
Jackie Day est une petite black originaire de l’Arkansas, comme Tav Falco, et quand son père se fait la cerise, sa mère part installer la famille à San Francisco. Jackie a son premier gosse à 17 ans et se met en ménage avec le saxophoniste Big Jay McNeely. Puis elle rencontre Maxwell Davis que Leiber & Stoller qualifient de truly one of unsung heroes of early rhythm & blues. Davis avait tourné avec Louis Jordan et Amos Milburn, puis il a bossé pour Aladin et Modern (le label des Bihari Brothers), des labels qu’il faut bien qualifier de mythiques. C’est en bossant avec Davis et en enregistrant «Naughty Boy» que Jackie McNeely devient Jackie Day. Elle entame donc sa période Modern avec «Naughty Boy». Mais ça peine à décoller. Les Bihari arrêtent les frais avec Modern et continue avec le subsidiary Kent - un nom label que les Anglais d’Ace ont repris, en hommage (comme d’ailleurs Ace, en hommage à l’Ace de Johnny Vincent) - Alors que fait Jackie ? Elle va trouver Art Rupe chez Specialty. C’est là qu’elle enregistre sa chanson hommage à Martin Luther King «Free At Last».

On retrouve bien sûr «Free At Last» sur la compile - I am black/ I am a woman - Elle chante sa liberté, soutenue par des chœurs de gospel et là tu entres directement dans la mythologie. Jackie Day est la petite black juste par excellence. Quant à «Naughty Boy», le fameux single paru sur Phelectron et qui vaut des milliers de dollars, c’est un passage obligé. Voilà un hit embarqué au meilleur beat de r’n’b, à la magie pure, avec des cuivres et un drive de chœurs d’ah-ouhouh, elle fonce, c’est le hit parfait. Sur les 20 cuts de la compile, la moitié sont des hits faramineux. Elle attaque en force avec le «Before It’s Too Late» sorti sur Modern en 1966. Jackie est une battante, elle n’y va pas par quatre chemins - I said before it’s too late/ You better stop yeah yeah - C’est une rare violence, retire tes pattes, elle ne rigole pas, dégage connard ! Tous ces singles Modern sont des must, elle fait montre d’une extraordinaire maturité sur «Oh What Heartaches», comme elle est ferme, sa Soul en tire tous les avantages. Elle restera dans les annales pour sa fermeté. Elle chante avec une voix terrible et des grands gants blancs, il faut la voir embarquer «Long As I Got My Baby» au don’t need et les chœurs font ooh ooh. Quelle allure ! Elle claque son «Got The Steppin’» au steppin’ pur, fantastiques coups de come back no more, elle est exceptionnelle et puis il y a ce solo de sax. On est gavé. Encore trois cuts Modern enchaînés : «If I’d Love You», «What Kind Of Man Are You» et surtout «I Dig It The Most» qui est un véritable coup de génie, elle jette toute sa niaque dans sa Soul, son dig it the most flirte avec le génie. Elle fracasse le heavy slowah d’«If I’d Love You» au your dream is my dream too et elle règle encore ses comptes avec «What Kind Of Man Are You» - You took my money/ Without a word/ What kind of man are you - Elle ne pige rien en matière de psychologie masculine, can’t you ever be satisfied, eh oui, c’est énorme. Avec «I Can’t Wait» elle arrive sur Paula, un label de Shreveport, en Louisiane, c’est plus classique mais plein de son, fabuleux shoot de r’n’b et elle débarque ensuite chez Specialty avec «What’s The Cost». Elle rentre dans le lard du r’n’b avec un talent fou, sans forcer, elle est simplement Jackie Day. Si on doit emmener une petite black sur l’île déserte, c’est forcément Jackie Day. Elle est incroyablement douée. Les autres aussi bien sûr, mais elle a un petit quelque chose en plus. Chaque fois, elle reprend le fil avec un aplomb qui l’honore. Toujours cette fermeté, ce côté solide ! Elle propose une Soul inespérée de qualité et d’accroche, une Soul du ventre.
Signé : Cazengler, Jacky Dette
Jackie Day. The Complete Jackie Day - Dig It The Most. Kent Soul 2011
*
Où va le rock ? A fichtre dire, je n’en sais rien. Pléthore d’albums sortent tous les jours. Impossible de les écouter tous et de se faire une idée. Comme souvent c’est une pochette qui a attiré mon attention. Je n’ai pas tapé dans le mille mais dans MISCELLEN. J’ai navigué sur leurs trois albums. Si j’en crois leurs propres tags d’autodéfinition : alternative rock, psychedelic rock – ils proposent aussi heavy psychedelick - rock hard-hitting, noir post rock, je reste dans l’expectative, tant de groupes se définissent ainsi ou de manière à peu près équivalente que l’on ne sait plus à quoi ils vont ressembler. Au moins Miscellen annonce la couleur dès son patronyme qui signifie mélange. Peut-être l’ont-ils choisi parce que certains membres du groupe proviennent de Bristol – salut ô perfide Albion – et l’autre est originaire de Washington D. C. L’on suppose qu’ils n’ont pas leur salle de répétition dans le bureau ovale de la Maison Blanche. On l’espère pour eux. Comment l’homme a-t-il su que la pomme avait goût à pomme a demandé Karl Max. Possédait la solution qu’il s’est dépêché de donner : en la goûtant. Nous agirons de même pour leur premier disque.
MISCELLEN
LUCID ORANGE
( 26 Août 2020 )

Ce n’est pas cette pochette qui m’a attiré l’œil, certes la terre est bleue comme une orange, l’orange et le bleu sont des couleurs complémentaires et l’on ne compte plus les couves qui utilisent ces deux teintes…
Nocturne : l’intro de l’intro nous laisse dans le noir, cette batterie incessante et légère nous déçoit d’entrée, faut attendre que l’on déploie les tapisseries colorées sur ce fond assez anodin, tiens les guitares fusent, mais ce qui séduit c’est la manière dont elles ne font que passer et mettent en valeur ces espèces de chœurs lointains venus d’un autre monde, si lointain que l’on se demande si ce sont des voix humaines ou des machines. L’est sûr qu’ils ont écouté Led Zeppe, pas le heavy mastodonte, mais le montage superpositionnel des pistes de guitares, ne copient pas, fabriquent leur propre moutarde. Z’ont une vidéo, vous en verrez plus mais vous n’en saurez pas davantage, elle dessine très bien la structure du morceau, nous la classerons sous le tag art-effect, très belle, très mystérieuse – alors qu’elle ne recouvre aucun mystère - groupe mixte, j’ai surtout adoré la coiffure du batteur un mix entre le chapeau cloche et le chapeau de Napoléon, je ne rigole pas, la vidéo vaut le détour. Dark star in a brighty sky : après Chopin, Keats, ces jeunes gens sont à écouter de près, une voix dépourvue de charnellité, normal le texte aborde les rencontres qui ne se rejoignent pas, musique asthmatique rampante, c’est une fille qui chante mais déjà si loin d’elle-même, basse grondante plus basse que la terre, guitare tragique, au-delà du désespoir le bilan de ce qui aurait pu être, invitation au suicide. Existe aussi en noir et blanc. Une vidéo oscillant entre Bowie et Lou Reed. Expressionisme artificiel. Ce n’est pas l’homme qui venait d’ailleurs mais la fille qui partait autre part. Cold and ice. Tranchant comme une lame de rasoir. Starfish : sur l’éclat de la guitare vous pensez partir explorer l’espace, erreur totale, la basse vous entraîne vers les abysses sans fin, le gars qui chante et parle n’est pas près de renoncer, il fonce vers le bas, à la recherche des îles englouties, ne sont-elles pas au-dedans de nous, l’étoile de mer que recherche le poulpe de notre cerveau. Hemlock : instrumental, guitare acoustique, voix incompréhensibles, serait-ce pas le passage de l’apologie de Socrate où Socrate boit un dernier coup, l’ambiance est assez funèbre ! Karada : l’assouvissement du désir est-il encore le désir, musique lente et incoercible, un très beau mix de batterie atterrit dans le vocal, grave et volcanique, voix iceberg qui s’éloigne, insaisissable en se rapprochant. L’on commence à se rendre compte que l’on est dans un album non pas original mais rare. Pour ceux qui ont du mal à percevoir, une vidéo vous enveloppe dans les rets du désir. N’allez surtout pas vous pendre à cette corde. Vous suspendre, oui. Safe world : mystère et boule de gomme, ça commence par un bruit de tirebouchon et ça finit comme une bande-son de film d’espionnage. Même pas une minute, mais l’on vous refile le mot de passe. Life above concrete : heureusement que la vidéo est explicite. Enfin presque. Elle vous dit tout. Sauf le mystère. Les lambeaux de paroles ne sont que fragments indécis, la musique sépulcrale vous permet de marcher sur le tapis rouge de l’ordalie en toute connaissance de cause. S’il y a cause, quel est l’effet ? Bone dry : flottements de basse dans lesquelles baignent quelques cordes de guitare qui s’enfuzzent par la suite, oripeaux orientaux mélodiques, deux voix, le yin et le yang, sonnent l’heure définitive qui recommence toujours. Z’ont dû aller chercher un sitar au fond du jardin pour les chuintements de la vie qui continue cahin-caha.
Inutile de vous essuyer les pieds sur le paillasson en sortant de ce disque. Comme vous y êtes entré. En voleur. Dans la chambre aux merveilles vous n’avez pas su quoi prendre. On ressort les mains vides, la tête pleine d’échos qui se dissoudront dans le réel désormais fantomatique. Ah j’oubliai, il n’y a pas de paillasson. Somptueux et mystérieux.
BLUE RUIN
( 26 Août 2020 )
Ils ont remis le couvert un an après jour pour jour. Plutôt nuit pour nuit. Voici la pochette qui a titillé ma prunelle. Un peu la même que la précédente. Ils ont supprimé l’orange. Ne reste que le bleu. La beauté n’en est que plus énigmatique.

Your lucky day : le seul titre de l’album accompagné d’une vidéo. De celles qui ne montrent rien. Un peu de groupe en train de jouer, tous les détails explicites sont gommés par des prises de vue de guingois. Très agréable à regarder. Et à écouter ce qui est encore mieux. Parce que sous l’indigence – sa face dorée se nomme plénitude – des images partielles on lit très bien le balancement du riff. Tellement bon que les paroles sont réduites à quelques murmures. N’êtes-vous pas heureux d’avoir attrapé des morpions ( ou autres choses ) dans ces ruelles sordides. L’initiation du pauvre en quelque sorte. Chemical bonds : clinquance de pas discrets, les guitares fuzzent y el cantaor hurle. Raconte l’histoire que tout le monde connaît. L’attirance, la tentation, le passage à l’acte, le vertige et la nausée du réveil à s’apercevoir que tout, hélas, a une fin même les mauvaises choses. La musique appuie là où ça fait mal. Une guitare vrombit longuement, des voix adolescentes s’entrechoquent et le désir est plus fort que le refus, il n’y a pas de mal à se faire du bien. Autant le premier album reste énigmatique autant cette ruine bleue est explicite. Couleur de la musique du Diable. Sans regret. Scream all you want : sifflements, verres brisés. Révolte adolescente et baudelairienne. Ne rien regretter. Tout se permettre. Bréviaire de la dérive. Très beau pont. D’Avignon qui emporte les beaux messieurs, les bonnes pensées, celles qui sont coincées aux pieds du bon Dieu. Une voix féminine susurre à votre oreille. Vous ne résisterez pas longtemps. No saints allowed : musique glauque, l’est sûr que l’on ne se dirige pas vers les beaux quartiers. La batterie frappe dur et la voix martèle les évidences. Scène de peep-show. Que pouvez-vous vous payer d’autre. Miscellen explose et expose. Le rut social des ados qui ne se reprochent rien. Qui assument leur dépravation puisque ce mot est le synonyme de leur jouissance. Sneer : ruminations, musique fuyante, il parle dans sa tête, à voix basse, il est bloqué, dans ce rade, dans sa vie, alors il ricane de lui-même et de celui dont il cherche l’embrouille, et qui ne fait pas cas de lui et le laisse à sa solitude. Un spoken words blues qui se moque des douze mesures, qui coule tout doux comme le parapluie de la vie qui s’égoutte sans espoir. Quoi de plus réconfortant qu’un rire idiot qui en veut à soi-même et au monde entier. Rien à regretter. EDIAC : retour de cette voix féminine d’outre-tombe, elle chante, elle t’encourage, les guitares glissent et la rythmique poinçonne les carrefours dont tu ne dois pas user, n’emprunte que la voie droite de ta volonté semblable à l’étroit couloir qui mène aussi bien à ta propre volition qu’au cul profond de basse fosse de l’autodestruction. Dive : Miscellen souffle le chaud et le froid, après l’appel à la vie, le chemin de feu et de flamme, voix éteinte de celui qui a dépassé les limites, qui est hors d’atteinte et hors de lui, agit en somnambule, derrière les guitares à bout d’énergie se consument lentement, basse et batterie exsangues stoppent leur marche funèbre. Aphotique : ils aiment ce mot qui désigne les profondeurs de l’océan que la lumière du soleil ne pénètre plus, musique en suspension, voix féminine, chant en français, c’est la grande descente lente et infinie, gloutonnements liquides. Après le feu, l’eau : final wagnérien. Cold comfort : une intro presque joyeuse, une fanfare cliquetante, la vie est ainsi, si tu la joues aux dés, un coup tu gagnes, un coup tu perds, cette dernière probabilité survient le plus souvent, c’est ainsi que l’on joue toutes les relations humaines, assez confortable quand on y pense, même si ça fait froid dans le dos. La musique suit les ondulations de la conscience. Tantôt plongeante, tantôt resplendissante. Valise à double-fond. Shadow blind : majestueuses notes de piano, voix écrasée, un rayon de lampe électrique qui explore les cadavres entassés dans les cabinets de la conscience, non sans allégresse, les guitares enflent, mélancolie du chemin parcouru, ces horreurs sont miennes, j’ai tout pouvoir sur elles. Même de passer à autres choses. Surtout ne pas se renier. Happy end : dialogue entre une fille et un garçon heureux de se rencontrer, voix suggestives, sont déjà ailleurs, les guitares balancent totalement, elles gardent le même son que lors des longues turpitudes passées, la fin est heureuse parce que tout ce qui a précédé était le chemin qui a conduit à celle-ci. Imaginez une fin shakespearienne où Hamlet trouverait après les épreuves et les morts amoncelés une sagesse à laquelle il n’aurait jamais atteint sans celles-ci. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort a dit Nietzsche.
BLACK MANDALA I
( Août 2022 )
Décidément Miscellen change de peau à chaque nouvelle incarnation phonographique. Si Blue Ruin peut être qualifié d’étude srockiologique sur le mental adolescent, dépourvue de tout œil moralisateur, Black Mandala s’inscrit dans une vision onirique et symbolique quasi philosophique. Rappelons qu’un mandala est un objet cultuel qui permet de se mettre en relation avec un dieu, et si vous êtes un incroyant invétéré un concentré représentationnel de la réalité qui aide à entrer en interaction avec le monde en d’autres termes d’avoir barre sur lui. Le lecteur s’interrogera sur les couleurs de l’arc-en-ciel : orange, bleu, noir.

Joe King : drums / Jason Servenik : bass, vocal, guitar / Rick Furr : guitar / Tyler Walosin : vocal / + Paul Gree : violin, lyrics / China Blue Fish : vocals.
Odyssey I : le titre est assez explicite, ce n’est pas 2001 Odyssée de l’espace, mais un voyage initiatique vers l’infini du rêve et de la réalité. Musique spatiale, le voyage débute, la musique s’envole et le vocal justifie ce raid audacieux vers l’inconnu puisque toutes les solutions envisagées n’ont apporté aucune réponses, intonations à la Robert Plant sur des vagues d’échos, ce dernier mot pink floydien pour insinuer que ce genre de partition n'est pas nouvelle… solo de guitare interstellaire final obligatoire. Nova : ne nous laissons pas impressionner par les vagues sifflantes d’un vaisseau fonçant dans le vide, ce morceau transcrit le passage du nous au je, du rêve au réel, du scénario du film d’expédition spatiale ( sujet explicite de la vidéo visible sur leur FB ) à l’individu qui déambule sur les trottoirs de sa ville en magnifiant dans sa tête sa quête intérieure en se utilisant les splendides images sorties de ses propres imaginations culturelles… Odyssey II : poursuite du voyage dans sa tête, reprise de paroles extraites de du premier titre, voix féminine de China Blue Fish, envoûtante, apaisante, méfions-nous du chant des sirènes orientales, la danse du ventre n'est pas le nombril du monde, même s’il vaut mieux sitar que jamais. Gaian dolls : que ne prophétisions-nous pas, après les arachnéennes vapeurs du rêve, voici des poupées bien plus terre à terre, après l’idée, la concrétude, un peu d’écho et une musique plus lourde pour marquer la réalité des étreintes charnelles, il est des triomphes qui sont aussi des défaites. Partagées. Retour à la case départ. Wise Guiz : les erreurs forment la jeunesse et font de vous des garçons avisés. Musique toute douce, la magicienne déçue a compris que le monde s’obscurcit… Une berceuse pour vous consoler d’un monde trop terne. Stone fruit I : arabesque du rêve, China Blue Fish, voix présente chair lointaine, elle chante lentement, gravement, une berceuse, une nursery rhymes folâtre. Très loin de la terre. Lunatique. Lunatic asylum disent les anglais. La substance du rêve n’est-elle pas tissée de cette étoffe… Gone too long : vent du désert, un larynx venu d’ailleurs et de nulle part te parle, tu es allé trop loin, il est temps de revenir, une voix féminine décrypte tes échecs, cherche dans ta terre natale, course haletante, un film que l’on rembobine, qui remonte à la source. La sentence est annoncée d’un timbre beaucoup plu clair, pas d’échappatoire possible. Stone fruit II : la revoici, la ballerine du rêve, la folle du logis, elle te surplombe, elle t’attire, elle te nargue, tu peux essayer de l’attraper, elle t’échappe, elle viendra bientôt, une autre fois, tu es en attente, elle n’est pas encore là, la musique papillonne et butine de fleur en promesse, elle incline sa corolle, serait-elle l’Eternel Féminin annoncé par Goethe à la fin de Faust…
Musicalement l’album est davantage prévisible que les deux précédents. Miscellen construit toutefois une œuvre à part entière. Les lyonnais diront que les trois disques si différents communiquent par des traboules inopinées qui établissent d’étranges relations entre eux. A eux trois ils forment un tout assez complexe. Nous n’avons plus qu’à attendre le 26 août 2023 pour écouter Mandala II qui clôturera le I.
Damie Chad.
*
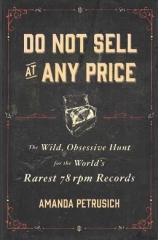
Dans Sa Ballad of Geeshie Wiley and Elvie Thomas - livraison 571 du 20 / 10 / 2020 – John Jeremiah Sullivan cite le nom d’Amanda Petrusich qui a consacré un livre aux collectionneurs de 78 tours. Un chapitre entier du book intiyulé Do not sell at any price : the wild, obsessive hunt for the world’s rarest 78rpm records est accessible sur le net. Elle y parle notamment de James McKune. Amanda Petrusich a commencé à rédiger ce livre pensant que ces obsédés de la galette inconnue devait être un peu frappés de la cafetière, aussi essaie-t-elle d’en rencontrer un maximum et de les faire parler de leurs passions et de ceux ( priez pour eux ) qui ont passé l’arme à gauche… Que recherchent-ils au juste ces dingues des vieux disques. Bien sûr elle récolte des noms d’artistes et des titres de morceaux dont plus personne ne se soucie depuis longtemps. Ce genre de réponse ne lui suffit pas. D’ailleurs elle-même que recherche-t-elle à savoir. Quel est l’intérêt de son enquête. Le sujet est original, il ne manquera pas d’attirer les lecteurs fans de blues, s’il se vend bien elle sera la plus heureuse, et ces collectionneurs quel véritable but poursuivent-ils, trouver la pièce qui manque à leur collection, et une fois qu’ils l’auront dénichée, qu’en auront-ils de plus, et elle une fois qu’elle aura recueilli leurs témoignages à part l’agréable sensation d’avoir mené son travail à bien qu’en aura-t-elle de plus ? A les écouter exposer leur passion elle a peu à peu l’impression de se regarder dans un miroir. N’est-elle pas comme eux. Ne leur ressemble-t-elle pas ? A peine ont-ils mis la main sur la perle rare qu’ils se lancent dans la recherche d’une autre. La quête – il s’agit bien d’une quête et pas d’une enquête – du Graal est infinie. Si vous avez trouvé le Graal votre vie est terminée. Ces fureteurs de vieilleries ne sont-ils pas des chercheurs d’absolu ? Son regard change. Ne mènent-ils pas leur vie comme ils l’entendent, en même temps prisonniers de leurs passions et forgerons de leur destin. Chaque homme dans sa nuit ne s’en va-t-il pas vers sa lumière. Comme elle, comme chacun, ils filent le fil de leur existence. Elle les prenait pour des toqués, et ne voilà-y-il pas qu’elle ressent une immense tendresse pour ces fourmis besogneuses qui fouillent de vieilles galeries que toute la fourmilière humaine a désertées depuis longtemps. Elle se rit d’eux pour mieux se moquer d’elle-même, telle est prise à son propre piège. Toute misère humaine est splendide. L’on cherche ou l’on écrit pour échapper à sa finitude. Sans cette tension vers des objets insignifiants ( qu’ils soient des disques ou nos misérables égos ) nous ne sommes rien. Ou alors la vanité de notre néant. Mieux vaut s’en moquer qu’en pleurer. Porter un disque ou un coquillage à son oreille n’est-ce pas pour entendre quelque chose qui nous dépasse, le bruit des choses mortes qui nous semblent revivre, serions-nous des sorciers qui redonnons vie au temps passé, ou des imbéciles qui n’entendent que la rumeur de leur sang qui bat dans leurs veines. Pour encore combien de temps…
Ce qui n’empêche pas Amanda Petrusich d’avoir du goût. Ainsi elle est subjuguée par la tristesse de Last kind words blues de Geeshie et Elvie. Elle cite aussi un autre morceau qui lui procure une semblable émotion : Au bord de l’eau d’Uncle Gaspard. Je ne connais pas, je cherche – discogs, YT – je trouve. En fait je ne trouve pas ce que je cherche. J’aurais désiré un disque ou un CD de Blind Uncle Gaspard. Déjà sur les cinq Shellacs originaux il n’y en a qu’un qui est totalement crédité à l’oncle aveugle sur lequel il chanterait et jouerait tout seul. Le plus souvent il partage les plages avec Delma Lachney (violon ) et sur les rééditions il laisse la place à John Bertrand ( vocal et accordéon ). Je ne chroniquerai que les morceaux d’Uncle Gaspard, pour une raison suffisante, un américain qui chante en français faut l’encourager. A part le groupe Forêt Endormie, je n’en connais pas d’autres…

L’a toutefois moins de mérite que Forêt Endormie ( voir livraison 509 du 06 / 05 / 2021 ) qui sont des ricains entichés de poésie symboliste et de musique française, Uncle Gaspard vient de Louisiane, ancienne colonie française… L’on ne sera donc pas étonné que ces enregistrements aient reçu la dénomination Rare Cajun ou Earlier Cajun Recordings !
Au bord de l’eau : face B du premier 78 tours paru chez Vocalion en 1929. Un petit détail amusant : sur YT le morceau est crédité de plus de trois cent soixante mille vues, les autres dépassent rarement le millier. Il semble que le livre d’Amanda Petrusich lui ait donné un coup de pouce : c’est sûr que cet accent traînant à la limite du moutonnement n’est pas de l’anglais, l’ensemble ressemble aux vieilles chansons du folklore français, l’est vrai que la guitare imite le bruit de l’eau qui goutte et coule, elle produit une certaine impression de tristesse impassible rehaussée par les paroles qui s’acheminent vers le dernier couplet dont la triste fin n’est pas sans rappeler Sur le pont de Nantes. Le texte d’une apparente limpidité laisse planer le mystère, il ne m’étonnerait pas que ce traditionnel dût comporter beaucoup plus que six couplets. N’empêche que la litanie est prenante et que l’on y revient tel un serial killer sur les lieux de ses crimes. Natchitoches : l’on comprend pourquoi elle était en A. Plus gaie – quoique, à mots couverts et pudiques, l’on ne nous dise pas que la belle est morte – et surtout à la moitié du morceau ce long passage siffloté, ardent comme de la braise qui meurt. Est-ce que ces doubles vers systématiquement répétés auront influencé la structure du blues ? Mercredi soir passé : grésillances… l’on croit que l’on part pour un blues, mais non l’on se retrouve en une ballade, l’on serait tenté de traiter la guitare de musique d’accompagnement, une fois qu’elle est partie elle ne varie pas d’un iota, elle est la trame sans cesse renouvelée et c’est le vocal qui se charge des inflexions, elle agit comme si elle saupoudrait ce qui n’est même pas une rythmique de gouttes de blues. Assi dans la fenêtre de ma chambre : toujours cette guitare qui chantonne par-dessous, et la voix qui pleure sans trop y croire, elle est partie, pas de cris, pas de drame, c’est ainsi, dans l’ordre des choses qui ne durent pas, on préfèrerait que… mais tu es partie. Pourquoi se révolter contre le désordre du monde. Les chansonnettes d’Uncle Gaspard sont aussi cruelles que la vie. Shoot mortifère en intraveineuse. Avoyelles : Uncle Gaspard est à la rythmique et Delma Lachney est au violon, c’est lui qui mène le bal. Les filles ne voient que lui. Gaspard produit avec sa guitare le même son qu’il produirait sur une washboard, vous martèle le rythme sans équivoque, fonce droit devant, jamais une accélération, jamais un ralentissement, l’est loin d’être le guitar hero des seventies. L’est pourtant né à Avoyelles ! Marksville blues : ne porte pas le mot blues par hasard dans son titre, prononce les mots de telle manière que sur les premières mesures l’on croit qu’il chante en anglais, dès que vous avez saisi les consonnances de par chez nous le chant se balladise quelque peu, guitare simpliste sur deux notes qui ne déraillent jamais, vous cherchez la blue note, vous ne la trouvez pas, pourtant vous n’y voyez que du bleu. Baltimore Wallz : le violon de Delma Lachney et Gaspard qui gratouille à sa manière, une assise de fer ou de béton armé. Oui mais si pris par un doute l’on s’en va écouter Django et Stéphane Grapelli leur duo fonctionne de la même manière, certes tous deux vous pondent cascades de notes et d’effets au mètre cube, mais le violon tourbillonne et la guitare garde la tête froide.
Damie Chad.
ROCKAMBOLESQUES
LES DOSSIERS SECRETS DU SSR
(Services secrets du rock 'n' roll)
Death, Sex and Rock’n’roll

EPISODE 3 ( DELIBERATIF ) :
17
Ah, la douce quiétude du local ! Le monde semblait être revenu à sa place, le Chef allumait un Coronado, Molossa et Molossito dormaient devant leurs écuelles vides, je consignai quelques notes sur mon autobiographie, ces Mémoires d’un Génie Supérieur de l’Humanité, dont les lecteurs de Kr’tnt ont l’immense privilège de consulter de temps en temps quelques précieux aperçus.
Le Chef alluma un nouvel Coronado. Peut-être un jour une civilisation plus avancée abandonnera-t-elle le stupide découpage temporel de la division du temps en heures à durée fixe pour la remplacer par celle de la flexible temporalité variable et modulable à l’infini de la fumation d’un Coronado. Prenons un exemple concret : vous décidez que vos huit heures de travail et de fatigue journaliers seront remplacées par un Coronado Expeditissimo qui se consume en cinq minutes : votre journée d’effort participatif à l’élévation du PIB national est ramenée à quarante minutes. Pour la pause déjeuner de 45 minutes vous lui donnez la longueur d’un Coronado Longitudissimo Maximito qui exige cinq jours de préparation mentale vous bénéficiez illico d’une pause de cinq jours… Question heideggérienne subsidiaire : les nouveaux rapports au Temps modifieraient-ils notre rapport à l’Être ?
- Agent Chad si vous me faisiez le plaisir d’interrompre l’écriture de vos mémoires, je ne doute pas qu’un jour ou l’autre leur édition vous vaudra le Prix Nobel, toutefois j’aimerais que nous revenions sur nos aventures de la veille.
- Chef, je vous dois une fière chandelle, sans vous j’étais mort !
- Sans doute en dois-je encore une plus grande à vos deux chiens, sans eux je ne me serais jamais retrouvé, pour le dire vite, à l’intérieur de la pochette de Black Sabbath
- Expliquez-vous Chef, je ne comprends pas, en quoi Molossa et Molossito vous ont-ils aidé ?
Le Chef alluma un nouveau Coronado, il expira lentement une première bouffée et se mit à parler d’une voix grave :
- Depuis deux mois j’ai passé tous mes weekends dans la forêt de Laigue. Je la connais par cœur, j’ai parcouru toutes ses allées, l’ensemble de ses chemins et le moindre de ses sentiers. Elle est magnifiquement entretenue, propre, nettoyée, parfaite pour les promenades familiales. Si je vous ai offert l’exemplaire des Contes de Charles Perrault, je voulais savoir si avec encore moins d’indices que moi, par vos seules déductions vous arriveriez au même résultat que moi. Je vous ai suivi, j’ai été très heureux de voir que vous vous dirigiez vers Armancourt…
Molossa et Molossito dressèrent l’oreille. Pour ma part j’étais tout ouïe. Il y eut un moment de silence durant lequel le Chef alluma un Coronado.
- Par contre j’ai très vite compris, comment dire… qu’à votre suite je ne pénétrais pas dans la forêt habituelle, sa physionomie avait changé, un peu comme si elle s’était ensauvagée, plus vous avanciez, plus il était difficile de progresser jusqu’à ce rideau d’arbres impénétrable… Un peu comme si nous avions pénétré dans un autre espace-temps…
- Quant à moi Chef, je me demande pourquoi mes balles n’ont eu aucun effet sur la Mort alors qu’une seule des vôtres a suffi à la désintégrer.
Le Chef esquissa un sourire. Je crus qu’il allait allumer un Coronado, mais non, il se contenta d’appuyer son index sur un bouton de son bureau. Derrière lui se déroula un large écran de home-cinéma.
- Enfantin Agent Chad. Votre Rafalos 17 est un excellent joujou. Pour ma part je me suis acheté la nouvelle mouture, le Rafalos 19, vous savez c’est comme pour les portables, ils renouvellent la gamme tous les ans. Pour cinq cents dollars ils fignolent une nouvelle fonction gadget qui ne vous sert à rien. Ainsi le Rafalos 18 émettait une sonnerie lorsque votre grille-pain éjectait votre tartine. Pour le Rafalos 19, ils ne se sont pas foulés, ont juste rajouté une caméra qui se déclenche lorsque vous tirez, ainsi vous pouvez visualiser le trajet de votre balle. Nous allons donc suivre sur grand écran la balle que j’ai envoyée en la pleine tête de la Mort. Attention c’est très rapide, évidemment j’ai ralenti l’image au maximum.
En effet ce fut rapide. A gauche du Rafalos 19 l’on distinguait une partie de mon menton, le Chef s’était servi de mon épaule pour poser le canon de son Rafalos, droit devant le squelette de la tête de mort souriait, au fond de l’orbite de ses yeux brillait une lueur de braise, tout se disloqua en une fraction de seconde, la balle se perdit au loin…
- Voyez-vous agent Chad, ce n’était pas un mannequin ou une entourloupe quelconque, la lueur de haine qui brillait au fond de la cavité de ses yeux nous l’assure. C’était bien la Mort. Vos balles ne lui faisaient ni chaud ni froid, la mienne non plus, quand elle s’est aperçue qu’elle était filmée au plus près elle s’est hâtée de se dématérialiser. Nous n’avons pas été victime d’une manipulation initiée par un ennemi humain, c’est la Mort en personne qui nous a pris en chasse. D’ailleurs nous n’aurions pas eu besoin de cette caméra pour le savoir, nous possédions déjà un indice suffisant.
- Lequel Chef ? Je ne vois pas !
- Agent Chad, c’est facile. Tous mes dimanches à arpenter la forêt de Laigue et la mort ne s’est jamais manifestée ! La première fois que vous vous y rendiez elle est là, cherchez l’erreur !
- C’est donc la présence de Molossito et de Molossa qui l’ont amenée, il est vrai que dans les diverses mythologies, le chien est un animal psychopompe qui conduit les âmes vers le royaume de la Mort !
- Agent Chad, notre ennemi n’est pas de tout repos. Procédons avec ordre et méthode. A tout hasard filez au point-presse, ramenez toute la paperasse locale du département de l’Oise. En l’épluchant peut-être découvrirons-nous un détail quelconque sur ce qui s’est passé hier dans la forêt de Laigue.
18
Les chiens étaient survoltés. Ils descendirent les escaliers quatre-à-quatre ce qui est assez normal pour des quadrupèdes. Ils firent irruption bien avant moi dans le magasin en aboyant de toute leur force. Peut-être aujourd’hui auraient-ils droit à leur bocal favori. Celui qui contenait les Carambars. Des heures à mâchouiller, ils adoraient. Quand quelques secondes après eux je pénétrais dans la boutique, je les entendis gémir pitoyablement, deux clientes faisaient triste mine, la patronne au comptoir se tamponnait les yeux.
- Oh ! Monsieur Chad, une triste nouvelle, Mlle Alice est morte hier, d’un seul coup, il devait être un peu moins de 15 h 30, elle était en train de ranger une revue, elle a porté la main à son cœur, elle a dit aië ! et elle s’est affalée par terre. Les pompiers n’ont pas réussi à la ranimer. Le médecin qui les accompagnait a établi un constat de décès pour crise cardiaque. J’ai téléphoné à ses parents, ils n’habitent pas loin, ils sont arrivés très vite, ils n'ont pas voulu que le Samu l’emmène à la morgue, ils ont exigé que l’ambulance ramène le corps chez eux. Ils étaient si malheureux que les autorités n’ont pas osé s’y opposer. C’est terrible Monsieur Chad, vous devez être peiné, elle aimait beaucoup vos chiens, mais je pense qu’elle vous aimait encore plus qu’eux…
19
Nous revînmes au local le cœur lourd. Molossa serrait les dents. Molossito chouinait de temps en temps. Un peu moins de 15 heures trente, à peu près l’heure exacte où la Mort avait posé ses doigts osseux sur mon cœur… Elle ne m’avait pas tué, en échange de ma vie elle avait pris celle d’Alice. Plus tard le Chef m’a révélé que lorsque je suis rentré au local, il avait eu l’impression que dans mes yeux brûlait une lueur rouge de haine. Ce n’était pas une impression, une terrible résolution était en train de se forger dans mon esprit : moi Agent Chad, je me jurai d’engager un duel à mort avec la Mort et de la tuer.
A suivre…