KR’TNT !
KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 666
A ROCKLIT PRODUCTION
FB : KR’TNT KR’TNT
21 / 11 / 2024
FOUR TOPS / TELESCOPES
MERCURY REV / A PLACE TO BURY STRANGERS
CREEPY JOHN THOMAS / CAGED WOLWES
CAIXÄO / BILL CRANE / SCARECROW
Sur ce site : livraisons 318 – 666
Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :
Wizards & True Stars
- Top of the Tops
(Part Two)

Quand en juillet dernier, Duke Fakir a cassé sa pipe en bois, nous avons profité des Estivaleries pour saluer sa mémoire et bricoler un simili Part One. Il est grand temps maintenant de célébrer son autobio parue en 2022 : I’ll Be There: My Life With The Four Tops. Curieusement, le book fut éreinté par un ou deux journalistes anglais. Le pauvre Duke Fakir n’a pas bénéficié des acclamations journalistiques dont avaient bénéficié par exemple Brian et Eddie Holland avec Come And Get These Memories: The Genius Of Holland-Dozier-Holland, Motown’s Incomparable Songwriters. Cet éreintement fut choquant. Voyons pourquoi.
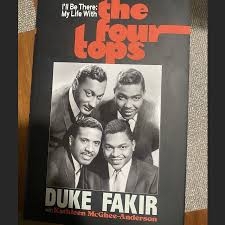
Il apparaît très vite que Duke Fakir n’est pas l’écrivain que l’on croit. Mais fuck it, c’est un Topper ! Et ça lui donne tous les droits, surtout celui d’écrire ses mémoires. Le gros défaut des journalistes est qu’ils ne sont que des journalistes. Ni artistes, ni musiciens, ni légendes comme le fut par exemple Duke Fakir. Alors, les journalistes critiquent et du haut de leur non-existence, ils tuent des books dans l’œuf. De quel droit ? I’ll Be There: My Life With The Four Tops n’est évidemment pas un chef-d’œuvre littéraire, mais Duke a vécu l’aventure de l’intérieur et il se contente de raconter ses souvenirs, en toute humilité. Sa simplicité de ton le rend même émouvant, et crée une sorte de proximité. En étant son lecteur, tu deviens un peu son copain. La meilleure preuve de son humilité est cet extrait tiré du foreword, c’est-à-dire de l’avant-propos : «De mon point de vue, nous n’avons jamais rien contrôlé. Quelque chose de beaucoup plus important veillait sur nous. Au milieu du XXe siècle, les mondes s’entrechoquaient, les temps changeaient et les gens se montraient prêts pour un monde d’amour et de solidarité. C’est ce que la musique offrait. Les Four Tops firent partie de tout ça, et parce que nous étions ce que nous étions, quatre frères unis et connus pour nos harmonies vocales, nous étions ceux qui pouvaient chanter ce changement. Ma voix n’était pas celle qui était mise en avant, mais aucun d’entre-nous ne voulait toute la gloire. Nous n’étions pas le groupe le plus célèbre du monde, mais notre célébrité nous suffisait.» Voilà, c’est le ton du book : immensément humble.
Et Duke ajoute sur la page d’en face : «On était quatre mecs très différents les uns des autres, mais on aimait tous la même chose, et c’est en quelque sorte toute l’histoire des Four Tops. Quatre mecs de Detroit qui avaient en commun une passion pour la musique et qui s’aimaient, et nous sommes restés ensemble beaucoup plus longtemps que n’importe quel autre groupe de cette période.» Puis il rappelle que d’une certaine façon, ils illustraient les quatre coins de monde : «Mon nom est Abdul Fakir, which is Muslim, Obie’s name is Renaldo Benson from the Spanish world, Levi Stubbs name is from the Jewish world, and Lawrence Payton is as English as you can get.»

Grâce à Duke, on comprend à quel point les groupes de blackos en bavaient pour arriver à percer. En amont des Four Tops, il y a dix bonnes années de galères. Duke a 13 ans quand il rencontre Levi Stubbs pour la première fois dans un club de Detroit, le Paradise. Il voit Levi monter sur scène. Levi n’a que 11 ans - Levi Stubbs who was definitely going to be a star - Levi est aussi le cousin de Jackie Wilson. Levi est baryton et Duke est ténor. Ils décident de monter un groupe ensemble, et un soir de fête, at a local graduation party, ils rencontrent Obie Benson et Lawrence Payton. Ils forment un quatuor qui s’appelle The Four Aims. Ils se spécialisent dans ce qu’on appelle the four-part harmonies. La bête du groupe, c’est Lawrence Payton, qui est fortement influencé par The Four Freshmen - the best at four-part harmonies back then - Il faut se souvenir que Brian Wilson idolâtrait lui aussi les Four Freshmen. Duke : «C’est la quatrième note qui fait la four-part harmony. Vous pouvez monter et descendre dans la mélodie and make four parts. Lawrence got that feeling from listening to string sessions, and he fashioned our voices after that.» Duke donne ici un éclairage considérable. Il ajoute : «Lawrence pouvait écouter un big band arrangement, peut-être six instruments, et après une seule écoute, il pouvait chanter ce que faisait chaque instrument. It was incredible. Il savait lire et écrire la musique, mais il nous chantait nos parties. Il chantait la mienne comme a trumpet part. Puis il chantait the second part qui était la sienne, puis the third part qui était celle de Levi. Au début, il n’y avait pas de lead sur les chansons. On chantait du four-part harmony straight through, similar to The Four Freshmen. Lawrence was a real genius, and we were gifted with an all-star team.»

Les Four Aims zonent dans les clubs, et un soir, ils tombent sur un black qu’ils ne connaissaient pas : James Brown ! - Alors on est allés voir de plus près what this James Brown was all about - Duke et ses trois amis sont sciés - We were amazed. He was tearing up the house. Shit! It was phenomemal - C’est là qu’ils comprennent qu’ils doivent danser sur scène. Levi est le premier à réagir : «We can’t out funk him, we can’t out dance him, we can’t out roller him, but we can sing out this motherfucker. Alors on va juste se lever et chanter. C’est notre seule chance. On peut rajouter un peu de funk, mais on va aller sur scène, avec des airs débonnaires et chanter pour les ladies. C’est tout ce qu’on peut faire. That’s us». Eh oui, les Four Aims ont très bien compris que personne ne peut rivaliser avec ce démon de James Brown, surtout dans les early sixties. Levi Stubbs a compris que le seul moyen de réussir est d’être soi-même. «So we gonna go up there and sing.» Ces pages sont fantastiques car elles nous montrent l’état d’esprit des quatre petits blacks confronté à la réalité. Même quand tu chantes bien, ça ne suffit pas.

Eh oui, il faut des compos. Eh oui, il faut un management. Toujours la même histoire. Et puis, il faut un nom. Les voilà chez Chess pour enregistrer un premier single, «Kiss Me Baby». On leur dit que The Four Aims, ça ne va pas du tout. Pas beau. Et le directeur musical leur dit : «What about The Four Tops ?». Vendu. Duke : «The Four Tops were born in 1956 at Chess Records.» L’aventure Chess s’arrête aussitôt après. Puis, de 1961 à 1963, ils vont accompagner Billy Eckstine sur scène - Eckstine was once the rival of Frank Sinatra - Eckstine leur enseigne deux choses fondamentales : un, la paix de l’esprit n’existe pas dans le showbiz, et deux, après le succès, vient l’oubli, et il faut se préparer à ça.
Et on arrive au cœur battant du book : Motown. C’est Berry Gordy qui veut les Four Tops. Il les connaît, il sait ce qu’ils valent et il sait qu’il peut en faire des superstars, et c’est exactement ce qu’il va faire. Duke rentre bien dans le détail : les Four Tops passent dans un show télé new-yorkais, le Tonight Show. Gordy est chez lui à Detroit et les voit à la télé. Alors il dit à son A&R Mickey Stevenson d’aller les trouver pour leur proposer un deal. Mickey débarque à New York et vient voir les Four Tops : «Man, Berry wants you all. Sounds like he wants y’all bad.» Deux jours plus tard, les Toppers débarquent à Hitsville USA, on West Grand Boulevard. Berry Gordy les accueille avec un wonderful greeting. Il les fait asseoir et fait glisser un contrat sur le bureau en direction des Toppers - Here’s one of my contracts. It’s for six years - Gordy veut que les Toppers lisent et signent. Duke, qui est le porte-parole du groupe, dit qu’il veut emmener le contrat à la maison et le lire tranquillement avec ses amis. Gordy dit non - I never let my contracts out of my office. I don’t do that - Duke ne se déballonne pas, et il sait que ses amis Toppers vont le suivre : il dit à Gordy qu’il a quelques années d’expérience et qu’il a toujours pris le temps d’examiner les contrats - It’s business, you know - Mais Gordy l’envoie sur les roses : «Well I do business different ways. You sign it right here or not.» Duke tient bon. Il dit qu’il ne peut pas signer un contrat qu’il n’a pas examiné en détail. Gordy commence à sentir que les Toppers ne vont pas céder. Il demande s’ils vont consulter un avocat. Et Duke lui répond qu’ils vont le lire eux-mêmes et en discuter tranquillement tous les quatre. The Four Tops, man ! Gordy finit par donner son accord - Okay man. I don’t usually do this kind of shit. You can bring it back tomorrow - Duke nous fait partager là un épisode historique. T’es dans le bureau avec eux.

Le lendemain, il reviennent signer le contrat et demandent une avance. Gordy dit non : «Look, man, I don’t do that.» Mais il leur garantit une chose : des hits. «You’ll have hits at this record company.» Puis il sort 400 $ de sa poche et les file aux Toppers - Look, here’s the best I can do - Les Toppers attendaient mieux que ça, mais finalement, ils acceptent. Ils font confiance à Berry Gordy.
Duke nous explique ensuite que chaque artiste chez Motown avait une relation particulière avec Berry Gordy. Duke dit que la sienne a toujours été positive. Gordy respecte les Four Tops car ils étaient un groupe accompli avant Motown - We already had a distinct sound and musical identity - Ils ne sont pas une découverte. Et Gordy a besoin de leur talent.

Ils enregistrent un premier album de standards américains et de classiques de Broadway, Breaking Through. Mais l’album ne sortira que 35 ans plus tard. Gordy ne le trouvait pas assez Motown. Il pensait à juste titre que l’album n’allait pas dans la bonne direction - It’s not just commercial enough - Alors il les présente à Holland-Dozier-Holland. Et là, boom !

Pour Duke, ce n’est pas seulement une collaboration musicale qui démarre : c’est une amitié. Il indique que le destin des Four Tops ne pouvait pas être en de meilleures mains. Gordy avait une vision des Four Tops qui allait plus loin que les jazz standards de Broadway. Il avait raison - We trusted him. It paid off, big time - Les Toppers traînent pas mal à Hitsville, ils deviennent potes avec les Temptations, les Supremes, les Miracles - Little Stevie Wonder was a cute young man, like a kid in a toyshop - Il conviendrait de croiser cette lecture avec celles des mémoires de Mickey Stevenson et des frères Holland. Les Toppers enregistrent leur premier hit Motown, «Baby I Need Your Loving». Mais les sous n’arrivent pas automatiquement. Ils devront poireauter deux ans pour voir débouler les chèques de royalties. Alors ils doivent reprendre les tournées pour vivre. Duke nous raconte les célèbres Motown’s package tours, avec des affiches qui te font baver. Bave, baby, bave !

Entre 1964 et 1967, le trio Holland-Dozier-Holland tourne à plein régime. Dix number one songs pour les Supremes, nous dit Duke. Les Toppers enregistrent généralement un hit en deux heures. Ce sont des pros. Ils alignent des hits planétaires comme «Reach Out I’ll Be There», «Bernadette», «Standing In The Shadows Of Love». Duke raconte aussi le clash entre Marvin et Gordy à propose de «What’s Going On». Gordy ne voulait pas de chansons engagées, et Marvin lui répondait que «What’s Going On» était ce que les gens voulaient entendre, et diable, comme il avait raison de tenir bon !

Duke rappelle aussi que les Toppers ont flashé sur le «MacArthur Park» de Jimmy Webb et qu’ils démarraient leur set avec - Nobody could sing it like Levi - C’est l’une des chansons qui a le plus touché Duke. Quand Levi a cassé sa pipe en bois, les Toppers ont arrêté de le chanter sur scène - Levi’s delivery was iconic - On trouve cette merveille insurrectionnelle sur l’album The Four Tops Now!. Ils tapent dans l’intapable de Richard Harris. Levi ne craint pas la mort, alors il y va sans hésiter et prend l’intapable en main. On a là une version swinguée et orchestrée. Levi va même jusqu’à la sur-winguer pour qu’elle décolle vite fait vers les étoiles. C’est beau à pleurer. Levi grimpe si haut qu’il donne le vertige. On assiste à de merveilleuses échappées de pur feeling. On trouve aussi un hommage aux Beatles avec «The Fool On The Hill». Fabuleuse version, les Toppers la swinguent au velouté Tamla. Ça devient doux au toucher. Et on entend bien sûr l’immense James Jamerson derrière. Un autre coup de génie, c’est bien sûr «Don’t Bring Back Memories», une pop de good time music extrêmement colorée et bien chaude, un vrai patrimoine de l’humanité qui se danse au mieux de toutes les espérances. Oui, les Toppers ont du génie, tellement de génie qu’ils en ont à revendre. On trouve aussi un fabuleux cut de r’n’b intitulé «My Past Just Crossed My Future», bien emmené au beat de membres désarticulés. On s’effare de l’ambiguïté des orchestrations. Ils restent dans l’insolence de la classe avec «Little Green Apples». Quand les Toppers mettent leur énorme machine à swinguer en route, ça fait des étincelles. On les admirera jusqu’à la fin des temps.

Mais les jours heureux ne vont pas durer. Duke rappelle qu’avec l’arrivée des Jackson 5 en 1969, les groupes phares de Motown ont subi une sorte de déclassement. Les Tempts, les Miracles, les Toppers et Stevie Wonder n’étaient plus les chouchous. Pareil pour les Supremes lorsque Diana Ross est passée solo. Duke pense que ce sont les émeutes de 1967 à Detroit qui ont poussé Gordy à quitter la ville pour aller s’installer en Californie. Gordy essaye aussi de casser les Four Tops pour récupérer Levi, comme il a cassé les Supremes pour récupérer cette rosse de Diana Ross. Manque de pot, Levi est un Topper. Il ne trahit pas ses amis. Gordy essaye de l’appâter en lui proposant un rôle dans Lady Sings The Blues. Et Levi lui répond : «What about the Tops? What about my boys? Is there a part in it for them?» Et quand Gordy lui dit non, Levi annonce qu’il reprend l’avion et rentre à Detroit - We’re going home then - Fin de la discussion. Comme Gordy sidéré n’a pas bien compris, alors Levi lui balance ça dans la gueule : «It’s the four of us or nothing.» Et là, t’as le vrai truc, la raison d’être d’un groupe, l’intelligence du rock et de la Soul. Te voilà aux antipodes des rats et des beaufs.

Puis les Toppers se font virer de Motown par Ewart Abner, que Gordy a chargé de prendre la relève à Detroit : «We don’t need you guys anymore.» Les Toppers tombent des nues. Virés comme des chiens. Duke indique plus loin que Gordy n’était pas au courant de cette histoire. Bon, les Toppers sont sonnés, mais ils se reprennent et vont signer ailleurs. De toute façon, Motown ne signifie plus rien. Le trio Holland-Dozier-Holland s’est barré depuis belle lurette.

Après Motown, les Toppers vont signer chez ABC/Dunhill, Casablanca et finalement Arista - It was the last record deal we ever had - Et après ça, Duke va évoquer en des pages merveilleuses ses amis Eddie Kendricks et David Ruffin, puis aligner les cassages de pipes en bois, Levi, Lawrence, et Obie, pour filament se retrouver le dernier, atrocement seul, perdu et malheureux, comme ça arrive à tous ceux qui survivent trop longtemps. Avec le temps du chagrin vient l’envie d’en finir.

Très beau livre. Merci Duke d’être ce que tu fus. Reach out !
Signé : Cazengler, Four
Duke Fakir. I’ll Be There: My Life With The Four Tops. Omnibus Press 2022
L’avenir du rock
- Le télescopage des Telescopes
(Part One)
— T’es pas cap !
— Cap de quoi ?
— T’es pas cap de délirer sur les Telescopes, avenir du rock...
— Pourquoi veux-tu que je délire sur les Telescopes, mon pauvre ami. Ils sont parfaitement capables de délirer tout seuls. Ils n’ont pas besoin qu’on les aide !
— M’en doutais que t’allais te déballonner, avenir de mes deux !
— C’est absurde ! C’est comme si tu demandais à Brigitte Bardot si elle avait besoin de quelqu’un en Harley Davidson ! Ou à Cocteau de ne pas feindre d’être l’organisateur des mystères qui le dépassent. Te rends-tu compte de ton incurie ? Sans vouloir être méchant, te rends-tu compte du néant que tu incarnes ? Délirer sur les Telescopes ! Mais ça n’a pas de sens ! As-tu besoin de demander à Ziggy de jammer good avec Weird and Gilly ? Ou de rappeler à Johnny Yen de se pointer avec les bottles & drugs ! Ou à la mer de baigner les golfes clairs ?
— Tu trouves toujours des combines pourries pour t’en sortir, avenir de ta race !
— Mais non, j’essaye juste de t’expliquer ce qui me semble être une évidence. Mais c’est pas facile de parler avec un mec comme toi. Sous ta casquette, t’as les idées bien arrêtées. T’es pas quelqu’un de très sympa, en réalité. Il faut même faire un peu attention à ce qu’on te dit, car ta susceptibilité s’inscrit sur ton visage, ça a l’air de te crisper la gueule, et tu deviens vite agressif, ce qui rend l’échange caduque. Ta connerie télescope les escalopes, tu hausses le ton et tes spolémiques apparaissent en cinémascope, elles te radioscopent le kaléidoscope, alors t’es plus qu’un Ionescope interlope en partance pour Scopacabana, mon spote.
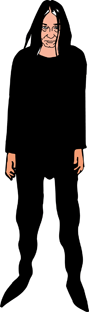
Bon calmons-nous et célébrons les Telescopes, c’est-à-dire Stephen Lawrie, qui, depuis son sous-marin, observe les convois des tendances qui traversent l’Atlantique, et qui, de temps en temps, leur balance une bonne torpille. Lawrie adore couler les tendances.

T’en reviens pas de te retrouver à deux mètres de lui, là, au fond de la cave. Pas la grande foule. Concert trop underground, sans doute. Tant pis pour les absents. Les Telescopes sont aujourd’hui ce qui se fait de mieux en matière de psyché anglais. Sur certains cuts, Lawrie sonne exactement comme Syd Barrett. Quand on le lui dit, après le concert, ça le fait bien marrer. C’est là où tu vois ses dents pourries. Stephen Lawrie, dernière vraie rockstar anglaise avec Peter Perrett, Lawrence d’Arabie et Jason Pierce ? C’est plus que fort probable. En tous les cas, concert demented. T’en savoures chaque seconde avec un bonheur indicible, tu t’enivres de ce son unique au monde. Là, t’as le real deal, pas une mauvaise resucée à la petite semaine, non, c’est la suite exacte d’«Arnold Layne», c’est le sommet du genre.

Ils sont cinq sur scène, dont deux Français, un blond à la guitare, là-bas au fond, et une petite gonzesse sur un mini-clavier, au-devant de la scène. T’as un super-rasta à la basse, complètement plongé dans le doom, un batteur anglais au croisement du psychout et de cromagnon, et puis, Stephen Lawrie derrière son micro, avec ses deux guitares et ses lunettes. Zéro frime, il gratte ses Si et ses Do et chante par intermittence, il est le capitaine du vaisseau, le gardien du phare (tel qu’il se décrit dans les liners de Radio Sessions 2016-2019), il est fantastiquement présent dans l’avenir, et fantastiquement ancré dans la tradition la plus pure, franchement, t’en reviens pas de voir un mec aussi légendaire se comporter comme si de rien n’était. Tu mets des mots comme tu peux sur les secondes de son qui défilent, mais tu sens bien qu’un puissant courant les emporte, alors tu laisses filer, tu te dis que tu te débrouilleras plus tard, et puis au fond, ça n’a aucune importance, tu vis ta vie, grâce à Lawrie, tu arraches encore au néant de la vie quotidienne quelques instants d’éternité, tu montes et tu descends avec eux, et t’as cette petite gonzesse qui groove avec le son, tu vois ses cheveux voler, elle groove fabuleusement, alors le real deal devient palpable, et quand ça monte en température avec cette bombe atomique qu’est «This Train Rolls Out», tu vis une sorte de petit moment d’extase, et tu te félicites sincèrement d’être resté en vie, rien que pour pouvoir assister à cette petite heure d’éternité.

Les mighty Telescopes font leur grand retour dans le rond de l’actu avec Halo Moon. Pareil, tu peux y aller les yeux fermés. Tu y retrouves l’heavy «Shake It All Out» bien rempli à ras bord. Lawrie ne plaisante pas avec l’heavyness. Et en plus, il a le groupe parfait pour jouer ça dans la cave. Tu croises plus loin un «Nothing Matters» très Velvet, puisque gratté sur les accords d’«All Tomorrow’s Parties». Il a aussi des cuts plus poppy, comme ce «For The River Man» qui se laisse bercer, un peu étrange au demeurant. Il fait son coup de Syd avec «Along The Way» et un coup de samba Syd avec le morceau titre. Boing boing ! Par contre, «Lonesome Heart» déploie ses ailes : très beau, mélodique et gluant. Tu retrouves le boing boing dans «This Train Rolls On». C’est extrêmement déterminé à vaincre. On ne fait pas de tels boings inopinément. Mais la version live était nettement plus dévastatrice.
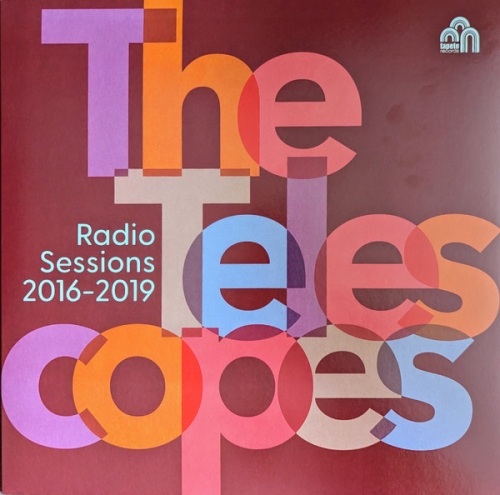
Et comme si Halo Moon ne suffisait pas, ils sortent aussi cette année une fastueuse compile : Radio Sessions 2016-2019. Stephen Lawrie signe les liners. Donc on les lit. Il commence par dire que des gens voient les Telecopes comme un collectif, que d’autres gens, plus nostalgiques, imaginent que les Telescopes ont gardé le line-up d’origine, et que d’autres encore voient ça comme «a solo-career». D’une certaine façon, conclut Lawrie, tout cela est à la fois vrai et faux. Quand il se voit contraint d’en parler, Lawrie dit que «the Telescopes house had many rooms.» Formule ajoute-t-il qui lui convient bien, mais il observe que ça peut créer de la confusion chez certaines personnes. «For me, confusion isn’t a bad thing.» Et il développe, rappelant que tout naît de la confusion, que le chaos non seulement l’intéresse, mais l’excite. Après la métaphore de la maison, il opte pour celle du vaisseau. Il considère les Telescopes comme a vessel. Puis il développe encore en expliquant qu’il n’est que le gardien du phare, et que tout ce qui compte, after all, c’est le son qui sort des enceintes.

La cerise sur le gâtö des Radio Sessions 2016-2019 s’appelle «Something In My Brain». Ça joue au tribal impitoyable. Ils détiennent le pouvoir antique du psyché obscur, ils sonnent comme des êtres primitifs. John Lynche te bat ça dans la jungle du non-retour. Tu sens battre le cœur du rock que tu aimes bien. Te voilà Telescopé de plein fouet. Ils tapent dans le «Violence» du premier album, ils en font une mouture profonde et grasse. Ils prennent leur temps, rien ne les presse. Pas de rendez-vous avec la gloire, ils préfèrent traîner dans les ténèbres de l’underground. C’est très insidieux, leur groove gronde dans les ténèbres, ça frôle le saturnisme psychédélique, c’est interminablement heavy. Ils passent à la weird psychedelia avec «We See Magic And We Are Neutral Unnecessary», ils plongent au cœur du mythe psyché et développent un véritable apanage du genre. Ils tirent aussi «The Perfect Needle» de Taste : weird fuck-out avec un côté Velvet très cérémonial qui remonte à la surface. Encore de la belle tension heavy avec «Strange Waves», c’est riffé au raff, plus fort que le Roquefort, avec un développement explosif. Puissant, herculéen, zébré d’éclairs de sature, la voix de Lawrie se noie dans une mer de riffs démontée. Ils cultivent l’heavy frakout, le drone des saturations extrêmes.
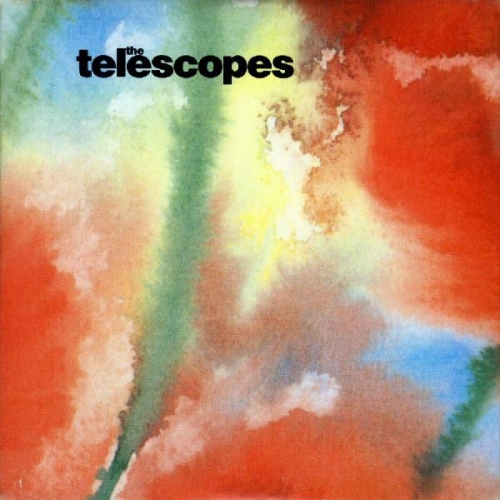
Tu sors aussi de l’étagère deux maxis Creation ramassés somewhere someday, Everso et Celeste. Avec le morceau titre d’Everso, ils te plombent vite fait le maxi avec un heavy groove de fat shoegaze, très Bloody Valentine dans l’esprit.
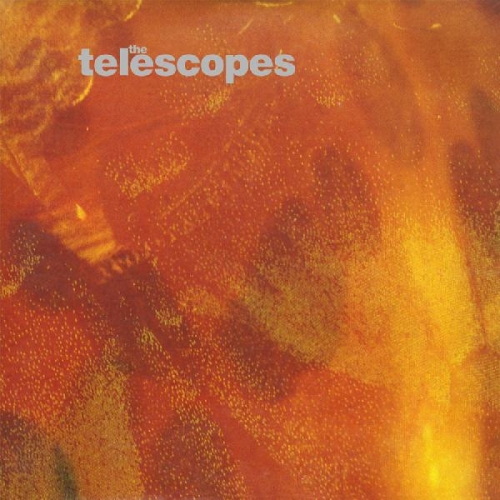
Et Celeste sonne comme de la psychedelia britannique classique bien visitée par les vents du Nord.
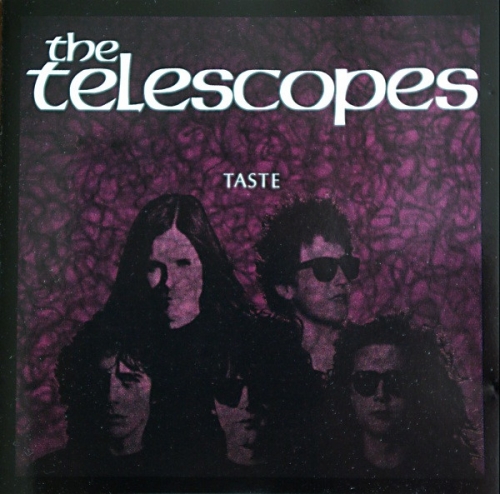
Mine de rien, Taste est resté un classique, grâce à ses forts relents Stooges/Velvet/Mary Chain. Dès «I Fall She Screams», t’es dans les Stooges. Lawrie se jette dans les flammes de tout son poids d’I falllll ! Stooges encore avec «Suicide» en B, noyé d’accords et de folie. Rien de plus stoogy que ce Suicide commando. Velvet via «The Perfect Needle», plus cérémonieux, et digne des Tomorrow’s Parties. Mary Chain via «Suffercation», très bardé de barda, même méthode d’assaut que celle de William Reid. Ils passent au heavy doom avec «Violence», tout se fond dans la fusion du solo trash à la coule. Pur blaster que cet «Anticipation Nowhere» et encore de l’eavy stash de trash avec «Please Before You Go» et puis t’as cette épouvantable purée de «Silent Water». Ils ne t’auront rien épargné.
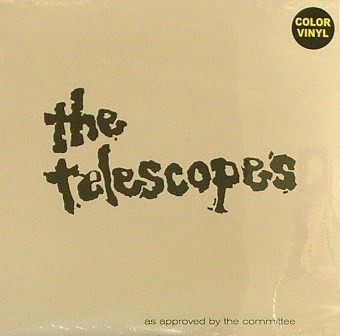
Tu retrouves «I Fall She Screams» sur une belle compile Bomp!, As Approved By The Committee. Tu y retrouves aussi «Flying», une exploration du cosmos et ça explose bien dans le ciel. Et puis t’as cette tonne de purée fumante, «Silent Water», et Lawrie marche dedans. Le gros intérêt de cette compile, ce sont les liners au dos. Lawrie raconte qu’il croisait à l’époque Jo Doran dans les mêmes concerts et c’est là qu’ils ont décidé de monter un groupe. Principales influences : le feedback, le Velvet et Suicide. Puis ils vont faire des premières parties de Spacemen 3 et de Primal Scream. Une formule résume bien les Telecopes : «Expect the unexpected.» La principale info des liners Bomp! concerne le quatrième album des Telecopes (#4), considéré comme leur finest work. Et on doit cette compile au Comitteee To Keep Music Evil, dont le membre fondateur n’est autre qu’Anton Newcombe.

En 1992, les Telescopes sont toujours sur Creation pour un album sans titre et sans vagues. Ils y flirtent avec la Stonesy psychédélique des Satanic Majesties, disons une belle Stoney informelle, celle qui ne veut pas dire son nom. L’intention est louable. Cut après cut, on les voit chercher la petite bête, titiller la tontine, parfois c’est assez imbuvable («Spaceships»), le pauvre Lawrie n’a pas de voix, on se croirait à la MJC. Les Big Atmospherix sont bienvenus mais nullement déterminants. Ils s’arrangent toujours pour passer à côté. T’arrive au 6 («And») et t’as toujours rien dans ta besace. L’album se condamne de lui-même aux oubliettes. Et puis, alors que tu te préparais au renoncement, la marée monte soudainement avec l’indicible «Flying». Ce hit psychédélique monte et débouche sur le niveau supérieur, alors tu t’inclines et tu prêtes allégeance.

Avec Growing Eyes Becoming Strings, Stephen Lawrie renoue avec la grande tradition de la Mad Psychedelia. Il s’y montre même le maître incontestable avec «Vanishing Lines». Il crée son Wall of Sound psychédélique. Et ça repart en mode stomp d’extrême onction avec «(In The) Hidden Fields». Big power orbital, Lawrie visite les mêmes contrées qu’Hawkwind. T’es dedans. Fabuleux shoot de mad stomp et de power fondamental. L’autre mad hit de l’album s’appelle «Get Out Of Me». C’est la marée du siècle, ça s’étend même sur la terre entière, c’est à la fois spectaculaire et tentaculaire. Là, t’as le vrai truc. Avec «Dead Head Lights», il s’enfonce dans les sargasses de la mélasse. C’est assez évolutif et visité par des vents mauvais. Puis on le verra se répandre comme un gaz mauve sur toute la surface de «What You Love». Le bassmatic chevrote dans le son, comme s’il toussait. C’est d’un très haut niveau rampant.

Mine de rien, Experimental Health est un big album, ce qu’on appelle dans le code de la route un passage obligé. Stephen Lawrie y est le dernier descendant de la race des lignées. Il chante en mode confidentiel. Et soudain, la terre tremble : «When I Hear The Sound» sonne comme de l’heavy Spacemen 3, c’est du deep inside the heart, exactement la même engeance, Lawrie va sous le boisseau et travaille la chair du drone, il fait une marychiennerie qui balance entre tes reins malades, ça périclite dans une mer de honte, il opère un fantastique plongeon dans les bas-fonds du meilleur rock de l’univers, celui qui naît d’un cerveau anglais malade de psychout so far out. Back to the marychiennerie avec «Leave Nobody Behind», il s’y plonge jusqu’au cou et passe ensuite au wild as fucking fuck avec «45E». Il ne recule pas devant l’adversité : pur jus télescopique bien hypno, avec l’essaim. Album infernal, le chemin de croix se poursuit avec la mad psychedelia de «Wrong Dimension». Il enfonce son clou à coups de boutoir. Pur génie psyché ! Tu assistes au balancement du pendule mortel d’Edgar Allan Poe. «Repetitive Brain Injuries» ne va pas bien, c’est assez robotique. C’est l’hypno de Lawrie, alors tu lui fais confiance.
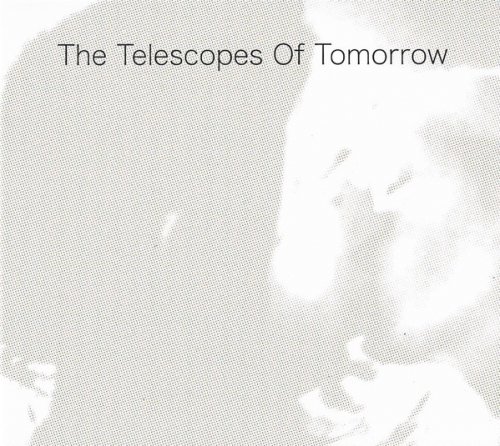
Pour un Tapete de 2023, Of Tomorrow n’est pas mal du tout. Wow wow oui oui, comme diraient les London Cowboys. T’as au moins deux cuts inspirés du Velvet, «Everything Belongs» et «Down By The Sea». Lawrie est très porté sur l’hypno, c’est pour ça qu’on l’admire, comme on admirait le Velvet. Le psyché d’«Everything Belongs» est beau comme un cœur, avec des relents d’All Tomorrow’s Parties, relents que tu retrouves dans «Down By The Sea» : t’as le poids du gothic new-yorkais, tout le poids du Dakota et de Rosemary, ah comme l’ambiance peut être satanique, profonde et vipérine. Il tape encore en pleine marychiennerie avec «(The Other Side)», c’est bien stompé dans la couenne du beat, avec bien sûr un solo d’élan vital. Lawrie sait amener un coup de génie sonique. Mad psyché à la Lawrie avec «Butterfly», bien pesant, bien lesté de tout son poids. Encore un beat lourd de conséquences dans «When Do We Begin?». C’est admirablement maîtrisé, ça reste passionnant. On croit entendre Richard Hawley dans «Only Lovers Know» : beau mélopif romantique soutenu à l’orgue.
La suite au prochain numéro.
Signé : Cazengler, gros Telescon
Telescopes. Le Trois Pièces. Rouen (76). 14 octobre 2024
Telecopes. Taste. Cheree 1989
Telecopes. Everso. Creation Records 1990
Telecopes. Celeste. Creation Records 1991
Telecopes. The Telecopes. Creation Records 1992
The Telescopes. Growing Eyes Becoming Strings. Fuzzclub 2024
Telecopes. Experimental Health. Weisskalt Records 2023
The Telescopes. Of Tomorrow. Tapete Records 2023
Telecopes. Radio Sessions 2016-2019. Tapete Records 2024
The Telescopes. Halo Moon. Tapete Records 2024
The Telescopes. As Approved By The Committee. Bomp! 2008
Wizards & True Stars
- Rev Party
(Part Two)

Tu l’attendais comme le messie. Tu savais pourtant que son dernier album Born Horses n’était pas si bon. Tu savais qu’avec Born Horses, Jonathan Donahue avait hélas perdu le singalong du Deserter. Tu savais tout cela et pourtant tu t’es rendu sur le lieu de son passage. Car tu étais de nouveau en quête de cette ancienne mystique. Tu espérais reboire ses paroles et goûter au sucre de sa magie.
Dans la queue, zéro copain. Il faisait déjà nuit et un mec est arrivé dans la rue avec des lunettes noires : Grasshopper, le petit complice de Jonathan Donahue. Sunglasses after dark. Seul un Américain à Paris pouvait se balader la nuit avec des lunettes noires. Fin du préambule.

Jonathan Donahue arrive sur scène après les autres, coiffé d’une casquette de newsboy, vêtu d’une tunique trois-quart noire, d’une chemise blanche et d’un gilet noir, et chaussé de pompes à grosses boucles carrées en or. Soigné. Presque anglais. Dandy des Catskills. Un petit côté Fabrice Luchini dans la façon de s’émerveiller sur scène et de remercier le gentil public for coming out.

Et puis il attaque par l’une des phrases magiques du Deserter, Well goodbye southern spy/ I’ve come to love you in the light, le premier vers du mystérieux «Funny Bird», et là tu renoues avec l’ancienne mystique. Elle est intacte. Dans ce pur moment de magie pop, tu goûtes au sucre.

Le plus curieux de toute cette histoire, c’est que les 90 mn de set sont prises en sandwich entre deux hits intemporels, «Funny Bird» et «The Dark Is Rising» - épique envolée mélodique qui s’achève sur I always dreamed I’d love you/ I never dreamed I’d lose you/ In my dreams I’m always strong, qui est une sorte de fin en soi, sans doute l’un des sommets de la pop américaine, en tous les cas, c’est du niveau de ce qu’a fait Brian Wilson toute sa vie.

Jonathan Donahue hante ses cuts pour le bonheur de tous. Il a cette prestance qui fait la grandeur des magiciens. Vers la fin, il réussit aussi à coincer dans le set l’«Opus 40» qui vaut encore pour une envolée à la Brian Wilson. Il sort aussi d’All Is Dream l’excellent «Spiders & Flies». Finalement, t’es assez content, tu ne seras pas venu pour rien. Tu fais le plein de magie pop à la pompe Mercury.

Oh et puis ça, que t’as dans la peau et que s’appelle «Hole» - Time/ All the long red lines/ That take Control/ Of all the smoke like streams/ That flow into your dreams/ That big blue open sea - qu’il chante d’une voix si perchée et si pure, et que t’as dans la peau, car c’est mélodiquement parfait, avec un réel développement épique, bien reconstitué sur scène, les Rev ne sont pas si bêtes au fond, ils terminent avec quatre hits faramineux issus de la grand époque et quand Jonathan le magicien termine sur Bands/ Those funny little plans/ That never work quite right, t’es encore plus hooké qu’à la grande époque. La résonance en toi est infinie.

Au pire, tu vas sauver deux cuts sur Born Horses : «You Hammer My Heart» et «Everything I Thought I Had Lost». Avec l’Hammer, Jonathan plonge dans les profondeurs du rêve de Mercury, avec cette voix si sucrée d’empereur romain du XXe siècle. Tu te noies dans l’ambiance et tu coules en même temps qu’un solo de sax. Et ça te convient. Avec «Everything I Thought I Had Lost», il stagne encore dans un groove ambiancier, on sent même monter une marée de son, mais ce n’est pas la marée du siècle. Une trompette erre dans le delta du Mekong durassien, et ça peut devenir beau à force de power orchestral. C’est la carte que joue le Rev avec cet album : pas de catharsis mélodique, juste du pur power orchestral. Comme le montre encore le «Mood Swings» d’ouverture de bal. La trompette a détrône l’empereur Jonathan. C’est elle qui déborde d’ambition. Elle résonne dans l’écho du temps. C’est long, établi, très Bella Union. L’empereur Jonathan chante juste en dessous, comme s’il n’osait pas reprendre le pouvoir. Il murmure. Il fait encore de l’ambiancier d’anticipation avec «Ancient Love», mais il perdu sa couronne de Deserter. Tout l’album est suspendu dans le vide, comme vrillé du bulbique. Ils ont perdu la mélodie, alors ils la remplacent par de l’ambiance.

Deux canards anglais sont montés au créneau pour essayer de sauver non pas le soldat Ryan, mais le soldat Donahue. Dans Uncut, le soldat Donahue dit que Grasshopper et lui sont comme Butch Cassidy & the Sundance kid, «We’re there for each other.» Ils sont basés tout près de Woodstock. Will Hermes voit arriver le soldat Dohanue sur une «1986 Suzuki» et ne peut s’empêcher de le comparer au Dylan qui pilotait sa Triumph T100 «on these same treacherous country backroads in 1966.» Hermes évoque aussi les mentors de Mercury Rev, Tony Conrad, qui fit partie du Dream Syndicate de LaMonte Young, et Robert Creeley, «the Black Mountain poet and master of minimalist compression.» Grasshopper a longtemps étudié avec Tony Conrad. Dans le coin, on trouve aussi le vieux studio Bearsville de Todd Rundgren, «across the parking lot». Et puis des traces de The Band, bien sûr. Hermes évoque aussi les nouveaux venus dans le groupe, la poule de Donahue, Marion Genser, et Jesse Chandler, un multi-intrumentiste qui joue aussi avec Midlake. En fait, le pauvre Hermes n’a pas grand chose à dire. Peut-être n’y a-t-il rien de plus à savoir que ce qu’on voit sur scène.

Dans Record Collector, Shaun Curran qualifie les Rev de «damaged psych-rock dreamers» et Deserter’s Song d’«orchestral rock masterpiece». C’est bien le moins qu’il puisse dire. «Since then», poursuit le Curran, «there have been forays into country, electronica, krautrock, ambiant textures and Eno-esque soundscapes», et c’est bien là le problème. Les Rev n’ont pas su rééditer le double exploit de Deserter’s Song et d’All Is Dream. Le Curran creuse plus que l’Hermes dans l’analytique, et ça permet de comprendre un peu mieux la dérive d’un Rev qui selon le Curran, se rapproche de Miles Davis et de Chet Baker. C’est-à-dire l’ambiancier. C’est bien ce qu’on ressent, à l’écoute de Born Horses : l’ambiance a remplacé la mélodie. Ça pourrait être une tragédie, mais on va se calmer. Pour enfoncer son clou là où ça fait mal, le Curran ajoute que les «jazz elements» sont plus prononcés. Le mot de la fin revient au soldat Donahue : «We know we’re not jazz musicians. We’re not Delta blues musicians. I’m not sure we’re even rock musicians. But we love music.» Il dit s’intéresser de très près au «spirit of the atmosphere of some of those emotional jazz records, like Sketches Of Spain.» Il ne jure que par le spirit.
Signé : Cazengler, Mercuré raide
Mercury Rev. La Maroquinerie. Paris XXe. 13 novembre 2024
Mercury Rev. Born Horses. Bella Union 2024
Will Hermes : The Hudson line. Uncut # 330 - October 2024
Shaun Curran : Silver lining. Record Collector # 552 - October 2024
L’avenir du rock
- Bury me dead
L’autre jour, l’avenir du rock assistait à l’enterrement de son petit frère, le passé du rock. Pour surmonter un vague malaise, il se contentait de penser qu’après tout ce n’était pas une grosse perte. L’avenir du rock se voyait contraint de penser n’importe quoi, à seule fin de colmater les brèches et empêcher sa cervelle de couler comme un navire. Il s’efforçait de penser à tout à rien. Dans les moments les plus obscurs, il ramenait toujours Aragon. Une sorte de réflexe. Notamment la strophe de Cézanne - Tout le monde n’est pas Cézanne/ Nous nous contenterons de peu/ L’on pleure et l’on rit comme on peut/ Dans cet univers de tisane - Puis il passait à la strophe suivante pour tomber sur le Breughel forain et l’ombre sur la muraille. Mais Aragon ne dure qu’un temps, et il fallait passer à autre chose. L’avenir du rock s’est alors mis à imaginer que le temps s’arrêtait. Et soudain il entendit ce silence assourdissant qui annonçait le retour d’Aragon. Excédé, l’avenir du rock siffla entre ses dents :
— T’as qu’un temps, Louis !
Pour ne pas voir le trou dans la terre, il se mit à scruter le ciel gris et à le soupçonner de lui cacher des choses. Ciel menteur, ciel pourri, en qui tout est... Sentant bien que sa pensée s’égarait, il redescendit sur terre pour regarder les autres gens sans les voir. Il vit aussi les innombrables vieilles tombes de vieux crabes disparus depuis longtemps, il ne savait plus quoi faire de son regard, et de toute façon, il était hors de question de voir le trou avec le petit frère au fond, car cette dimension du trou n’avait jamais existé dans leur cosmogonie, donc c’était exclu, irrecevable, contraire à leur polémologie, contraire à l’essence même de leur existence, la mort, oui, mais pas le trou. Jamais de la vie. Sors de là, passé du rock ! L’avenir du rock était en pleine surchauffe d’exhortation mentale lorsque qu’un olibrius plus haut que lui s’approcha de son oreille pour lui murmurer d’une voix sourde :
— Vous voulez un mouchoir, avenir du rock ? Vous avez de la morve...
L’avenir du rock s’essuya du revers de la manche.
— C’est un rhume. Je ne vous connais pas, et je ne veux pas vous connaître. Le passé du rock a commis la pire erreur de sa vie : casser sa pipe en bois.
— Vous pourriez montrer un peu de respect !
— Non, c’est un étranger au fond d’un trou. A Place To Bury Strangers.
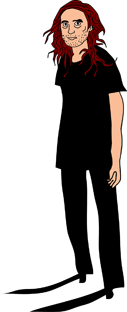
L’avenir du rock rue parfois dans les brancards pour les besoins de la cause, et pour aggraver son cas, il profite d’un enterrement pour enfoncer son petit clou dans la paume du jeu de paume. Rien de tel qu’une prise sur la réalité pour bâtir l’édifice d’un hommage.


Il est évident qu’à la parution de leur premier album sans titre, personne ne s’est méfié d’A Place To Bury Strangers. Cet album est l’extravagant prolongement du sonic trash des Mary Chain. Oliver Ackermann reprend les choses là où les a laissées William Reid, c’est-à-dire so far out. Pour bien comprendre ça, il faut entendre «Missing You». T’as aucune chance d’en réchapper. L’Acker se jette dans la bataille, il se soûle de marychiennerie. Tu commences par croire que c’est une coïncidence, qu’il est tombé comme ça par hasard sur les accords et la disto de William Reid, mais tu tombes plus loin sur «Another Step Away» et c’est encore en plein dans le Sidewalking. L’Acker pousse vraiment le bouchon de William Reid. Il te sature ça de surcharge pondérale atomique. Il va trop loin, beaucoup trop loin. Il cultive la fragrance du flagrant delight. Encore une marychiennerie archétypale avec «Ocean». C’est l’heavy beat de Glasgow transposé à New York City, c’est tellement criant de vérité véracitaire ! T’as là l’album que les Mary Chain n’ont jamais fait, c’en est même gênant pour eux. On plonge à nouveau au cœur de l’enfer des marychienneries avec «Never Going Down». L’Acker semble y cultiver des délices brûlants, il retape bien les atmosphères cataclysmiques. C’est l’exact prolongement du burn-out des frères Reid. C’est du real deal de corde Reid. Puis l’Acker fait sonner son «Sunbeam» comme un heavy hit paisible. Te voilà tanké pour l’éternité, enfin, ce qu’il en reste.

Attention à Exploding Head : ce double CD explose véritablement. Comme le dit si brillamment Tris McCall dans ses liners, «that sonic onslaught is part of the entertainment.» Il évoque un mélangé explosif de melodies, de feedback et de disto. C’est en fait l’apocalypse selon Saint-Qui-tu-veux. Ces mecs déboulent et tant pis pour les canards boiteux. Ils te saturent «In Your Heart» de power. Oliver Ackermann arrive encore à évoluer dans ce chaos saturé. Il tombe en pleine Marychiennerie avec «Lost Feeling». L’Acker lâche les chiens de l’enfer, ça dépasse les bornes, ça sort du cadre. Comment peut-on saturer un son à ce point ? Wild attack avec «Dead Beat». La basse broute la motte du chaos, tout est chauffé à blanc, ils jouent tout ce qu’ils ont dans le ventre. En plein processus de destruction massive, l’Acker chante «Smile When You Smile» par dessus le chaos. Tout est bombardé, ici, ça pilonne le tampani et il cède à une belle tendance hypno avec le morceau titre. Le disk 2 est nettement plus radical, via notamment cette prodigieuse cover de «Suffragette City». Heavy trash de Bury sur le dos de Bowie. Sans doute a-t-on là la cover la plus trash de tous les temps. Il te la blinde de power, la gorge à outrance, il en fait de l’ultraïque demented, du blaster dévoyé, le point ultime du Suffragettisme, encore une fois l’awsome t’assomme, et le redémarrage te colle au mur.

On trouve aussi six Marychienneries patentées sur ce disk 2, à commencer par «Girlfriend» et ce punch écœurant d’allure. Et puis comment ne pas saluer l’«Hit The Road» d’ouverture de bal, monté au max du mix, ultra-violent, c’est du Mary Chain à la puissance 1000, du Sidewalking over-blasté, c’est apocalyptique de marychiennerie. L’Acker se glisse encore sous le boisseau des Mary Chain avec «It’s A Fast Driving Up With A Place To Bury Strangers». C’est complètement saturé de violence sonique, les descentes dans l’infrabasse sont vertigineuses, ça te cisaille les tibias, ça t’empêche de respirer, ça t’écrase au fond du cendrier. «Alive» est encore plus blasté qu’à l’ordinaire. Cette tension organique est unique au monde. A-t-on déjà vu une dégelée aussi purpurine que celle de «Don’t Save Your Love» ? Jamais. L’Acker chante avec les hoquets de l’agonie du combattant, ahhh-ahhhh. «Take It All» est encore bien explosé du diaphragme. Astonishment garanti ! Marychiennerie dans l’âme. Ils t’explosent «The Light» d’entrée de jeu, avec du larsen et le beat des forges sous amphètes. Ils explosent encore l’art de William Reid en 1000 morceaux. Ça va trop loin, beaucoup trop loin. Ils restent en pleine Marychiennerie avec «Tried To Hide», avec un focus sur le non-retour.
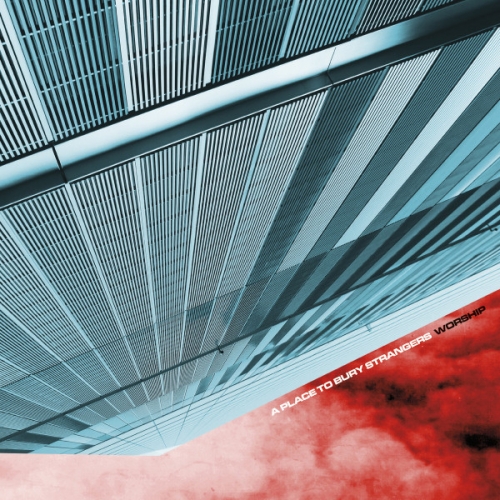
Le Worship de 2012 pourrait presque passer pour un Tribute aux Mary Chain. Premier exemple de marychiennerie avec le morceau titre, gorgé d’échos d’Upside Down et de Never Understand et de Sidewalking. Encore les pieds dans le plat de marychienneries avec «Revenge». Pur sonic genius. Oliver Ackermann ramène toute la chimie de destruction massive imaginée par William Reid. Encore de l’onslaught à la Mary Chain avec «And I’m Up», «Slide» et «Leaving Tomorrow». Il te crève l’œil du cyclope Reid. Et puis t’as l’«Alone» d’ouverture de bal qui te stompe le crâne, Bury me dead baby. Pas de retour possible. Avec «Mind Control», il fait monter une sauce de chaos mélodique. Apocalyptique ! Et ça part en marychiennerie monolithique, ils te creusent vite fait un tunnel sous le Mont Blanc, quelle puissance de forage ! Les poux brûlent et l’Acker te plaque les pires accords de chaos de l’univers connu des hommes. Par contre, «Dissolved» est plus spacieux, plus largué du côté de Major Tom. L’Acker envoie encore des sacrées rasades de nowhere land avec «Fear». C’est un homme de chaos, l’un des plus aboutis. Il surpasse les frères Reid. Il crée une réelle profondeur de la peur.

Ça pue encore la marychiennerie sur Transfixiation. «Fill The Void» a marché dedans. L’Acker y va à l’over-blast. D’ailleurs, tout l’album baigne dans l’over-blast. L’Acker sort un son dévergondé, sauvage et sans pitié. Il te tombe dessus à bras raccourcis. Avec «Deeper», il s’enfonce dans les profondeurs du Deepy Deep, ça friture de partout dans les minutes de sable mémoriel. Il se livre une fois encore à la destruction totale du rock. «We’ve Come So Far» tombe comme une chape de plomb. Ça bascule dans l’horreur des forges du Creusot, ça monte comme une marée d’acier, c’est à la fois violent, dense et inextricable. C’est le power définitif du non-retour. En fait, il n’existe pas de mots pour qualifier ça, alors on peut raconter n’importe quoi. «I’m So Clean» incarne le blast absolu, du Mary Chain à la puissance 1000. Ça te broute la motte, mais à un point terrifiant. L’Acker termine avec un «I Will Die» sur-saturé. Il atteint la limite du supportable.

Pinned sent encore bon la marychiennerie : dans «Act Your Age», la basse te broute la motte. Coup de génie avec «Frustrated Operator». Attaqué en mode new wave, mais avec une réelle profondeur de champ, c’est bien sabré des tibias, balayé par des vents mauvais, alors jette-toi à l’abri. Le beat est tellement profond que tu leur donnerais le bon dieu sans confession. «Never Coming Back» sonne comme du Mary Chain exproprié. Pas content. Revêche. Finit en ébullition. «Situation Changes» sonne un peu new wave. Dommage. Mais il y a de l’azur dans les ténèbres de l’Acker.

Sur l’excellent Live At Levitation, on retrouve un symbole parfait de la marychiennerie, «Dragged In A Hole». Rien de plus Mary Chain que l’Hole d’«In A Hole». Tout est travaillé au chaos maximal sur cet album. L’Acker ne rigole pas, comme le montre encore cette fantastique volée de bois vert qu’est «Alone». Les Bury planent comme des mauvais esprits sur les Angevins du Levitation. Big bass rumble en ouverture de bal de de B pour «I Lived My Life To Stand In The Shadow Of Your Heart». Ils savent bien déblayer une barricade. Wooof ! L’Acker joue avec la révolution industrielle, il injecte le pouls d’Elephant Man, et les hélicos d’Apocalypse Now dans son sonic trash. C’est le pouls de la mort qui descend sur Angers. Il travaille l’océan d’«Ocean» à sa façon, avec les attaques en règle des spoutnicks délétères. Et puis voilà l’attaque de l’essaim avec «Have You Ever Been In Love». The Green Hornet craze ! Ils torturent le sonic trash pour lui faire avouer l’inavouable. C’est saturé de trash et l’Acker parvient encore à hisser le chant à la surface. il chante comme un shaman indien à fortes syllabes chargées de fumée, il éclaire la nuit et l’essaim rôde dans le cosmos angevin. Les Bury transforment le Levitation en messe païenne.
Signé : Cazengler, complètement Bury
A Place To Bury Strangers. A Place To Bury Strangers. Killer Pimp 2007
A Place To Bury Strangers. Exploding Head. Mute 2009
A Place To Bury Strangers. Worship. Dead Oceans 2012
A Place To Bury Strangers. Transfixiation. Dead Oceans 2015
A Place To Bury Strangers. Pinned. Dead Oceans 2018
A Place To Bury Strangers. Live At Levitation. The Reverbation Appreciation Society 2023
Inside the goldmine
- Creepy n’est pas une crêpe
Creepo traînait régulièrement dans la boutique. Il trimbalait une dégaine un peu rockab, il se gominait les cheveux et s’habillait en noir. Disons qu’il avait plutôt fière allure, ce qui n’était vraiment pas le cas des autres habitués du bouclard. Et puis un soir, au moment de l’apéro, alors que nous étions rassemblés en petit comité autour du comptoir, il vint taper l’incruste dans une conversation à propos de Wild Billy Childish. Il avait l’air d’en connaître un rayon. Il parlait d’une voix de mec timide, ce qui contrastait avec son look. Les autres le laissaient parler, car d’une certaine façon, il faisait autorité sur le sujet, ce qui, dans cette ville maudite, était plutôt exceptionnel. Enfin un mec qui connaît bien Wild Billy Childish ! Il alimentait la conversation comme on alimente la chaudière d’une locomotive lancée à travers la plaine. Il connaissait parfaitement l’historique des groupes successifs du grand Billy, il remontait des Milkshakes jusqu’aux Singing Loins, en passant par Buff Medways, Thee Headcoats et Thee Mighty Caesars. Il insistait sur le Thee. Zeeeee ! Il finissait par devenir impressionnant. Il pouvait même aller jusqu’aux Delmonas et aux Headcoatees. Évidemment, les autres décrochaient, la conversation devenait trop pointue, Creepo entrait bien dans les détails, il parlait de Nurse Julie comme s’il la fréquentait tous les jours, affirmait qu’elle jouait de la basse mieux de Bob Garner dans les Creation, et il brodait à l’infini sur les talents conjugués de Wolf et de Russ Wilkins, de Graham Day et de Mickey Hampshire, et il repartait dans les méandres de Medway avec un luxe de détails qui finissait par donner le tournis, il n’arrêtait pas de dire «Faut qu’t’écoutes ça et ça !», et de te vanter les mérites d’albums tous plus extraordinaires les uns que les autres. Arriva l’heure de la fermeture, et alors que nous descendions la rue, Creepo demanda un numéro de téléphone. Pas de problème. Dans les semaines qui suivirent, il m’appela pour me vendre à peu près tous les albums dont il avait ce soir-là vanté les mérites. Il était une sorte de «disquaire en chambre», c’est-à-dire sans boutique, et d’une certaine façon le meilleur disquaire de France, et c’est pour cette raison que les autres disquaires le haïssaient. Une haine dont vous n’avez pas idée.

De Creepo à Creepy, il n’y a qu’un pas. Alors franchissons-le allègrement. Ils sont aussi cryptiques l’un que l’autre. Ils en commun un certain charme, mais c’est dirons-nous un charme dont on fait vite le tour. Creepy et Creepo n’avaient qu’une seule idée en tête : vendre des disques. Rien d’autre. Absolument rien d’autre.

Tous les amateurs de proto-punk connaissent bien Creepy John Thomas. Il est devenu avec le temps une sorte de passage obligé. Comme son nom ne l’indique pas, Creepy a démarré de bonne heure en Australie, avec les Flies. Ils font partie de la scène de Melbourne. Mine de rien, les Flies ont réussi à intégrer en 1965 la tournée australienne des Stones et de Roy Orbison. Creepy le dit lui-même : the Flies n’ont guère d’intérêt, tame pop songs. Pas de proto. Quand Ronnie Burns quitte le groupe, les Flies battent de l’aile, et en 1967 Creepy quitte l’Australie pour s’installer à Dusseldorf. Sa copine est allemande. Puis il va à Londres monter un groupe. Il passe une annonce dans le Melody Maker et recrute deux petits mecs, Walt Monaghan et Brian Hillman. Le groupe s’appelle Rust et enregistre Come With Me en 1969.

Ils tapent dans le fast heavy British groove en vogue à l’époque. C’est un beau power trio avec du chant plein la bouche et un peu de disto. Avec «Think Big» ils tentent un coup à la Seeds et Creepy fait bien son Saxon. Mais leur «Delusion» reste très en dessous de la moyenne, même si après le sermon de circonstance - You just get what you need/ To make up your mind - ils se payent une petite fuite en mode gaga. Ils font de la belle pop américaine avec «Find A Hideway», ils tapent dans le psych US et là ça marche. Creepy est bon, parce qu’il est convaincu. Typique de l’époque, «The Endless Struggle» est assez wild. Mais comme l’album ne sort qu’en Allemagne, il disparaît rapidement des radars.

Les deux Anglais rentrent au bercail et Creepy continue de ramer en Allemagne. Il rencontre Conny Plank à Cologne. Ils enregistrent des démos que Creepy présente chez RCA à Londres. Signé. Alors Creepy retourne bosser avec Conny à Cologne, et pour se booster la cervelle, il tape dans ce qu’il appelle the psychoactive substances, comme tout le monde à l’époque. Creepy indique qu’il tire son Creepy du «Creepy John» enregistré en 1963 par le country blues trio Koerner Ray & Glover, l’un des fleurons de l’Elektra des origines.

Ce premier album sans titre de Creepy John Thomas tient superbement bien la route. Vroom vroom, ils font une espèce de gros boogie de gros sabots avec un chant perlé de faux accents de Bolan/Deborah (Gut Runs Great Stone»). «You’ve Got To Hide» sonne comme le blues rock des enfers. Ils ont tellement de son qu’on en frémit. Creepy fait bien la bête de Gévaudan. Ils passent au proto-punk avec «Trippin’ Like A Dog & Rockin’ Like A Bitch». Il est bien harsh, le Creepy sur ce coup-là, ils tapent leur proto à coups d’acou, il fallait y penser. Encore deux belles surprises en B : «Green Eyed Lady», attaqué à la basse et noyé sous une salade de wild disto, avec une grosse présence de la substance. Et «Lay It Down On Me», attaqué à la dure. Creepy peut te cavaler sur l’haricot vite fait, il est assez extrémiste, pas de problème, il ne vit que pour l’énormité. Il a tous les kudos du killer Brit rock. Et ça se termine avec un «Moon And Eyes Song» bien explosé, comme si Creepy lui avait enfoncé un pétard de fuzz dans le cul.

Le groupe tourne en Angleterre, fricote avec l’Edgar Broughton Band, mais les ventes ne suivent pas. Alors Creepy retourne en Allemagne bosser avec Conny Plank. Le deuxième album s’appelle Brother Bat Bone, alors qu’il aurait dû s’appeler Brother Back Bone : Conny Plank avait mal compris le titre au téléphone. Bon bref, c’est un album engagé, stop the war, clame Creepy dans «Down In the Bottom». Puis ils reviennent à leur cher boogie avec le morceau titre. Creepy est assez intraitable en matière de boogie. Il faut que ça arrache - That’s my name - T’as même un solo de basse. Et voilà l’excellent «This Is My Body» qu’on retrouve sur la compile I’m A Freak Baby 3 - Hey hey to the judgment day - Rien à voir avec le proto-punk, on se fourre le doigt dans l’œil, avec cette histoire-là. C’est wild, bien sûr, mais trop arty pour du protozoaire. Creepy chante en plus comme une traînée du caniveau. Il tape encore sa petite chique de rock seventies avec «Standing In The Sunshine». On s’ennuie un peu, pour dire les choses franchement. Les kids s’imaginent qu’ils vont choper le rock du diable avec cet album qui vaut la peau des fesses, mais non, c’est très moyen. Ce groupe est un boogie band ordinaire. Ils n’ont qu’un seul horizon : le boogie.

Puis Creepy va bosser pendant deux ans avec l’Edgar Broughton Band. Il enregistre Bandages et Live Hits Harder avec eux. Puis, c’est la carrière solo, et deux albums avec Johnny & The Drivers.
Signé : Cazengler, Creepy John Tomate
Rust. Come With Me. Columbia 1969
Creepy John Thomas. Creepy John Thomas. RCA Victor 1969
Creepy John Thomas. Brother Bat Bone. Telefunken 1970
*
Quelle drôle d’idée que de se présenter comme des loups en cage. Que veulent-ils nous signifier. Que nous sommes tous enfermés dans une cage. Puisqu’ils sont autrichiens, ils ont sans doute lu Le Loup des Steppes d’Hermann Hesse, le titre est beau, davantage roboratif, toutefois Harry Haller, le héros de e roman, n’a-t-il pas un mal fou à s’extraire de lui-même… J’ai décidé d’aller voir, faut dire que dès que j’aperçois le mot ‘’tale’’ dans un titre, le nom d’Edgar Poe s’installe dans mon esprit, je me sens l’âme de Dupin et je me lance dans mon enquête.
A DESERTS TALE
CAGEG WOLWES
(Tape Capitol Music / Novembre 2014)
De prime abord la couve n’est guère attirante, au bout de quelques minutes l’image se révèle totémique, elle captive, elle vous retient prisonnier, elle est signée d’Agaric. Tapez sur Agaric eu, sur Illustrated Music vous verrez l’ensemble des couves qu’il a consacrées au groupe depuis sa création en 2017. Il aime bien animer, quel que soit le sujet abordé, mettre sans trop enmouvement ses créations, juste un détail. Il ne cherche pas à produire mais à suivre, une véritable attention. L’on sent qu’il doit choisir ses sujets.

Christian Sarko : vocals, bass / Manuel Vlasic / Branko Dzukic / Chris ‘’Cian’’ Simon.
Dusk : ils se définissent comme un groupe de stoner-alternatif, très logiquement nous nous retrouvons dans un désert alors que le soir tombe. Si vous pensiez à un admirable coucher de soleil sur les dunes, remisez vos cartes postales dans les poubelles de l’espoir, l’instrumental dépasse à peine la minute, il tintinnabule d’une manière déplaisante, par-dessous la rythmique essaie de vous faire croire qu’elle se prend pour le tambour des sables, mais ce n’est pas très grave car quand la mort s’annonce votre esprit possède une moins un fondement métaphysique des plus cartésien, je pense que je vais mourir donc je vis, par contre avec cette guitare déglinguée vous comprenez que ce qui vous attend n’est pas jojo, que vous allez morflez un max. Lost in the desert : ai-je déjà entendu une guitare tituber de cette manière, l’on reprend le film à son début, pas tout à fait, il y a un bon moment que vous marchez dans cette étendue aride, la chaleur est intense et votre cerveau entre en ébullition, pour un peu vous percevriez le clapotement de vos synapses bouillonnantes. Heureusement qu’un chant d’espoir se fait entendre, enfin si l’on écoute avec attention ce n’est pas si clair, par derrière vous avez un grésillement comme… un vent de sable qui n’en finirait pas de souffler, pas à grande vitesse, pas une tornade, si constant qu’il en devient, fatiguant, pénible, angoissant, sans compter cette lenteur, même si vous vous dites que cette surface doit avoir une fin, vous clopinez un plus fort, bourdonnement dans les oreilles, interlude musical illimité, l’en devient pesant, démoralisant, la batterie alentit vos pas, la guitare de votre imagination vous pousse en avant, le chant s’essouffle, votre silhouette ressemble à celle d’un dromadaire d’un dromadaire boiteux, parfois l’humour impose une borne au découragement, tout de même vous devez reconnaître que plus vous avancez, moins vous progressez, et si ce méhari n’était pas une pensée mais un véritable être vivant annonciateur de ce palais des mille et une nuits sis au milieu d’une oasis luxuriante, le vent forcit, il dissipe le mirage de sable de mon imagination, de mon désir de partir, la guitare comme un moteur d’avion qui vrille, tout s’accélère, feu brûlant du soleil, ou vents torrides, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu, suis-je au-travers des dunes, ou dans le désert de mes rêves. Eleutheromania : aux grands maux les grandes idées. Certes c’est un peu compliqué, n’empêche que perdu en ce désert je ne me plains pas, n’est-ce pas le moment de me livrer à mon idée fixe, à cet amour immodéré de la liberté, que j’ai toujours recherché, guitares optimistes et excitantes, grondeuses de désirs libérés, je cours dans ma tête alors que je suis en plein milieu du désert, peut-être la prochaine enjambée sera-t-elle celle qui me libèrera de mon passé et me donnera accès à cet eldorado libertaire que j’ai toujours cherché en vain, la batterie alerte trottine, ne suis-je pas en train de quitter la carapace protectrice de mon vieux moi, ne suis-je pas en train de muer, de devenir le prince d’un royaume intérieur ou extérieur de toute beauté, de toutes possibilités ouvertes. Laguna : Une lagune est la dernière chose que l’on s’attend à trouver dans un désert, est-ce pour cela que la batterie bat toute seule comme un cœur angoissé, et cette guitare qui n’ose pas faire de bruit, la voix traîne des pieds dans le marécage intérieur, elle n’est pas sûre d’elle-même mais elle est certaine de la réalité de son rêve, pas vraiment joyeuse car elle sent que la dimension dans laquelle elle évolue n’est pas très éloignée de son propre passé, certes elle est dans le désert mais il suffit de vouloir vivre dans les intempéries du désert, de le considérer comme l’endroit de la liberté pour devenir libre, une sensation de liberté éthérée chiffonne mon âme et l’emporte comme un fétu de paille, je suis devenu le roi de mon univers, la musique éclate et rocke de tous les côtés, exaltation féérique.

The lost tale : le conte perdu, il est raconté le soir autour du feu, le Voyageur raconte, il parle, la musique imite le soir qui tombe et les mystères de la nuit, le Voyageur raconte d’où il vient, il parle de son royaume, sa voix est comme doublée comme si toutes les âmes du village répétaient le récit au fur et à mesure qu’il le prononçait, moment de grande persuasion, les esprits de son auditoire infusent, ils captent, ils comprennent, l’histoire est merveilleuse, eux-aussi ont envie de se rendre en ce pays aussi beau qu’un rêve, mais cela ne les rend pas joyeux, l’angoisse les saisit, l’intuition que le voyage qu’ils vont entreprendre ne sera pas de tout repos leur apprend qu’il leur faudra marcher longtemps, longtemps, et que les contrées sableuses qu’ils auront à traverser… ne sont-ils pas déjà en route alors qu’ils restent groupés autour du feu, leur village ne perd-il pas tout son charme, ils savent désormais que le mystérieux inconnu les attend et l’angoisse les étreint. Call of the void : Qui saurait résister à l’appel du vide, ils sont en marche, cahin-caha, chaque pas les éloigne de leur ancienne vie et les rapproche de ce royaume vers lequel ils se sont mis en route, mais peut-être dès le premier pas accompli en ont-ils franchi la frontière, ce n’est pas le paradis, mais un espace qui bruit de vide et d’appels, Le Voyageur qui les guide n’a pas peur, il avance imperturbable et eux ne savent plus s’ils visitent un pays réel ou s’ils arpentent un rêve, qui peut-être ne leur appartient pas, long solo de guitare comme une barrière infranchissable de barbelés qui une fois franchie laisse place à une autre réseau de barbelés… où sont-ils, où vont-ils ?ils ne savent pas, l’eau de la peur inonde les caves de leur âme. Chaac : incroyable mais vrai, ils sont arrivés, ce n’était pas un mensonge, ils rient de leurs appréhensions, les guitares dansent, mais la voix reprend son conte, elle décrit la situation idyllique, cette vie de repos et de bonheur infinis, guitares et batteries sautent de joie… mais que se passe-t-il, qu’arrive-t-il, impalpable mais vrai, déjà ce n’est plus comme tout à l’heure, la musique ne joue plus, elle sonne le glas, la guitare se met au blues, la pays de Chaac ne serait-il qu’une fausse promesse, qu’un bonheur illusoire, une fois que l’on a mordu l’écorce amère de de ce doux fruit sucré qu’est l’orange du rêve, sommes-nos condamnés à pâtir sans fin, à ne plus être libre à être soumis à des forces supérieures qui nous dominent, comme des hurlements de terreur, à moins que ce ne soit une tempête de sable qui engloutisse les rêves les plus fous et les plus éclatants sous les dunes de la réalité… musique et batteries recouvrent tout, la voix s’est tue, combien de royaumes perdus qui eurent la transparence rayonnante du rêve dorment pour toujours enfouies sous des millions et des millions de tonnes de sable. Dawn : l’histoire est terminée, un dernier instrumental pour reprendre nos esprits, est-ce down (au plus bas) ou dawn (aube renaissante) choisissez, le désert à moitié plein de réalité ou à moitié vide de rêve, soyez optimiste ou pessimiste, qu’il soit rêve ou réalité le désert vous permettra d’’être vous-même. Ce qui est sûr c’est que Dawn n’est que la reprise de Dusk, même les serpents du désert se mordent la queue, leur motsure symbolise autant la barrière d’un lieu protecteu, que la viduité de la mort. Mais si l’on y pense le verre de la vie n’est-elle pas le verre à moitié vide de la mort, et le verre de la mort n’est-il pas le verre à moitié plein de la vie…
Ne vous perdez pas en ratiocinations infinies, imitez Harry Haller qui dans le dernier paragraphe du Loup des Steppes se promet qu’il va recommencer à vivre et ne pas rester enfermé dans sa propre cage…
Quant à notre loup encagé, nos Caged Wolwes, notez ce pluriel qui signifie que leur conte s’adresse à tous, félicitons-les pour l’originalité de cet opus dans lequel les lyrics, très soignés, et la musique forment un tout indissociable.
Damie Chad.
*
Il y a des trucs qui ne trompent pas plus qu’un éléphant car un éléphant peut être un véritable éléphant, néanmoins il vous trompe. Bref la nuit tous les éléphants sont gris. N’y avait que le nom du groupe, à sa consonnance j’en ai déduit qu’ils étaient mexicains. C’était une erreur. Dans laquelle je me suis empêtrée. Un groupe avec un tel nom à résonnance mexicaine qui a signé sur le label Glory or Deatth Records ne pouvait être que du pays des Chicanos, l’on sait comment ce peuple aime la mort ! Refilent même des squelettes en sucre comme bonbons à leurs mioches ! Géographiquement je n’étais pas loin, ils sont du Brésil, mais ils doivent eux aussi partager une légère propension pour le rire qui tue car traduit en français leur nom signifie : Cercueil !
ENTRE O VELHO TEMPO FUTURO
CAIXÄO
(Vinyl / Glory or Death Records / Janvier 2024)

Etrange pochette. Quel est cet étrange iceberg hexagonal incliné au bord de ce rivage déserté. Distingue-t-on vraiment une demi-douzaine de fourmis humaines en proie à une violente agitation. L’on ne peut s’empêcher à la première scène de 2001 Odyssée de l’espace, mais peut-être est-ce juste une illustration du titre de l’album, Entre le passé et le futur, ce bloc de glace titanesque en train de fondre représente-t-il notre passé en train de s’éloigner de nous sans que nous sachions encore quelle forme prendra notre avenir. La montagne engendrera-telle une souris, et si nous étions la montagne et si la mort était une souris…
Le groupe est fondé en 2018 par Italo Rodrigo batteur de plusieurs groupes de metal. Il semble que le personnel ait beaucoup changé au cours de sessions qui se sont étalées entre 2021 et 2023.

Fungo : (champignon) : nous hallucinons, serions-nous retournés dans le passé, pas le nôtre, précisément celui du rock’n’roll, dans les années soixante, l’instrumental est farci au Farsifa, si ce n’est pas cette marque c’est donc sa sœur, la batterie est plus proche des années soixante-dix et la guitare se tient entre les deux. L’on ne sait pas trop où l’on est, sûrement entre la vie et la mort. Bloodsteins : coup de blues si j’en crois l’intro mais le vocal nous détrompe, d’autant plus que la guitare nous fait le coup du hard-rock, l’orgue nous fait l’imitation du piano rockab avant de revenir à un jeu plus orthodoxal, ce n’est tout de même pas Steppenwolf, la guitare nous file un solo quinze nœuds avec vent arrière plein les voiles, l’on dirait une démonstration : tout ce que l’on est capable de faire, pour les paroles on n’y croit guère, le gars qui veut se retrouver et qui prend la route intérieure pour revEnir en lui, quant aux taches de sang l’on n’y croit guère… Je continue sur les routes. Revenir à l’intérieur. Fuir cet engrenage qui m’époustoufle. D’ici là je me retrouverai fermement avant que tout ne soit détruit par la machine et qu’il ne reste rien J’attends ta descente pour flairer les flaques d’hémoglobine sur le chemin. Lux extranha en Quixadà : (Etrange lumière de Quisada : ville du Brésil entourée de montagnes aux formes bizarres) : un instrumental drôlement bien foutu, petit frisson au début, mais ensuite l’orgue nous fait la démonstration du siècle, il siffle, il klaxonne, il file vers la stratosphère, sûr qu’il cherche à vous éblouir et qu’il y réussit. Vous avez envie de téléphnner à votre agence de voyage pour commander un séjour à Quixadà. Introspecçäo : (introspection) : la fièvre retombe à El Paso, si vous pensez partir pour une méditation métaphysique, Ce n’est pas tout à fait cela, vous voici dans les années soixante à la fête communale, tout le monde danse, sauf vous qui avez collectionné des dizaines de râteaux toute la soirée. In the shadow of the red sun : retour in the seventies, pas de temps à perdre, la rythmique assure, la guitare ne fume pas un pétard, n’y a que les paroles qui vous annoncent que la fin du monde est proche, que l’Humanité arrive à son terme, ce qu’il y a de terrible c’est que l’on n’y croit pas un instant, peut-être parce qu’il y a un décalage entre les lyrics qui nous parlent d’aujourd’hui et non d’avant-hier, surtout parce que la musique les annule. Aniversàrio del Màgico : (anniversaire du magicien) : z’ont enfin compris, reprennent leur blues rapide mais le vocal s’y colle dessus, ne cherche pas à nous avertir de la prochaine apocalypse, faut dire que la guitare distord la réalité, et qu’un petit remontant de pilules bleues aide el cantaor à se concentrer dans sa psyché éclatée. Mar ciano : (mer de cyan) : la mer est bleue, tendre et rose, elle vous berce à l’acoustique, votre tête qui a éclaté dans le morceau précédent a besoin de recoller le puzzle mental qui la squatte. Sur la fin, ils essaient de vous persuader qu’ils savent tout faire, l’est sûr que dans un instrumental il faut mettre les barrés un peu hauts. Talvez : (peut-être) : Au début vous avez l’impression qu’ils vous refont le précédent, l’ont colorié en rouge pompier, et sont des partisans du tout électrique, brusquement tout change, vous voici transportés sur la côte Ouest, west pacific, votre corps balancé est bercé par la plus belle des torpeurs, vous ne savez plus où vous êtes, mais vous n’avez jamais été aussi bien… Enquanto o mudo Jorra sangue : (quand du silence jaillit le sang) : intro un peu jazzy, ne craignez pas le sang, il y a longtemps que vous avez quitté votre corps, vous êtes parti si loin qu’au bout d’une minute la musique s’arrête, sans doute désormais vous vous suffisez à vous-même. Qu’auriez-vous besoin de quelque chose qui vous serait étranger… Candelabro ( Bonus) : vous avez tout de même un cadeau-bonux. Sur YT vous avez une visual vidéo qui vous permet de les voir en chair et en os. Pas trop non plus. La caméra est avant tout fixée sur les doigts des deux guitaristes et du bassiste. Attention, z’ont l’air sérieux comme des papes. Exercice convaincant. Sur les premières images se superpose le logo du groupe en forme de cercueil.
Un groupe qui semble un peu à la recherche du son qu’ils ont déjà trouvé. Mais qui n’en reste pas convaincu. Peut-être parce que dans leur imaginaire ils se confrontent aux groupes mythiques d’une époque révolue. Leur façon à eux de retourner dans leur propre futur.
Damie Chad.
*
Exilé volontaire en Thaïlande Bill Crane revisite le rock avec ses propres moyens : micro, boîte à rythmes, guitare. Le strict minimum. Mais un besoin vital. Le rock vous colle à la peau. Bien plus que la peau du serpent ne tient à sa chair sinueuse. On appelle cela l’heureuse malédiction des rockers. Interdisez-vous d’en déduire qu’Eric Calassou alias Bill Crane serait un grand monomaniaque. Vous seriez en dessous de la réalité. A vrai dire c’est un multimaniac, il compose, il écrit, il déclame de la poésie, question arts plastiques il s’adonne à la photographie. J’avais d’ailleurs le projet de consacrer une chronique à ses dernières visions, mais il vient de sortir un album numérique de douze titres sur You Tube, et le rock’n’roll passe avant tout. Dura lex, se plaindront qui ne sont pas fans de cette musique, écoutons toutefois Cicéron qui ajoutait : sed lex !
THE DREAMER
BILL CRANE
Une pochette qui utilise le même jeu de couleurs que le précédent Covers (voir KR’TNT ! 640 du 11 / 04 / 2024), un bleu outremer si près de l’outre-tombe crépusculaire cher à Chateaubriand et de ce mauve couleur des fleurs plastifiées des couronnes de cimetière. Faut dire que la cloison de verre carrelée ressemble à s’y méprendre à une grille de prison, quant au seul objet de la pièce qu’elle enclôt il s’avère être une boîte, au mieux à rêves par procuration, au pire un aspirateur mental. Vous possédez sûrement chez vous une de ces machines dangereuses. Ne culpabilisez pas, je suis en train de me servir de l’une d’entre elles pour rédiger cette chronique.

Mustang : dans le rock tout est question d’imagerie ou pour employer un terme moins encombrant de mythographies. Ne confondez pas avec les Mythologies de Roland Barthes penseur au ras des pâquerettes pour intelligences contemporaines anémiées. Le mot ‘’Mustang’’ claque comme un coup de feu. Beau nom pour un groupe de rock, en 1962 les Mustangs accompagnèrent Billy Bridge. Nous voici aux racines du rock français. Avant de continuer, munissons-nous de notre winchester pour partir à la chasse de Sarah Paling, égérie du Tea Party qui adorait massacrer depuis un hélicoptère les chevaux sauvages des immensités américaines. Le Mustang instrumental de Bill Crane trotte gentiment, l’on ne sait pas où il nous emmène mais le morceau n’atteignant pas les deux minutes nous n’allons pas tarder à le savoir. C’non Everybody : si vous croyez être en pays connu, après un instrumental un peu à la Shadows, un hit suprême d’Eddie Cochran. Nous sommes donc au pays du rock’n’roll. Pas du tout. Va falloir affûter les notions de base. Exit le good old rock’n’roll des pionniers, nous sommes en une autre dimension que nous appellerons le méta-rock. Le méta-rock se situe avant ou après le rock. Il ne s’agit nullement d’une vision historiale, du genre après le punk nous avons eu droit au post punk. Non le méta-rock se situe dans votre esprit. C’est votre propre représentation du rock, tel que vous l’analysez, tel que vous le pensez, tel que vous le rêvez… Croiriez-vous que cet album soit nommé The Dreamer par hasard. Ce rock’n’roll intellectuel Bill Crane le sort de sa tête pour vous le décrire. Il pourrait le décrire en vers ou en prose, il pourrait le dessiner ou tenter de le transformer en esquisse photographique, ou l’expliciter lors d’une conférence, il joue le grand jeu, il vous le joue. Nous refait le coup du premier vingt-cinq centimètres de Vince Taylor Le rock c’est ça nous dit-il mais il nous est demandé de comprendre : Le rock ce n’est pas ça. Réfléchissez un minimum : si vous définissez un papillon en le décrivant comme un insecte, vous n’êtes plus dans le papillon mais dans le monde des insectes. Bill Crane vous propose l’interprétation de sa propre idée du rock. Le C’mon Everybody en traduction libre signifie : Venez tous faire la fête. Donc en début vous avez une fille – élément essentiel à toute party adolescente - qui parle, et le gars qui l’appelle. Il ne lui dit pas viens poupée, c’est sa voix qui lui sert d’appeau, le serpent du désir se traîne sur le plancher, prend son temps, sait y faire pour parvenir à son but, tantôt il encourage, tantôt il fait semblant de supplier, il sait fasciner, il sait se dérober, la musique se tortille gentiment, le reptile du vocal fait le beau, il se dresse, il obtient sa satisfaction. Guitare minimale, résultat maximal ! Turn on the radio : pour les premières générations rock, la radio a été le vecteur (peu vertueux) du rock, ici nous avons droit à l’hymne au transistor, l’on pense au Rock’n’roll de Lou Reed, c’est aussi poisseux et pervers que le Velvet, Bill Crane insiste, ressemble à un sorcier indien qui marmonne des sentences incompréhensibles que tout le monde comprend, l’est un peu obsédé, la fille doit danser à tout prix, il en bêle tel un agneau qui cherche le pis de sa mère, la fin du morceau se transforme en une espèce de blues fantôme, l’est certain que personne ne pense à éteindre l’appareil, y a trop à faire. Driving on my car : vaut mieux tirer une fille dans une tire - préférez la décapotable à un poste à galène - le rocker joue au playboy, il sifflote, il module, sort le coup du fantôme, un peu de rire, un peu de fausse peur, pour qu’elle se serre tout contre lui, maintenant l’est trop occupé pour chanter, la musique se fait douce pour ne pas les déranger. The sound of sleep : le sommeil c’est bien mais c’est mieux quand on se réveille, est-ce pour cela que la guitare sonne un tantinet plus fort que d’habitude et que Bill Crane imite un peu la voix ensorceleuse de Jim Morrison, la boîte à rythmes prend le relais tandis qu’il risque quelques chatouilles vocales, silence, on ne parle pas la bouche pleine. Opium blues : bleu cyanure. Merveilleux instrumental. Gouttes d’eau qui rebondissent dans les flaques du néant. Coïtés abso(b)lues.

The dreamer : le dreamer rêve en lui-même. Le dreamer dreame, ce n’est pas un drame. Juste un rêveur. Celui qui préfère ne pas toucher à la réalité des choses. La cueillaison du rêve n’est pas le rêve. Le rêveur parle, sa voix ne touche pas la musique, ce serait du rock, mais nous sommes en méta-rock, alors l’accompagnement joue pour lui, la musique poursuit son rêve. Aucun des deux n’a besoin de l’autre. Iles subtiles. Encore un garçon : délire. Histoire d’un couple, quand il y a un garçon pas besoin de chercher il y a aussi souvent une fille, la musique gentillette, tout repose sur cette voix fuselée qui vous décrit la rencontre la plus habituelle comme si elle racontait une histoire d’extraterrestres… Un rêve de dreamer qui métamorphose la réalité en fiction interstellaire. Blue dream : il est des choses qu’il vaut mieux vivre dans sa tête, longuement, musique lente, y a comme un violon qui chantonne, de petits grésillements parce que parfois on s’accroche à un rêve comme à un clou. Rien de grave. Shake shake shake : retour à la chaude réalité, shake, rattle and roll, n’y a jamais eu mieux sur cette terre, le méta-rock se confond un peu trop avec le rock. Don’t let me go : le rêve en chair et en os s’échapperait-il, se terminerait-il, Bill Crane chante comme un vrai rockeur, sa guitare n’ose pas une distorsion stridente, mais elle sonne si bien que l’on sent que ça ne la gênerait pas. Cowboy space : ce coup-ci l’histoire se termine pour de vrai, le garçon remonte dans sa soucoupe volante et retourne dans l’espace de ses rêves. Au bout d’un moment, son engin disparaît brusquement et l’instrumental stoppe.
Un véritable space-opéra. Une face A : côté filles / Une face B : côté garçon. Cherchez le dindon de la farce. Cet album est un véritable bijou. Tout en finesse. Une histoire décalcomanique du rock’n’roll, amusez-vous à retrouver les morceaux qu’évoque chaque titre, et faites-vous la remarque qu’avec cet opus Bill Crane est parvenu à échapper cette nostalgie-rock dans laquelle baignaient tous les précédents. Preuve qu’il a réussi à atteindre l’essence du rock’n’roll.
Damie Chad.
*
J’aime les corbeaux. A priori je déteste ceux qui se vantent de les effrayer. Quoique la tâche me paraisse impossible, ne proviennent-ils pas des rivages immémoriaux et plutoniens, si je m’en rapporte à Edgar Poe, alors quand je vois qu’un groupe se prénomme Epouvantail, je hausse les épaules. D’abord ce n’est pas original, il existe une quinzaine de groupes qui ont choisi cette appellation. Je passe à autre chose, tiens des russes, cela pique ma curiosité, basés à Perm dans les monts Oural.
SCARECROW
III
(Ritual Sound / 13-11-2024)
Ce n’est pas leur premier disque. Celui-ci s’inscrit après Scarecrow, et II, numéroter ses propres opus sous-entend, telle est mon impression, soit que l’on est totalement dépourvu d’imagination, ou alors la solution que je leur attribue : que l’on prétend ériger une œuvre majeure. Parallèlement ils poursuivent un deuxième cycle, davantage dark side si l’on en juge d’après les titres : Noferatu, Ghost, Golem.
Pochette : dunes orange, nuages orange, quelques cumulus noirâtres, au loin un astre pallide, serait-ce la lune ou le soleil qui se meurt à l’horizon. Dans cette immensité désertique orangée, une forme humaine minuscule, serait-ce lui l’épouvantail, non l’on imagine un individu, peut-être le dernier de notre espèce, la plus nuisible de toutes. Cette image : The Saffron Skies est attribuée à Igor Odincov.

Artemis : Vocals, Oud, Clarinet, Flute, Piano, Percussion / Max : Guitars / Elijah : Bass Guitar, Core Bass / Vadim : Drums, Percussion / + Orza : Andrey : Percussion / Olga : Percussion.
The safran Skies Overture : (vidéo 1) : on croirait entendre une ouverture symphonique, très vite l’ambiance change, l’on quitte les rives occidentales pour les sablières orientales, l’oud c’est fou, l’on est partis, à méharis, à cheval, à pied, imaginez tout ce que vous désirez, faites-vous votre film, partez à l’aventure, quittez votre morne existence soyez Alexandre dans le désert d’ Gédrosie ou Lawrence d’Arabie vers Akaba, ayez des rêves plus grands que vous, leurs cendres vous survivront. The Hymn : (vidéo 2) : heavy metal en avant toute, Artémis entonne l’hymne de la grande partance, comment résister à ce timbre d’acier, il sait gémir à la manière de Robert Plant, sur ce genre d’exercice pas question de se planter, guitare oriflamme qui vole au vent, il a un nom de déesse, il le mérite, il ne vous encourage pas, il vous entraîne, que se lève la tempête rien ne l’arrête. Le monde sera à vous si vous suivez le soleil, si vous buvez sa force. Eastern nightmare : des bruits indistincts de foule, la basse d’Elijah titube, violents coups de vent d’oud, la voix d’Artémis n’est plus la même, douterait-il, le cauchemar que vous traversez aura-t-il besoin de vous, il ne cache pas la folie qui vous habite, sortilège, vous voici dans la ville, quelle est-elle, elle s’enroule autour de vous comme le serpent du charmeur, des arabesques de traîtrise vous assaillent, votre esprit vacille, vous ne savez plus où vous êtes, perdu en vous-même ou dans la ville du plaisir, ici tout est permis, des envolées et des retombées, l’or se change en plomb aussi vite que le plomb s’était mué en or, les tourbillons de l’instabilité mentale vous assaillent, êtes-vous dans un palais de marbre turgescent ou un agonisant dans les sables mouvants du désert, Artémis vous envoûte, vous le suivrez sur toutes les routes, vous croyez entendre la voix d’Oum Kalthoum.

The foe : (vidéo 3) : dans le cauchemar de votre marche, vous ne savez pas si vous avez rêvé de cette ville imprenable, maintenant vous savez, la musique lève les étendards de la guerre, pas de pitié, pas de quartier, que l’ennemi soit brave et se défende bien, chant de mort, de haine et de violence, Artémis vaticine et menace, il monte à l’assaut des murailles de pierre, la batterie rythme l’assaut, cavalcades de chevaux pour les razzias impitoyables, la ville tombe et succombe sous la trombe impitoyable. Rising sands : oud solitaire. Le soir tombe. C’est l’étape. Pas de repos, tout se passe dans les pensées. Les bras de l’épouvantail du heavy metal brasse le vent des souvenirs et le sable de la mémoire. Artémis lève la voix, elle semble prendre feu au brasier du froid du désert, elle ressuscite les fantômes dédaignés, tous ces palais, tous ces jardins que l’on a abandonnés, ce qui a été n’existe plus, le serpent de sa voix épouse l’amère réflexion des jours perdus à jamais, ce n'est pas la paix de l’âme… toutefois la halte bienfaitrice calme l’inquiétude des angoisses, une communion s’établit avec le vide du désert. Eternal ones : (vidéo 4) : le temps a passé. Les errants se sont arrêtés. Dans le silence de la nuit, le chant s’élève, l’instrumentation rase le sable du désert et l’herbe des oasis, ce n’est pas une prière adressée à un Dieu mais une élévation métaphysique, l’instant précis où l’on prend la mesure de ce que nous avons été et de ce que nous sommes. Nous sommes des errants, la terre est infinie. Elle nous appelle autant que nous la désirons. Maintenant nous savons que nous sommes les fils de notre destin, et que notre destin est immortel. Depuis toujours l’éternité marche à nos côtés. The turtle : (vidéo 5) : darkness du heavy metal, la voix d’Artémis vient de loin, les hommes passent et trépassent, les tortues se contentent de ramper insensibles à nos misères comme à nos exploits, tout ce à quoi nous avons cru s’effondre, les générations se succèdent sans que rien ne change jamais… la batterie trépigne et répépiège, le reste de l’orchestre vient à son secours, le pendule du destin se met en branle. Rien ne l’a jamais stoppé, rien ne l’arrêtera. Ce morceau possède la force nihiliste de l’Eclésiaste. The saffron skies : si vous pensiez que l’on a atteint le fond du désespoir… s’élève maintenant le dernier cri, celui du survivant qui a cru que la vie lui survivrait, un blues poignant et agonique, l’Ultime ne laissera pas de descendant. Autour de son cadavre même pas une tortue qui passe… Que sont l’espace et le temps lorsque le mouvement est mort. Sublime Artémis au chant, admirablement servi par sa formation.
Un véritable chef-d’œuvre de toute beauté.

Je suis beaucoup moins enthousiaste pour les vidéos, ils ont cru bien faire, ils ont voulu marquer le tout, parfois il est inutile d’en rajouter :
Vidéo 1 : une suite musicale de quinze minutes à savourer. Les paysages et les décors sont parfaits, je préfère écouter la bande-son en fermant les yeux, quant à l’histoire mise en scène par les acteurs qui sont les musiciens, je la trouve un peu inepte, il manque un véritable réalisateur, vous avez le droit de ne pas être d’accord avec mon jugement.
Vidéo 2 : Plaisir de voir les musiciens jouer, de temps en temps Artémis sur son cheval, s’amuse au guerrier avec une épée et un drapeau rouge frappé d’un corbeau noir. L’ensemble est agréable à voir.
Vidéo 3 : le groupe en train de jouer, quelques secondes est projetée derrière la scène le blason guerrier de The Foe. Le reste du temps sur la gauche de l’écran s’affiche discrètement un fragment de l’image.
Vidéo 4 : sans surprise, le morceau est mis en images, assez sobrement, point de scénario grandiloquent.
Vidéo 5 : les musicos oui mais derrière eux, cette tortue géante en surimpression un peu lourdingue… Disons superfétatoire pour ne vexer personne. En filigrane aussi des images d’évènements et de guerres du siècle passé, serait-ce une manière d’inciter à considérer les turpitudes guerroyantes actuelles d’une manière un peu plus philosophique…
Damie Chad.