KR'TNT !
KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 571
A ROCKLIT PRODUCTION
SINCE 2009
FB : KR’TNT KR’TNT
20 / 10 / 2022
BUTTHOLE SURFERS / DARTS
URGE OVERKILL / EIGHTIES MATCHBOX B-LINE DISASTER
GEESHIE WILEY & ELVIE THOMAS
ROCKAMBOLESQUES
Sur ce site : livraisons 318 – 571
Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :
http ://krtnt.hautetfort.com
Les Surfers ont pris de la Butthole
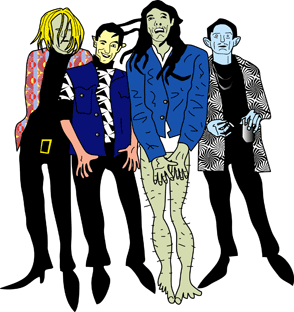
Oh comme il a raison Ben Graham de s’extasier sur les Butthole Surfers ! Il le fait dans le cadre d’un petit book paru récemment et pas facile à trouver, Scatological Alchemy: A Gnostic Biography Of The Butthole Surfers. Remarquablement bien écrit, on voit très vite que c’est un book de fan, car il sait communiquer son enthousiasme. Certaines pages vibrent pour de vrai. Graham qui est cultivé se paye le luxe d’ancrer l’histoire des Butthole dans Dada, mais il fait surtout l’apologie du Texas rock psychédélique et des drogues. L’histoire des Butthole préfigure celle de Fat White Family, avec le même goût du chaos, mais la différence avec les Fat White, c’est que les Butthole ont enregistré d’excellents albums.
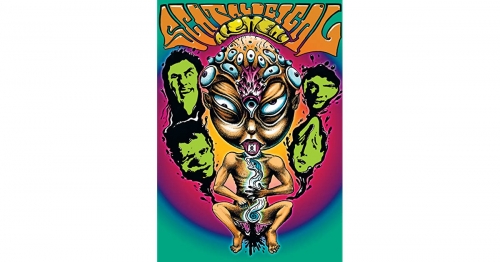
«Les Butthole Surfers sont arrivés du Texas comme une tornade de brutal, ugly noise, surrealist free association, sick humour and rampant, anti-establishment chaos qui a ruiné des pans entiers de l’histoire du rock.» Graham démarre en trombe avec cette métaphore d’une justesse magistrale. «On les considérait à l’origine comme un groupe punk, mais ils étaient surtout la suite du acid-driven mouvement psychédélique qui avait connu son âge d’or dix ans auparavant.» Graham évoque bien sûr le 13th Floor. Et c’est là qu’il se fend de son couplet Dada. Il rappelle que Dada s’est formé en réaction contre la boucherie de la Première Guerre Mondiale - plus précisément contre les forces qui ont sous-tendu cette guerre, le conformisme bourgeois, la culture mainstream, la pensée rationnelle, les lieux communs, la moralité et les structures sociales, politiques et économiques. Pour lutter contre ces monolithes, Dada a utilisé des actes irrationnels, des déclarations et des comportements volontairement choquants, du non-sens, des clowneries, de la provocation, de la satire et de la magie. Les idées de Dada furent un peu plus tard formalisées et commercialisées par les Surréalistes. Si Dada était punk, alors le surréalisme était la new wave. D’ailleurs, le mouvement punk fut perçu comme une résurgence de the original Dada spirit, comme l’indique Greil Marcus dans Lipstick Traces - Voilà, on t’avait prévenu, Graham et un bon. Il te permet en plus de réviser tes leçons. Il enfonce son clou en affirmant que les Butthole ont ramené the Dada elements of punk dans leur époque, out in the open - Ils se limitaient à choquer et à provoquer, car ils n’étaient pas vraiment doués musicalement, ils jouaient fort et braillaient des textes insultants, ce qui était aussi le cas de beaucoup de groupes punk, mais les Butthole savaient aussi se montrer ridicules, ils étaient souvent à poil, ou couverts de vêtements, ils chiaient et pissaient sur scène - et dans son élan, Graham s’en va chercher Easy Rider : «This was absolute freedom, the American dream taken to its furthest frontier. Mais comme le dit Jack Nicholson dans Easy Rider, parler de liberté est une chose, montrer aux gens ce qu’est la vraie liberté en est une autre, ça leur fout la trouille et ils peuvent devenir dangereux.» Et Graham s’enflamme en affirmant que Paul Leary was one of the most innovative guitar players of his generation.

( Butthole Surfers / 1987 / from Burns' Book - voir plus loin )
Tout ça dans les six premières pages. Tu sentais confusément que les Butthole étaient un gros truc, et Graham t’éclaire la lanterne. Il parle d’alchimie scatologique : «They have turned shit into gold.» Oh et puis il y a le Texas et sa mythologie d’absolute independance by any means necessary, il évoque the special place in psychedelic history, et cite les Elevators, Golden Dawn, Zakary Thaks, the Lost And Found, tous ces gens harcelés par les flics et les rednecks, mais c’est parce qu’ils étaient harcelés qu’ils sont devenus ce qu’ils sont devenus, ça les a durcis, ça a durci leur son, «so that Texan psyschedelia became characterised by a snotty, kick-ass punk element, d’autant plus que tout ça trempait dans une authentic acid experience» - Le culte des Elevators continua de grossir après leur disparition, mais si un groupe a réussi à maintenir le spirit of Texan psychedelia au long des fucking années Reagan, c’est bien les Butthole Surfers - Les Butthole montent sur scène sous acide, comme les Elavators, Gibby se fout à poil et simule une partie de cul avec Kathleen, Aka Ta-dah The Shit Lady - The Butthole se sont jetés dans les flammes, à la scène comme à la ville, dans leur musique comme dans leur vie, ils sont allés jusqu’au bord de l’abîme. They were America’s last great psychedelic band. Ils sont allés plus loin que les Elevators, Jimi Hendrix, l’Airplane, le Dead, le Velvet ou tout autre ‘out-there’ sixties group qui puisse venir à l’esprit - À l’époque où ils débutent, ils croisent d’autres groupes devenus légendaires : les Big Boys de Tim Kerr, Stickmen With Rayguns et the Hugh Beaumont Experience - Fort Worth’s infamous teen punk band the Hugh Beaumont Experience - dont fait partie un futur Butthole, King Coffey, lequel King partage avec Gibby et Paul un goût prononcé pour le punk-rock, l’art et les drogues psychédéliques. Gibby et Paul sont particulièrement impressionnés par sa façon de jouer de la batterie debout. Ce sont surtout les Big Boys qui mènent le bal de la scène locale, ils considèrent les Butthole comme their little brothers, nous dit Burns, de la même façon que le MC5 considérait les Stooges comme leur baby band. Burns évoque aussi the spaced out alien locks of guitarist Tim Kerr.

L’histoire des Butthole se met en route sous nos yeux globuleux, autour du duo Gibby/Paul Leary. King Coffey bat le beurre. Comme ils sont devenus potes avec Jello Biafra, leur premier EP sort sur Alternative Tentacles en 1983. Cet EP sans titre sera retitré un peu plus tard Brown Reason To Live, va-t-en savoir pourquoi. Ils optent aussitôt pour le freak-out extrémiste et c’est insupportable. Toute l’A est mauvaise, presque post-punk, mal chantée, pas sexy. Graham parle de some kind of All-American Satanic ritual. Il faut attendre «Wichita Cathedral» en B pour se régaler d’un excellent bim bam boom de Butthole. C’est leur vision du stomp, monté sur un bassmatic bien rebondi. Et ça se termine avec «The Revenge Of Anus Presley», the concentrated fatty essence of deep-fried southern rock’n’roll.
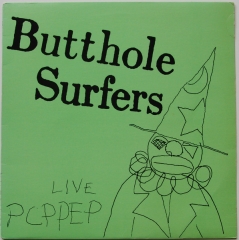
Un an plus tard, ils récidivent avec un autre EP, Live PCPPEP. Même bordel, c’est confus et privé d’avenir. Ils font du trashy-trasho à la ciboulette, enfin on peut appeler ce bordel comme on veut. On retrouve «Wichita Cathedral» qu’ils attaquent à la heavyness parégorique. Ces mecs ramènent du son comme d’autres ramènent leur fraise. Mais c’est tout ce qu’on peut dire de cet EP vert.
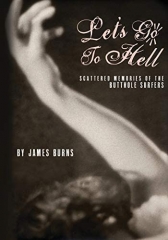
Il existe un deuxième Butthole book, beaucoup plus fouillé : Let’s Go To Hell: Scattered Memories Of The Butthole Surfers. On doit ce gros pavé de 500 pages à James Burns, le bien nommé. Il n’est pas aussi intense que Ben Graham, mais son pavé complémente bien ce petit chef-d’œuvre qu’est Scatological Alchemy. Burns fait intervenir directement les principaux acteurs de cette épopée, et ça donne une sorte d’oral history. Comme Graham, Burns est un fan de la première heure. Il rappelle que the touring ethic des Butthole n’avait aucun équivalent - même pas les Minutemen qui jouaient 50 shows en 50 jours, mais qui rentraient chez eux après la tournée. Les Butthole n’avaient pas de maison et vivaient dans leur bagnole.
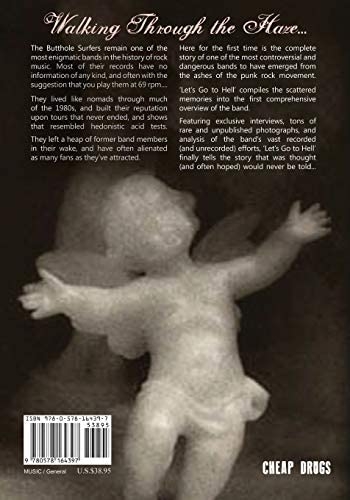
En 1984, ils s’embarquent à bord du Chevy Nova de Terence Smart pour une tournée à travers les États-Unis qui va durer trois ans. Ils ont viré la banquette arrière, de sorte qu’on puisse dormir à l’arrière. Les instrus et le matériel sont dans une remorque. Ils ont peint ‘Ladykiller’ sur le côté et attaché du fil barbelé sur le pare-choc avant. Teresa qui vient de rejoindre le groupe indique que la virée a duré trois ans - We never came back to Austin - Teresa lavait la vaisselle at the Peacan Street café et quand elle rencontre les Butthole, elle les prend pour des rock stars parce qu’ils connaissent Jello Biafra. Ils embauchent Teresa comme deuxième batteuse, «like the Grateful Dead, the Allman Bros, or the JBs», nous dit Burns qui lui aussi s’enflamme : «The rhythm section became like a steamroller. They took Killing Joke, the Velvet Underground, Wire and the Jimi Hendrix Experience together and interwined them like the roots of a banyan tree.» C’est exactement ce qu’on voit dans le Butthole DVD, Blind Eye Sees All. Live In Detroit 1985. Teresa et King Coffey sont un vrai pilon des forges. Et Burns recrame de plus belle : «Pendant la plus grande partie des années 80, les Butthole Surfers furent sur la route, prenant des acides pour rester éveillés pendant les marathons de 3000 miles d’une côte du pays à l’autre, vivant dans un van pendant trois ans, sans domicile, ni relations sentimentales, ni argent.» Ils trouvent le temps de passer un accord tacite avec Touch & Go, un label indé de Chicago, sur lequel paraît leur premier album, Psychic Powerless Another Man’s Sac.

Ils optent pour un parti-pris graphique sans merci : les pochettes sont encore plus libres que leur son. Dès «Concubine», ils renouent avec leurs vieux bon côtés. Ils disposent de ce qu’on appelle the natural heavyness. Ils commencent d’ailleurs à cultiver leur réputation de groupe culte, grâce à leur goût du foutraque. Comme c’est du foutraque texan, ça plaît en Europe. Les cuts hirsutes se succèdent, mais Paul Leary est toujours intéressant. Graham indique qu’ils singent le «surf-gothic hardcore punk des Dead Kennedys». Il parle aussi d’«early eighties electro-pop gone horribly wrong» et d’«hideous vocoder abuse». Il qualifie aussi «Woly Boly» de «psychobilly chicken dancing number qui assimilerait le son des Cramps et de Brithday Party, and dragging back to Captain Beefheart territory» - Leary’s twisted guitar part is certainly worthy of either Roland S Howard or Zoot Horn Rollo - Dommage que la voix de Gibby Haynes ne soit pas bonne. Il chante faux la plupart du temps. Quand ils font du post-punk mal chanté, comme dans «Negro Observer», on perd patience. On croit entendre l’un de ces atroces groupes gothiques anglais. En B, ils optent pour la provocation et dans le redneck cowboy fuzz-stomp de «Lady Sniff», ils pètent, ils dégueulent, ils crachent, ils font tout ce qu’il faut pour choquer le bourgeois. On assiste plus loin à une belle déclaration d’hostilité avec un «Mexican Caravan» joué ventre à terre - fractured take on the Damned’s «Neat Neat Neat» - et Paul Leary freine des quatre fers, mais de manière acrobatique. Il fait encore la pluie et le beau temps dans ce heavy doom de cul de basse fosse qu’est «Cowboy Bob» - «Cowboy Bob» kicks in like Hawkwind’s «Brainstorm», with Lemmyesque bass and sax blurts of Nik Turner, all flanged vocals and headbanging downer psychedelia - Quand ça sonne bien au chant, c’est Leary qui chante, «and turns in a classic garage-psych guitar solo.» Graham qualifie cet album de freaky party record. Burns rappelle que les photo recto et verso de pochette sont signées Michael Macioce, un photographe rencontré à New York. C’est Paul Leary qui flashe sur celle du verso, Cherub the angel.

Sur scène, les Butthole deviennent une sorte de Cecil B DeMille apocalypse. Dans le NME, on les décrit ainsi : «Beefheart, the Virgin Prunes, Residents, Dead Kennedys, Hawkwind and the Mothers of Invention all naked and rolling around in a bestial orgy.» Sur scène, Gibby enfile dix robes qu’il arrache une par une pour finir à poil. Dans son book, Graham collectionne les détails de tous les excès scéniques, notamment à l’époque où Kathleen danse sur scène avec le groupe. Mais leur point faible sera toujours le bassiste : fatigué de la pauvreté, de la malnutrition et des excès, Terence Smart quitte le groupe en 1985, après un concert à Atlanta. Comme Graham, Burns parle de la création d’un monster - The monster is us: it is sex, death, drugs, life, lies, neuroses and politics. Not the politics of government, but the politics of the mind.
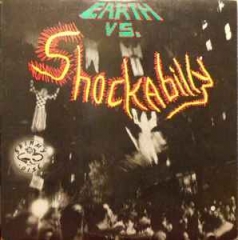
En 1985, Mark Kramer de Shockabilly rejoint les Butthole. Burns rappelle que Shockabilly était avec Sonic Youth «among the biggest bands in the New York scene». Eugene Chadbourne qui est le guitariste de Shockabilly est par la suite devenu assez culte. Mais Kramer n’en peut plus de voir Chadbourne vendre ses K7 après les concerts de Shockabilly et il finit par lui dire to go fuck himself. Chadbourne ne pensait qu’au blé - He’d become a fisrt class prick, and a completely fucking miserable human being. Après son passage dans les Butthole, Kramer va monter Bongwater, son studio et son label, Shimmy Disc Records, spécialisé dans la «Downtown scene», les groupes les plus connus étant Galaxie 500, Ween et King Missile. Quand Kramer quitte le groupe, Teresa qui est épuisée rentre aussi chez ses parents. Les Butthole se retrouvent à trois. King : «C’était dur et nous n’étions pas des gens faciles à vivre, il faut bien le reconnaître.» Tout s’arrange avec l’embauche de Jeff Pinkus, un bassman qui comme eux adore jammer sur Sabbath et Blue Cheer. Pour Burns Pinkus est le bassman qui a le plus contribué au son et à l’image des Butthole. «Bill Jolly avait rendu le groupe célèbre au Texas, et grâce à Terence Smart, le groupe est parti en tournée à travers le pays. But Jeff brought them up from the street and out into the cosmos.»
The «on-stage sex show» avec Kathleen continue. Burns : «The show cemented their reputation as the most dangerous touring band in existence.» Plus de lois ni de règles, ils avaient créé les leurs. Une certaine Kabbage se joint à eux comme deuxième batteuse, en remplacement de Teresa, mais elle bat tous les records de puanteur, au point que les Butthole finissent par s’en débarrasser en la déposant à un arrêt d’autobus. Ils poursuivent nous dit Burns leur «never ending coast to coast death race». Quand tous les groupes célèbres à l’époque, Jane’s Addiction, Pixies et Red Hot Chilli Peppers, ramassent des tonnes de blé et s’achètent des voitures, les Butthole continuent de tirer la langue et mettre leurs sous de côté pour enregistrer. Teresa : «Le seul moyen que nous avions de continuer à enregistrer était de ne pas nous payer.» Les Butthole ne vivaient que des concerts. Le seul choix qu’ils avaient nous dit Burns était «entre ne pas tourner et ne pas manger, ou tourner et ne pas dormir». Burns dresse un étrange parallèle entre les Cramps et les Butthole - The Cramps, one of the few bands who could actually rival the Butthole on stage - Alors que pendant 15 ans, les Cramps ont développé their own psychotic hillbilly beach parties, les Butthole cultivaient de leur côté le full blown freakout et veillaient à ramener sur scène toute l’insanité du monde. En 1988, les Butthole jouent en première partie des Cramps à Washington D.C.
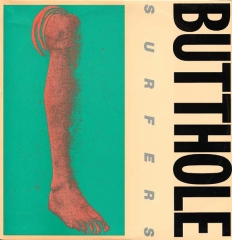
Dada pointe le museau sur Rembrandt Pussyhorse paru en 1986. Oui, Tzara aurait adoré «Waiting For Jimi To Hide», car c’est du vrai Dada d’entre-deux, comme ça en passant. Pas mal, le Dada texan, en tous les cas, ils s’amusent bien. Graham : «Avec Rembrandt Pussyhorse les Butthole on trouvé leur son : a dark, compelling mixture of psychedelia, avant-garde noise rock and a sick, surreal sense of humour.» On trouve aussi une belle bourrache de stomp sur l’astonishing deconstruction of «American Woman». Les Butthole se montrent capables de ramener énormément de son, ils se fendent ici d’un big beat indus, le vrai beat des forges du Creusot, avec la vapeur et les murs qui tremblent. En B, on devra se contenter de «Perry», un freak-out monté sur un riff envahisseur. Power & Texas blast. Mais tout le reste est à jeter. Graham : «Rembrandt Pussyhorse est un album extrêmement sombre et torturé qu’il ne faut pas écouter en conduisant. Ni en prenant des drogues hallucinogènes, sauf si vous êtes le genre de maso qui apprécie cette espèce de fucked-up fun. Comme le dit le proverbe : in your head be it.»

Les Butthole continuent de se montrer avares d’infos avec la pochette de Locust Abortion Technician. Contentons-nous de savoir que les clowns sont peints par Arthur Sarnoff. Mais c’est avec cet album qu’ils montrent enfin leur vrai visage. Gaham dit qu’il s’agit du meilleur album des Butthole - Their heaviest and most extreme - Et il ajoute, le souffle court : «Ce n’est ni du punk, ni du goth, ni de l’indus ou du heavy metal, mais leur son intègre ces éléments. This is the Butthole Surfers in full-on acid psychosis mode, qui ne ressemble à rien de ce qui existait avant, et que peu de gens ont osé approcher depuis.» Les Butthole commencent à émerger en tant que rois du heavy sound, et ce dès la cover de «Sweat Loaf», tiré du Master Of Reality de Sabbath - Les Butthole attrapent un couteau de cuisine rouillé pour vous ouvrir sur le front le troisième œil. Look ! See the horror ! - Dans les années 80, Sabbath n’était plus en odeur de sainteté, mais nous dit Graham, les Butthole reconnaissaient en eux the very primal ooze of rock et savaient que la stupidité constituait son essence autant que l’énergie ou the darkness - La heavyness ne leur fait pas peur. C’est même leur péché mignon. On commence alors à les prendre au sérieux. «Pittsburg To Lebanon» sonne comme un chef-d’œuvre de heavy blues joué au raw texan. Cette immense merveille de gras double s’étend jusqu’à l’horizon. En B, ils font du trash-punk avec «The O-Men» - Pure Texas psychedelia, lost in a bad trip on too much peyote and trucker speed - Ils ne reculent devant aucun excès, c’est d’ailleurs ce qui fait leur grandeur. On croirait entendre du trash-dada tellement c’est audacieux, avec cette voix de va-pas-bien. S’ensuit un petit délire d’exotica asiatique nommé «Kuntz». Voilà, c’est à peu près tout ce qu’on pourra se mettre sous la dent. Quatre cuts, c’est déjà pas mal. Graham qui n’en finit plus de loucher sur Paul Leary ajoute qu’il ramène la même énergie qu’Hendrix dans «Star-Spangled Banner» ou Eddie Hazel dans «Maggot Brain». Selon Burns, Locust est devenu l’archétype de l’album qu’on fait comme on a envie de le faire, sans aucun objectif commercial et sans craindre de perdre des fans - On their own terms, dit Burns. Il ne s’arrête pas là, le Burns. Pour lui, Locust est un big FUCK YOU adressé au mainstream rock. Et alors que des groupes comme Devo, Throbbing Gristle, les Residents et Pere Ubu s’engagent dans des voies obscures qu‘on qualifie de punk ou de post-punk parce qu’on ne sait pas comment les qualifier, les Butthole renouent avec le rock des seventies.

C’est l’époque où Kathleen danse sur scène avec le groupe. Elle tourne donc avec eux. Ils passent vingt heures par jour dans le van et comme elle est anti-hygiène, elle dégage une drôle d’odeur. Elle ne se lave jamais, elle adore la merde et la pisse et tout ce qui peut sortir du corps. Quand les autres Buttholes chopent des morpions, elle les adopte comme des animaux domestiques. Kathleen avait bossé dans un peepshow de Times Square et une nuit, alors qu’elle avait chopé un virus intestinal, elle arrosa accidentellement le mur de merde. D’où son surnom de Ta-Dah the Shit Lady. Sur scène, elle danse à poil, comme Stacia le fit au temps d’Hawkwind. Alors forcément, les salles de concert se remplissent.

Génial ! Aucune info sur la copie Touch And Go d’Hairway To Steven qui est ici. Ni les titres des cuts, ni les noms des gens. Les seuls indices sont des petits crobards sur les rondelles des labels. Si on observe attentivement les petits personnages et les animaux, on voit qu’ils chient. Les Butthole cultivent des obsessions scatologiques. Après enquête sur Discogs, on découvre que le long cut d’ouverture de bal d’A s’appelle «Jimi». Alors attention, car c’est piétiné dans l’épaisseur du pire blues rock texan, on a là une vraie pulsation antique, ils jouent avec brutalité et donc c’est vite grandiose. Ça vaut tout Killing Joke. Les Butthole ont du génie et leur génie consiste à s’éloigner des voies conventionnelles du rock pour tenter l’aventure de l’avant-garde. Ils allument plus que tous les géants du blues-rock réunis, ils découvrent des territoires inexplorés. On tient là l’un des disques les plus édifiants de cette époque. Ils tâtent de la folie, souvenez-vous brothers & sisters que la folie est l’essence même du rock. Il y a dans «Jimi» tout le power de «Sister Ray» et de «Death Party», le Velvet et le Gun Club se mélangent à la crazyness texane - Some of Paul Leary’s most demented guitar playing - Avec «Ricky», on voit qu’ils savent gratter des poux et ils terminent cet effarant balda avec «I Saw An X-Ray Of A Girl Passing Gas» qui frise les Fugs dans le côté hargneux et pouilleux. C’est tellement chargé de son qu’on s’en épate. Gibby Haynes rajoute des maniérismes anglais dans le chant et un violon renvoie directement à Family. Ils attaquent leur bal de B avec du Dada texan, le plus incongru qui soit. Le cut s’appelle «John E. Smoke» et bat les Godz à la course. Ils racontent l’histoire de John E. Smoke avec de l’Americana schtroumphée et mine de rien, ils blastent leur son en déconnant. Ils font du pur Joujouka avec «Rocky» qui fut composé pour Roky Erickson, mais celui-ci refusa de l’interpréter, nous dit Graham. Puis ils font du rockab psychédélique avec «Julio Eclesias». Ils montrent une stupéfiante aisance à mixer les genres et là, ce démon de Paul Leary passe un solo de jazz guitar, avec ce débridé énergétique qui caractérise le freak-out texan. En fait c’est le même élan vital que celui du 13th Floor. Ah il faut entendre cette machine rockab derrière et ces fabuleux coups de starter en cours de route. Encore du heavy as hell avec «Backass». Ils visent cette fois le heavy psyché anglais. Diable, comme leur mad psyché peut être belle, elle vaut tout l’or du monde, bien crazy, bien déjantée. Ils terminent en mode wild gaga avec un truc qu’ils appellent «Fast Song». Paul Leary joue comme un desperado.

En 1988, les Butthole ont en marre de la bohème et s’installent dans une ferme, à quarante bornes d’Austin. Tous sauf King Coffey qui préfère rester en ville. Épuisée, Teresa a quitté le groupe pour rentrer chez ses parents. On la voit, Teresa dans Slackers, un film underground texan. Elle apparaît dans une scène et se lance dans un monologue psychotique sur Madonna. Elle porte une casquette noire et des lunettes noires. C’est un plan très bizarre.
Après le départ définitif de Teresa, les Butthole deviennent nous dit Burns «a solid rock freak out. Not the sloppy lo-fi southern-fried punk of their early days, nor the experimental art damaged drug orgy of yesteryear, but a more firespitting comet of hardcore psychedelic rock, shooting across the intergalactic space somewhere between Hawkwind’s «Motorhead», Blue Cheer’s «Second Time Around» and Steppenwolf’s «Foggy Mental Breakdown». Bien vu Burns ! Il ajoute plus loin qu’aucun groupe ne peut survivre pendant dix ans à ce niveau de madness, même pas les Butthole qui l’ont pourtant fait plus longtemps que n’importe quel autre groupe - Que ce soit par choix ou par nécessité, on ne peut que les honorer d’avoir été the most dedicated band in the history of Texas Rock’n’Roll. Et c’est là qu’ils décrochent un contrat chez Rough Trade, avec $100,000 à la clé.

Leur meilleur album paraît en 1991 et s’appelle Piouhgd. Imprononçable. Il faut comprendre «pee-oh-d», c’est-à-dire pissed-off. Au dos de la pochette, un graphiste a bricolé leurs photos. On était alors à l’aube de l’ère Photoshop et c’est vrai qu’en découvrant les outils, on pouvait parfois bien s’amuser. La déformation des visages donnait parfois des résultats intéressants. Cet album grouille de heavy stuff et dès «Revolution Part 1» et le Part 2 qui suit, Paul Leary se paye une fantastique partie de gras double de stoner rock jam. Il travaille la lancinance au corps, il dispose d’un beat solide. C’est encore du blues rock Dada, ils gueulent des prénoms et ça bascule dans la transe de la prescience - Gary Gary ! - Le chant entre en perdition d’acid freak-out. Ils font plus loin une excellente cover d’«Hurdy Gurdy Man», idéale pour un trip texan. C’est Paul Leary qui chante «in dislocated fashion, while his guitar solo dips and cuts like a shell-shocked gravedigger decomposing in the acid rain, or limps across the ultra-violet sky like a haemorrhaging seagull.» Retour au heavy Texas blast en B avec «Blindman». Aw my Gawd, comme ces mecs sont bons, comme ils poussent bien leur bouchon dans le gras du blues, ils culminent dans les virages, ils rivalisent d’ardeur avec Mountain et sortent le grand jeu du freak-out à la Cactus - A classic Butthole grind, Stooges and Cramps influenced hard rock with unintelligible vocals that speed up nightmarishly - On croit entendre les Mary Chain avec «Something». Même son, même beat, même écho. Symbiose parfaite, Paul Leary peut sortir le grand jeu comme William Reid. Retour à la mad psyché texane avec «Psy», ils ramènent tout le lard de la matière, leur blast foisonne, ils multiplient les plongées histrioniques dans les nuages de bassmatic et de blasting booms. C’est l’un des plus spectaculaires freak-outs de l’histoire du rock. Graham : «Don’t write off Piouhgd as a mess. Okay it is a mess, but it’s a glorious one. And the Butthole Surfers never claimed to be consistent afeter all.»

Et puis on tombe sur le chapitre qui s’appelle ‘Clean Up’. En 1991, les Butthole s’assagissent. Ils ont un peu de blé et participent à Lollapaloooza, un concept de festival imaginé par Perry Farrell en hommage à son groupe, Jane’s Addiction, et à tous les groupes qui les ont influencés, à commencer par les Butthole - Perry had just the vision, and ego, to pull it off - Paul Leary : «C’est la première fois qu’on n’avait pas à conduire notre van, à installer nos amplis, à accorder nos guitares et à réclamer notre blé. Comme on avait les mains libres, on pouvait se défoncer un peu plus.» Projet risqué, Lollapaloooza est un succès et devient au fil des ans le vivier dans lequel viennent pêcher tous les gros labels : l’underground devient à la mode. Un mois après le premier Lollapaloooza, Geffen sort le Nevermind de Nirvana. Le rock connaît alors sa dernière révolution. C’est grâce à Lollapaloooza que les Butthole décrochent un contrat chez Capitol.

Comme ils ramassent un peu de blé, ils abandonnent le mode de vie en collectivité pour essayer de vivre comme des «gens normaux». Paul Leary va même jusqu’à se marier ! Gibby et Jeff Pinkus s’installent eux aussi dans des baraques. King Coffey profite de son blé pour monter son label, Trance Syndicate. Paul Leary enregistre son premier album solo la même année. L’album s’appelle The History Of Dogs. Graham le compare à l’Automatic des Mary Chain et à Vision Things des Sisters Of Mercy. Il y trouve aussi un «metronomic take on Texas boogie that ZZ Top trademarked on 1983’s Eliminator.» Il parle encore d’un «oblique, hermetic solo statement». C’est on s’en doute un album somptueux. «Apollo One» sonne tout simplement comme une course vers l’avenir du rock. Paul Leary devient féroce, il fait gerber un punk-rock liquide comme une diarrhée, il chante sa diarrhée au liquide pur. Ce mec a du génie. Bienvenue dans la modernité, il fit rimer Dada avec fracas, c’est exceptionnel. Il repart au chant liquide avec «Dalhart Down The Road». Il a tout compris, il fait du punk-blues organique, du Texas romp diarrhéïque, le solo est un chef-d’œuvre de dégueulis d’overdose, merci Paul, pas de pire folie, pas de pire déviance d’esprit rock, c’est digne de Roky. Il revient à la petite couture à deux voix pour «How Much Longer», il est têtu, il insiste, il joue contre vents et marées, il est en avance sur tout le monde, même sur Tim Presley et John Dwyer. Graham a raison de citer les Mary Chain car les voilà dans «He’s Working Overtime» : même vent de folie, Leary est au cœur de la tourmente, même sens du génie sonique, avec la basse qui traverse la tempête, Mary Chain, oui, but the Texas way, baby. Il ramène les tambours de guerre indiens dans «Indians Storm The Government», c’est un rêve qu’il met en musique, il tape ça au délire Butthole, il s’y connaît en tambours de guerre. Paul Leary est un mec extrêmement aventureux. Il va chercher ses trucs et il les nourrit. Il est excellent, surtout quand il devient excentrique («Too Many People»). Encore un cut de rêve avec «The City», perdu dans l’azur de Leary, il cloue son couvercle au ciel avec de coups de basse lourde. Et il finit en heavy beauté avec «Fine Home».
Pendant ce temps, Gibby enregistre «Jesus Built My Hotrod» avec Al Jourgensen et profite de l’occasion pour passer à l’héro - When he left the Ministry enclave in Chicago, he slipped into smoking crack and doing heroin all the time.

Ils décident d’arrêter de tourner pendant un an et enregistrent Independant Worm Saloon avec John Paul Jones. Les sessions durent deux mois - Gibby dit de John Paul Jones qu’il était un horrible drunk but we were loaded too. On a dépensé tellement de blé sur cet album. We basically spent a fortune to hang out with some guy from Led Zeppelin - Comme ils sont sur Capitol, pas de problème. L’amateur de Dada trouvera encore son bonheur sur Independant Worm Saloon, paru en 1993. Oh pas grand-chose, juste «The Annoying Song» en B. Mais c’est un joli stomp Dada en tous les cas. Ils ont la main lourde sur le beat et d’excellentes tendances à la marée. «Who Was In My Room Last Night?» donne le ton - the long standing love with Black Sabbath - et Graham parle de «gonzo rock workouts with monomaniacal, robotic rhythm section and barely intelligible, gibbering lunatic vocals.» Il ajoute que c’est «du punk et du métal à leur plus petit commun dénominateur and retooled with military-strength hardware. Mais ça marche, comme c’est souvent le cas, the results are exhilarating and irresistible fun.» On trouvera aussi une belle cavalcade en A. Elle s’appelle «Dog Inside Your Body». Guitar God joue ça en retenue au bord du coït. Oui, Paul Leary mérite bien qu’on l’appelle Guitar God. Fantastique aisance de l’appétence, il sait riffer un beignet dans le sens du poil et barder un barda bersek. Guitar God is on fire. Encore une vraie dégelée royale d’impénitence dans «Goofy’s Concern» et «Alcohol» tombe à pic pour nous rappeler à leur bon souvenir et à leur sens aigu de la heavyness. Ils se situent vraiment au-delà de tout. On retrouve la main lourde de Guitar God en B dans «Dust Devil». Il multiplie les coups de vrille, dommage que la voix de Gibby Haynes soit si ingrate. En fait, ils sonnent comme Pere Ubu. Mais leur équation fonctionne : Guitar God + heavy beat = Butthole magick. Ils repartent en mode ventre à terre avec «Leave Me Alone». Ils adorent les rasades de cavalcade. Il reste encore un beau morceau à se mettre sous la dent : «Edgar». C’est un véritable festival traversé par des pointes de bassmatic. Les Butthole sont les rois de la densité atmosphérique. Graham s’amourache de «Dancing Fool», «a Paul Leary tour de force, the guitarist hollering ‘dance like cancer’ and ‘Fuck you I’m the dancing fool!», over a veritable autobahn of punishing Wagnerian Panzer attack guitars, remorseless and unstoppable.» L’album dit encore Graham s’achève avec «an all-time Butthole Surfers freak-out classic, «the near-nine minutes of «Clean It Up». Les auditeurs capables de supporter les deux premières minutes de vomissements et de bowel-twitching bass sont ensuite catapultés dans un stupéfiant duel de guitares qui oppose Paul Leary et Helios Creed de Chrome, leurs notes hurlantes reverberate across the rhythm section’s apocalyptic black hole rumble. Il est bien certain que ce n’est pas le son d’un groupe qui a vendu son cul et qui s’est rangé des voitures. Rien de ce qui paraît sur un gros label dans les années 90 n’est aussi far out et psychédélique que ce track.» Pour Burns, les Butthole d’Independant Worm Saloon sont le 4 piece band in full glory. Ils ont même assez de cuts pour remplir un double album.
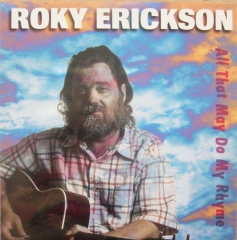
C’est là que Jeff Pinkus quitte le groupe. Gibby quant à lui frôle la mort en permanence. Il va en detox à Los Angeles et se retrouve dans la même chambre que Kurt Cobain. Gibby est l’un des derniers à avoir vu Cobain vivant : le 31 mars 1994, Kurt s’évade du centre de detox et on le retrouve mort huit jours plus tard avec une balle dans le crâne. Dans son coin, King Coffey ne chôme pas. Il est devenu pote avec Roky et sort son label Trance Syndicate l’excellent All That May Do My Rhyme. Paul Leary joue sur trois des cuts de l’album - Roky nous dit Graham is one of the few characters who could out-weird the Butthole Surfers - Roky arrive en studio avec un chapeau en papier alu. L’ingé-son lui demande pourquoi il porte un tel chapeau et Roky dit que c’est pour le protéger des rayons. Comme l’ingé-son lui dit que le studio est isolé, Roky enlève son chapeau.
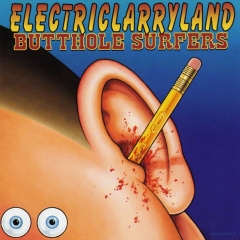
Paru en 1996, Electriclarryland est un faux double album, une sorte de clin d’œil à Electric Ladyland sur trois faces. Ils enregistrent l’album avec le producteur Steve Thompson dans le studio de Todd Rundgren à Bearsville, dans l’État de New-York. Pour Graham, c’est encore un big album, leur meilleur depuis Locust Abortion Technician, mais dans un genre radicalement différent. Deux énormités se nichent en A : «Birds» et «Thermador». C’est un heavy beat texan monté sur bassmatic proéminent. Du gâtö pour Guitar God. Ce sens du pounding redore le blason les Butthole. C’est avec ces heavy cuts qu’ils donnent leur vraie mesure. Ils étendent leur règne et ne font pas de détail avec ce heavy beat déclamatoire, seul compte le poids du beat et la transversalité du bassmatic. Ils sont fantastiques. Avec ce «genuine Texan psych classic» qu’est «Pepper», Graham nous dit qu’ils documentent «the dark side of the druggy counter-culture in the true 13th Floor Elevators tradition». Encore une belle énormité en B : «Ulcer Breakout», c’est pulsé comme il faut, Guitar God est en furie et il dévaste tout. Avec «Ah Ha», Gibby Haynes fait son Crocus Behemot, il va chercher la petite démesure avec la même pugnacité des cités. Mais c’est avec la C que l’affaire se corse. Ils opèrent un gigantesque retour à la psychedelia texane avec «The Lord Is A Monkey». C’est exactement ce qu’on attend d’eux. Guitar God entre dans la danse à coups de wah excédée et envoie de fabuleux shoots d’excelsior patibulaire. Ils montent «Let’s Talk About Cars» sur un dialogue français. Elle parle d’une voix intime - Chuis d’accord, les films français sont plus lents que les films américains - et elle rit. Encore un shoot de Pere Ubu avec «LA», même pataquès et ça se termine en mode mad psychedelia avec «Space» et tout le power des Butthole. C’est monstrueusement bon. Graham : «Electriclarryland is an album about death, loss of faith and drugs - specifically heroin.» Graham en profite pour rappeler que Courtney Love et Kurt se sont rencontrés à un concert des Butthole et que River Phoenix est mort sur le trottoir du Viper Room alors que Gibby était sur scène. Graham qui est extrêmement bien documenté, rappelle enfin que l’héro était au début un médicament contre la toux, mis au point par le laboratoire Bayer à la fin du XIXe siècle, qu’on vendait partout jusqu’en 1914, et qui fut interdit dix ans plus tard à cause du nombre grandissant d’addictions.
C’est nous dit Burns le contrat signé chez Capitol qui a fini par avoir la peau des Butthole. Le groupe va quand même se reformer pour tourner, avec des mercenaires. Le noyau de base, Gibby, Paul et King, a survécu.

Les Butthole restent dans leur fucking délire avec Weird Revolution, paru en 2001. Ils jouent la carte d’une certaine modernité et Paul Leary n’est pas avare de gras double, mais on voit qu’ils changent de son. Ils mixent le Butt sound avec du hip-hop et de l’electro et donc on les perd un peu. Inutile d’attendre des miracles de cet album. Pour «Dracula From Houston», ils reviennent aux accords rock’n’roll, mais le hip-hop s’en mêle, ce qui ne les empêche pas de rocker leur cut à coups de we gotta go. On les voit jouer «Shit Like That» à la vieille heavyness, mais c’est parasité par du techno sound. Puis ça dégénère, au fil des cuts, les machines prennent le pouvoir. Ils redressent un peu la barre avec «Jet Fighter», gratté à coups de big acou, voilà le Butt qu’on aime bien. Ils terminent avec «They Came In» et on assiste au grand retour des guitares. C’est même assez violent. Ils ramènent tout leur décorum, les falaises de marbre et les orchestrations de péplum, ils défoncent la rondelle des annales du Texas. Pour Graham, c’est un album raté, «just a bad album for bad times.» Le vrai bon album, c’est After The Astronaut qui n’est pas sorti officiellement.

En 2018, Paul Leary monte The Cocky Bitches avec the Baroness et enregistre Mercy. Qu’on se rassure, Paul Leary est encore capable de bourrer sa dinde. Premier coup de génie avec «Hand In Fire» qui sonne littéralement comme un cut des Pixies. Très spécial, avec du poids dans la balance. Encore un coup de génie en B avec «Rocket», un joli Rocket de destruction massive. Leary n’a rien perdu de son gut d’undergut, son sens du beat n’a jamais été aussi aigu, et il faut entendre les descentes de basse demented ! Il termine cet album passionnant avec le morceau titre, à la heavyness maximalis, qui est, souviens-toi, le pré carré de Paul Leary. Imbattable ! Il envoie des violons à la fin en rase-motte dans le mayhem de sa heavyness. D’autres cuts valent le détour, comme le heavy doom de «Burn Baby Burn» qui se perd dans l’ombilic des limbes, ou encore «Free The People» tapé au tribal texan, presqu’Indien. Il règne toujours une ambiance superbe chez Paul Leary. Avec cet album, il poursuit ses recherches sur le doom d’avant-garde.

Il enregistre encore un album solo en 2021, Born Stupid. Les Dadaïstes l’ont tous rapatrié pour se régaler de «Do You Like To Eat A Cow», car voilà du real Dada cow punk, meuhhhhh ! Paul Leary s’amuse bien, il chante comme Zampano. Mais attention, ce n’est pas fini ! On le voit ensuite danser la bourrée texane dans «Sugar Is The Gateway Drug», puis il s’en va faire du Dada robot tribal avec «What Are You Gonna Do». N’allez surtout pas imaginer qu’il va se calmer en B. Oh la la, pas du tout. Il l’attaque avec une chevauchée fantastique à la John Ford qui s’appelle «Mohawk Town», puis il passe à la farandole du IIIe Reich avec «Things Away Freely» et revient faire du noir cacadou au Cabaret Voltaire avec «Gold Cap», alors attention, on parle du Cabaret Voltaire de Zurich, bien entendu, pas de l’autre.
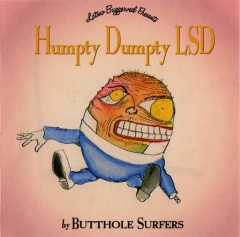
On bouclera ce modeste panorama avec un Humpty Dumpty LSD, un ramassis de démos et d’outtakes de Butthole. Oh rien de très spectaculaire mais des choses comme «One Hundred Million People Dead» accrochent bien l’oreille. Ces mecs-là ont des idées et du jus. On entend des choses rebondir dans le son. Belle leçon d’hypno, en tous les cas. Ils noient ça dans une certaine sauvagerie incongrue et Paul Leary s’en va brûler les plaines. Ils reviennent au cinémascope avec «Day Of The Dying Alive». Ils jouent au ahhh uhh, ils avancent à pas lourds dans le son comme des zombies, Paul Leary passe des lignes géniales qui hurlent comme des monstres à l’agonie. Avec les Butt, il y a toujours du spectacle. Paul Leary prend «Just A Boy» au chant et les Butt sonnent comme des Anglais. Ils sont un peu ridicules, dans leur trip de tripe, on croirait entendre un groupe de lycée technique, sauf que Leary joue de la haute voltige casse-gueule. Avec «I Hate My Job», ils font encore les punks anglais et sont encore plus ridicules. On dirait des Johnny Moped texans. Ils prennent parfois les gens pour des cons. C’est important de le savoir avant d’acheter leurs disques, surtout celui-ci.
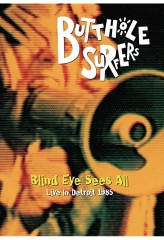
Les plus curieux verront le DVD des Butthole paru en 2002, Blind Eye Sees All - Live In Detroit 1985. Ça permet de les voir sur scène. Le concert filmé à Detroit en 1985 est entrecoupé de bouts d’interview loufoques. Ils sont au lit tous les cinq, tous torse nu et Teresa porte un sous-tif noir et des petites lunettes noires. Gibby raconte n’importe quoi. Retour sur scène : Teresa et King battent un beurre de tous les diables. Ils sont le moteur du chaos. Gibby porte un sous-tif blanc et souffle n’importe quoi dans un sax. Ils développent par moment de belles séquences d’hypno («Cherub») et Paul Leary veille au grain. Il joue un lead admirable. Il est essentiel de revoir le film après avoir lu les deux books, car tout s’éclaire. Les Butthole proposent une vraie drug-trance-music, comme le firent avant eux les 13th Floor. Fabuleux acid trip texan. Le bassman Trevor Malcolm s’est fait un look à la Warhol et il ramène sur scène le sousaphone qu’il a barboté à l’école de musique. Ils ont du génie sonique. Paul Leary hurle et joue ses stridences hallucinogènes, tout cela propulsé par les deux batteurs. Il chante comme David Thomas dans Pere Ubu («Something»). Ils n’avaient pour seule ambition que d’échapper aux conventions.
Graham conclut en disant que Gibby et Paul Leary on crée en 1981 un monstre qui a vécu 10 ans - dix ans vécus dans des conditions de pauvreté et de dégradation extrêmes, of self-inflicted mental and physical torture, oscillant entre les extrêmes psychiques, toujours affamés et au bord de l’épuisement. Mais c’est de ce contexte qu’a jailli l’une des plus grandes et plus folles live performances ever seen in the rock music era.
Signé : Cazengler, Butthole surfait
Butthole Surfers. Butthole Surfers. Alternative Tentacles 1983
Butthole Surfers. Live PCPPEP. Alternative Tentacles 1984
Butthole Surfers. Psychic Powerless Another Man’s Sac. Touch And Go 1984
Butthole Surfers. Rembrandt Pussyhorse. Touch And Go 1986
Butthole Surfers. Locust Abortion Technician. Touch And Go 1987
Butthole Surfers. Hairway To Steven. Touch And Go 1988
Butthole Surfers. Piouhgd. Rough Trade 1991
Butthole Surfers. Independant Worm Saloon. Capitol Records 1993
Butthole Surfers. Electriclarryland. Capitol Records 1996
Butthole Surfers. Weird Revolution. Hollywood Records 2001
Butthole Surfers. Humpty Dumpty LSD. Latino Burger Veil 2002
Butthole Surfers. Blind Eye Sees All. Live In Detroit 1985. DVD MVD 2002
Paul Leary. The History of Dogs. Rough Trade 1991
Paul Leary. Born Stupid. Shimmy Disc 2021
The Cocky Bitches. Mercy. Slope Records 2018
James Burns. Let’s Go To Hell: Scattered Memories Of The Butthole Surfers. Cheap Drugs 2015
Ben Graham. Scatological Alchemy: A Gnostic Biography Of The Butthole Surfers. Eleusinian Press Ltd. 2017
She Darts it right - Part Two

Des anciennes Darts, il ne reste plus que Nicole Laurenne et la bassiste Christina Nunez. L’illusse est donc périmée. Elles sont de retour en Normandie avec du turn-over pas dans les ovaires, mais presque, nouvelle crackette au beurre et nouvelle goddesse à la gratte, et bien sûr, une envie d’en découdre qui n’en démord pas, elles sont plus dare-dare qu’un dard du Darfour, elles valent mieux Dart que jamais, la crakette bat le Dart pendant qu’il est chaud, elle darde bien sous son bonnet de laine cardée.

Ce quarteron de goules des Dardanelles joue dans une quasi-obscurité, elles portent des capes et des dentelles noires, elles se meuvent comme des ombres dans un vacarme de gaga darwiniste de la pire auspice, elles font la tournée des grands Darts, elles appliquent à la lettre la règle du Qui Dart dîne, avec elles, ça darde sec, elle tapent dans le Dart fumant de la matière, nothing to lose and Love You 2 Dart, tout passe à la casserole, Don’t Hold My Dart, ça Break Your Dart au coin du bois, personne ne bat les Darts au petit jeu du real Darty, ce qui est dû est Dart, on ne revient pas là-dessus, et puis on l’a assez dit et répété,

les girl groups développent des énergies supérieures, elles sécrètent des jus qui exacerbent la notion même de gaga-punk, on le sait depuis Goldie & The Gingerbreads, les Runaways et les Pleasure Seekers, le Dart suprême des girl groups te surprendra chaque fois et t’émerveillera toujours. Chaque fois, c’est extrêmement condensé, fabuleusement ramassé, rien de traîne, leur cohésion est un modèle du genre, elles canardent chaque cut avec une soif vengeresse, elles palpitent de toutes leurs forces, elles taillent dans la masse avec une vertigineuse sensualité, si on ne les retenait pas, elles feraient danser la terre entière, elles te jerkent le ciboulot, t’expatrient la ciboulette, elles te chopent par ce que tu as de plus précieux, les sentiments, et tu leur fonds dans la main, elles t’ont sans rien, elles t’ont comme elles veulent, tu es à un mètre d’elles et tu les regardes d’un œil brillant comme si tu tombais au fond d’une caverne sur un trésor de pirate, elles font de toi un Monte-Christo à la petite semaine, mais au moins, ton œil brille pendant une heure, et ça, dis-toi bien que ça vaut largement tout l’or du Rhin entre tes reins, et même la loi Dartchimède, elles te servent sur un plateau Dartgent tout le Dart moderne, tout le Dart fumant !

Toutes pour une, une pour toutes !, chante la Dartagnan au moment où elle passe une jambe par-dessus le clavier de son Dartfiza, elle reptilise le gaga-punk, elle l’enjolive et l’épouse de ses formes, elle s’en Dartarise et dégage tellement d’énergie qu’elle ramollit les murailles en caramel. La cave palpite comme the house of love, les Darts te ramènent dans le giron du rock, au plus secret des cavités profondes.

Signé : Cazengler, Tarte
Darts. Le Trois Pièces. Rouen (76). 10 octobre 2022
L’avenir du rock - Ça urge, Overkill ! (Part Two)

À une certaine époque, l’avenir du rock considérait que la musique et les fringues devaient marcher de pair. Il raffolait des col roulés blancs et des pantalons rouges de Brian Jones, mais aussi de ce costume bleu marine à rayures rouges et jaunes que Brian Jones portait dans le fish-eye d’«Have You Seen Your Mother Baby Standing In The Shadow». Tu avais l’image et le son. L’avenir du rock raffolait aussi des jeans taille basse en velours côtelé que portaient Eddie Phillips, Michael Nesmith, ou encore Skip Battin, ce prince de la nonchalance en jean rouge et ceinturon blanc. L’avenir du rock ne manquait pas de loucher sur les escarpins à boucles de P.J. Proby et sur les boots en peau de serpent que portait Keith Richards à l’apogée de sa désaille. Mais pour porter ce type de boots, tes dents devaient bringuebaler, sinon tu n’étais pas crédible. Il était beaucoup plus difficile de flasher sur le blouson de Captain America ou le costard pied de poule que Dylan portait à l’Albert Hall en 1965, car dans les deux cas, le look et la tête ne faisaient qu’un. Même chose avec la veste Union Jack : si tu n’as pas la tête de Pete Townshend, ça ne marche pas. Les gens qui ont essayé sont passés pour des clowns. Par contre, l’avenir du rock pouvait se permettre de porter une toque en fourrure, en souvenir d’Anton Newcombe dans Dig et David Crosby à Monterey. Le fute de cuir noir est plus difficile à porter. Il vaut mieux s’appeler Vince Taylor, Johnny Rotten ou encore Jimbo pour se balader en cuir noir, car sinon, ça n’a pas de sens. C’est même assez ridicule. Ou porter les fameux silver jeans de Raw Power. Si tu ne t’appelles pas Iggy, t’es mal barré. L’avenir du rock se souvient d’avoir évolué avec les modes et d’avoir goûté au confort du mohair et de l’alpaga, de s’être enivré de l’odeur des tissus chez des tailleurs londoniens. Il s’est même un jour mis à rêver de monogrammes, du style de ceux que Nash Kato et King Roeser faisaient broder sur les cols de leurs tuniques, voici trente ans. C’est à Chicago qu’on lançait les modes en 1990, et l’avenir du rock adorait voir la classe et le son, c’est-à-dire les fringues et la musique, marcher de pair.

Un taureau pose pour la pochette du nouvel album d’Urge Overkill. Ugh ! Il est bien coiffé, avec une raie au milieu et si tu examines le détail de l’anneau passé dans ses naseaux, tu verras qu’il y pendouille un médaillon UO en or, oui, comme au bon vieux temps des dandys de Chicago. D’ailleurs l’album s’appelle Oui. C’est ce qu’on appelle un big album. Mieux que ça : un very big album. T’es averti dès le «Freedom» d’ouverture de bal, boom badaboom dès le premier accord, le king Kato et King Roeser font leur retour avec tout l’UO power, ce n’est pas une vue de l’esprit. Ces mecs te jerkent un power surge en deux minutes. Ça te balaye tout le rock américain. Schloooofff ! Ils sont brillants. Kato & King renouent avec le prestige de Saturation. Diable, comme on a pu adorer cet album ! Peu de groupes savent ramener autant de brio. Là, tu entres dans le club des dandys de Chicago. Pas d’infos sur le digi, mais le son est là. La niaque d’antan fait son retour en fanfare. On apprend que c’est l’ex-Cherry Valence Brian Quast qui bat le beurre sur certains cuts. L’autre coup de génie d’Oui s’appelle «How Sweet The Light». Ils plongent dans le meilleur UO Sound de tous les temps, Kato chante comme une rockstar définitive, c’est d’une classe inexorable, il chante à la voix confondue, ce mec est une véritable cerise sur le Katö, ses longs cheveux gris flottent au vent glacé de Chicago - I walk away from my suicide - C’est claqué au beignet d’accords d’how sweet the light, avec un thème qui plane comme un énorme ptérodactyle ! Voici venir l’incroyable dégelée d’UO, c’est d’une rare puissance et relancé en permanence. Le Katö gratte son «Forgiven» à la vieille cocote d’UO, celle des rockstars d’Amérique. Globalement, c’est un album très agressif. Ces deux mecs ne sont pas prêts à jeter l’éponge. Pas question de baisser les bras ! Quast bat «I Been Ready» comme plâtre, idéal pour du pur jus d’UO, ça se tord dans des travers de porc d’UO avec une superbe énergie cadenassée. Ils sortent un son tight et bien sanglé. Le Katö drive «Totem Pole» à la glotte folle. Le plus bizarre dans toute cette histoire c’est que Nash Kato devrait être une star, au même titre que Kurt Kobain et Lanegan. Il semble que le destin en ait décidé autrement. En attendant, on se retrouve encore avec un big album sur les bras. Un de plus ! C’est du boulot, les big albums, il faut savoir les gérer, c’est-à-dire les écouter et leur consacrer du temps en les réécoutant, et plus ils sont bons, plus on les réécoute. Un big album, c’est le miracle du rock toujours recommencé. Ça fonctionne ainsi depuis le départ. Tu te réveilles le matin et hop, tu sautes sur ton big album de la veille, car il est toujours dans ton oreille. On a toujours eu des big albums sur les bras à travers toutes les époques et ils sont d’une certaine façon le fil rouge, une sorte de raison de continuer à vivre. C’est le beurreman qui propulse l’UO dans la stratosphère avec «I Can’t Stay Glad@U» et ils font encore du big biz avec «Don’t Let Go». Ils sont dans l’élévation, c’est leur truc, leur raison d’être. Tout l’album est bardé de dandy rock, ils assurent leur postérité, tu peux y aller, l’UO c’est du solid as hell. Solid as hell jusqu’au bout de la cocote sévère de «Snow», le dernier cut. Et Richard III s’écria : «Mon royaume pour un UO !».
Signé : Cazengler, murge Overkil de rouge
Urge Overkill. OUI. Omnivore Recordings 2022
Inside the goldmine - Will a matchbox hold my clothes
Personne n’aurait misé un seul kopeck sur Tortor, sans doute à cause de sa dégaine de berger calabrais. Il portait un béret enfoncé jusqu’aux oreilles et une épaisse moustache lui barrait le visage. Mais il suffisait de l’observer pour surprendre l’étincelle de malice qui dansait parfois dans son regard et le vrac de sa barbe de trois jours indiquait à qui voulait bien voir que cet homme disposait de toutes les qualités qui font ce qu’on appelle généralement l’humanité. Tortor ne se contentait pas d’être Tortor, il peignait et ses toiles, lorsqu’on pouvait les voir, ne laissaient pas indifférent. Il aimait à rappeler qu’il était autodidacte et un vieux fond d’anticonformisme le poussait dans les bras d’une sorte de Dadaïsme primitif, bien qu’au plan visuel, il fût plus proche de Dubuffet que de Picabia. Les toiles de Tortor s’accompagnaient généralement d’un petit poème très court, une strophe tout au plus. Tortor était aussi poète, mais poète libre. Ses strophes, comme ses toiles, se riaient des cadres et des contraintes. Un menuisier de ses amis lui fabriquait des châssis aux formes incongrues, souvent triangulaires et Tortor qui peignait au couteau n’hésitait pas à utiliser des matériaux illicites, comme par exemple des copeaux métalliques récupérés sur un tour pour figurer une barbe, ou des culs de bouteilles pour figurer des lunettes. Ses toiles étaient le plus souvent des portraits abstraits, mais d’une saisissante ressemblance. Il peignait ses portraits le plus souvent de mémoire, un exercice auquel peu de peintres osent se risquer, car rien n’est plus difficile que de restituer l’expression d’un visage. C’est là où Tortor impressionnait, car à la manière de Dubuffet, il parvenait à pousser l’abstraction assez loin dans les orties pour en dégager une symbolique qui ne tenait qu’à un fil, mais on ne voyait que ce fil. Par exemple, lorsqu’on tombe sur le portrait d’Artaud que fit Dubuffet, on ne voit qu’Artaud. On ne voit que ce qu’on veut bien voir. Tortor peignit «L’auto-portrait d’un pendu» juste avant de se pendre et le texte qui accompagnait sa prodigieuse montfauconnerie disait : «C’est en peignant qu’on devient peigneron. Signé : la gueule d’empeigneron.»
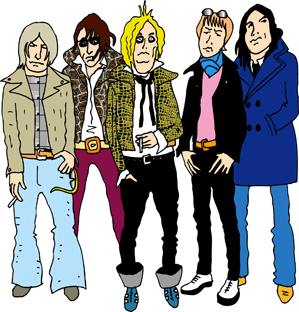
Il existe de toute évidence un lien entre ces deux arts extrêmes que sont ceux de Tortor et des Eighties Matchbox B-Line Disaster. Pendant que Tortor cultivait la barbarie figurative, les Matchbox cultivaient le chaos. Si tu y réfléchis cinq minutes, tu verras que ça revient exactement au même. T’en souvient-il, Guy McKnight & The Eighties Matchbox B-Line Disaster furent au tout début du XXIe siècle les rois maudits de l’insanité.

Leur premier album Hörse Of The Dög se répandit sur l’Europe comme un fléau biblique. Dans «Psychosis Safari», McKnight se vantait de dormir tout le jour - I sleep all day/ And I sleep all night - puis il s’éveillait pour exploser son papa ouh nah nah dans l’œuf du serpent. On ne savait pas à l’époque comment décrire cette apocalypse concassée et hurlée entre quatre murs. Il rééditait l’exploit un peu plus loin avec «Charge The Guns», menant la charge au waoouuh c’mon naw, il visait l’ultraïque, celui de Frank Black et de McLusky, mais en plus barré. Plus barré au waouuuhhh ? Comment est-ce possible ? Les rois maudits de l’insanité, telle est la réponse à ta question. Et tu les vois repartir à l’accent de l’insanitif avec «Presidential Wave», power, baby, pure power, McKnight explose son my babe en hurlant comme l’hérétique sur son bûcher, c’est d’une certaine façon puissant et inquiétant, tu as toutes les forces de la mort dans ce Wave, ils font exploser cette mélasse dans une solace de crânes de mort, oh yeah, c’est le cut des crânes de mort. Il te reste deux coups de génie à avaler, si tu peux : «Fishfingers» et «Chiken». Tu avais intérêt à suivre à l’époque, peu de groupes pouvaient te proposer un tel programme de démolition. Ils sont complètement irrécupérables, ces mecs n’ont aucun respect pour le rock anglais, c’est ce qui fait leur grandeur. Ils explosent «Fishfingers» au get out de fear ultime et derrière McKnight ronflent les flammes de l’enfer. Ils attaquent «Chicken» en mode Crampsy, mais en mille fois plus puissant, comme si c’était possible. Ils fonctionnent à la rafale, au dégueulis de fast beat et comme d’usage, le chevalier McKnight chante à l’ultimate. Ils sonnent les cloches de Tintern Abbey, ils produisent un invraisemblable shaking de grelots, ils vomissent dans leur volcan et ne vivent que pour l’imparabilité des choses. Fuck, ces mecs négocient en direct avec la folie pure. Ils se nourrissent d’extrême violence dès le breakfast. Ils jouent leur va-tout en permanence. Pas facile de taper dans les extrêmes. Leur point faible serait une certaine fébrilité, celle de barbares confrontés à la civilisation.

Leur deuxième album The Royal Society paraît deux ans plus tard. Ils perdent un peu de leur extrémisme mais veillent à rester dans l’énormité tapageuse, comme le montre «I Could Be An Angle», cut ravagé par des clameurs, ces mecs semblent proliférer juste au-dessus de ton épaule. McKnight pose son chant au sommet du mayhem. Il faut attendre «The Fool» pour voir le son voler en éclats. Ils développent des réflexes extraordinaires, comme ces claqués de cisaille dans les breaks. McKnight s’abreuve à la source du slaughter, il patauge dans des mares. Il reste dans l’épais malaise sonique avec «I Rejection» et envoie le vieux rock anglais ahaner dans un coin de la cave. McKnight sonne parfois comme Iggy, il sait poser sa voix, comme le montre «Drunk On The Blood». Il est l’un des singers absolus. Les Eighties n’ont pas de hits mais une superbe collection de dérives. On les voit ensuite s’écrouler avec tout le rock anglais dans «Mister Mental», puis exploser le heavy funk-rock de «Freud’s Black Muck». Il s’arrache littéralement la rate à gueuler ses aw. Ils tatapoument sur ton crâne et pilonnent comme des canons allemands de la Première Guerre Mondiale. «When I Hear You Call My Name» sonne comme un cut sans queue ni tête comprimé à outrance. Ici tout est taillé à la serpe et chanté à la McKnight. On peut finir en beauté avec «Temple Music», une belle overdose de Big Atmospherix.

Et voilà le chant du cygne de cette brillante équipe : Blood & Fire, paru en 2010. Nouvelle pochette cryptique, omniprésence des crânes de mort. Le hit de l’album s’appelle «Monsieur Cutts», amené au heavy bast de Matchbox, ils percutent leur destin de plein fouet. C’est le cut des guts de Cutts, ils se tirent une balle dans la tête, pow !, leur blast suprême n’a aucune chance en Angleterre et pourtant ils créent le meilleur mayhem local. À l’époque, tout le monde est passé à côté. On les voit se perdre avec «So Long Good Night», ils visent l’épique, mais ils ramènent tellement de son qu’ils pourraient sauver la vieille Angleterre. McKnight dit qu’il hait le blues dans «I Hate The Blues», il gonfle ses veines puis il revient au blast avec «Man For All Seasons». Ils démolissent tout sur leur passage, avec cette disto qui les caractérise. Ils fourrent encore leur dinde avec «Homemade» et McKnight entre dans le temple du cut comme un Saint. Il a une façon de tituber dans les grooves qui est unique («Never Be The Same») et avec «Are You Living?», les Matchbox visent carrément l’Hiroshima mon amour du rock, alors oui, ça explose. Ces mecs ne reculent devant aucune horreur. Trop de puissances des ténèbres. Ça ne peut pas marcher. Trop de chaos. Avec ces trois albums, ils ont développé un son d’une intensité unique en Angleterre. Excepté McLusky, aucun groupe n’a jamais atteint ces extrêmes sur le sol anglais.
Signé : Cazengler, E.T. Pinard Retox Disaster
Eighties Matchbox B-Line Disaster. Hörse Of The Dög. No Death Records 2002
Eighties Matchbox B-Line Disaster. The Royal Society. No Death Records 2004
Eighties Matchbox B-Line Disaster. Blood & Fire. Black Records 2010
FORTUNES & INFORTUNES DU BLUES
Si l’on poussait un peu les meubles pour y voir plus clair. Pas ceux de votre deux-pièces cuisine, uniquement ceux estampillés Paramount. Vous n’en n’avez pas, il doit en rester aux USA. Au début du vingtième siècle la firme Paramount vendait des meubles. Appliquaient la méthode américaine. Ne pas attendre le client, le précéder. Sont à l’affût des nouveautés. Or dans les années vingt y a un truc qui commence à se vendre : le phonographe. Non, ils ne vont pas se lancer dans la fabrication de ces engins. Ils n’en maîtrisent pas la technique. Sont plus malins que cela, ils proposent des meubles de rangement pour le phonographe que vous ne savez pas où poser dans votre living-room.
Lorsque l’on tient un filon, on l’exploite à fond. Quand vous possédez un phono, vous achetez des disques, vite encombrants et fragiles ces 78 tours épais, lourds et envahissants. Ne paniquez pas Paramount est là, l’a créé exprès pour vous le meuble range-disques. Très utile. Surtout quand un surplus de galettes vous oblige à en acheter un deuxième…
O.K. vous avez compris ? Ben non ! Un tremblement de terre ravage les USA, la firme de disques Okeh écoule entre 1920 et 1921, un million d’exemplaires de Crazy Blues interprété par Mamie Smith. Déjà chez Okeh records, on n’y croit pas, quelle incongruité, qu’un disque de nègre se vendît tant, c’est affolant, c’est incompréhensible ! Peut-être même immoral, mais les dollars qui s’entassent dans les tiroirs-caisses dégagent quoi qu’en ait décrété l’Empereur Vespasien une fort alléchante odeur.
Chez Paramount l’on est pragmatique. Puisque l’on vend des range-disques pourquoi ne pas vendre des disques de ces sous-races colorées dont le public semble si friand… Vous connaissez la ruée vers l’or du Klondike, la ruée vers l’or noir peu écologique, nous voici à la naissance de l’or bleu. Le problème c’est que chez Paramount l’on ne possède pas de musicologue. Chez beaucoup d’autres non plus. Pas la peine de s’inquiéter. L’on enregistre tout le monde, ce n’est pas cher la chair noire, avec un ou deux techniciens et quelques affiches, en se déplaçant de bourgade en bourgade, vous ratissez large, en bout de chaîne le dieu dollar reconnaîtra les siens. Paramount sera récompensé, le Long Lonesome blues de Blind Lemon Jefferson atteindra aussi le million d’exemplaires.
Voici pourquoi la firme Paramount produit en 1930 et 1931, trois 78-Tours, deux attribués à Geeshie Wiley et un autre à Elvie Thomas. De fait toutes deux sont présentes sur les enregistrements, Geeshie à la guitare et au chant, Elvie Thomas également mais surtout en soutien.
Paramount 12 951 : GEESHIE WILEY : Last kind words blues : c’est en écoutant ce morceau ( voir notre livraison 570 ) pour en présenter la version de Robert Plant et Alison Kraus que j’ai voulu en savoir davantage sur cette énigmatique figure : dépouillé, mais étrangement vous ne savez où donner de la tête, guitare ou voix, la guitare vous avez l’impression d’une corde de pendu qui n’en finit pas de tomber et de rebondir vers le haut pour retomber et ainsi de suite, et malgré tout cette douceur suave du baiser de la mort qui apporte le soulagement espéré. La voix de Geeshie, malgré l’accent traînant l’on dirait qu’elle est pressée, la lassitude de vivre, une certaine désinvolture, presque un je-m-en-foutisme qui confine à l’attrait du néant. Doom à la puissance mille. Une chanson de mort. Skinny leg blues : au morceau précédent nous étions au moment de la cristallisation du early folk en early blues, cette fois-ci les cristaux de blues sont en voie de coalescence. Skinny Legs l’expression est émoustillante, mais le bourdonnement bleu outremort de la guitare ne présage rien d’excitant, les paroles tranchantes sont à double-sens, elles se transforment vite en sens unique via le létal terminus. La petite mort et la grande se rejoignent. Paramount 12977 : ELVIE THOMAS : Motherless child blues : Elvie est au chant et à la guitare, une voix plus pleine que celle de Geeshie, si Last Kind words blues évoquait les dernières paroles du père, ici ce sont celles de la mère qui sont chantées, ces deux chansons sont jumelles. Lyrics beaucoup plus percutants, la guitare tressaute et trottine, les cordes semblent montées sur ressort, et ne s’accordent pas trop avec l’interprétation vocale. Y aurait-il maldonne ? Over to my house : sans doute retrouve-ton Geeshie au chant, et si c’était le premier morceau de rock ‘n’roll car ça déménage vraiment, cru et violent, ce n’est plus du rural blues mais du b-RUT-al blues. Paramount 13074 : GEESHIE WILEY : Eagles on a half : un régal ce pickin’, dans lequel la difficulté est évincée par son évidence, malgré le premier couplet, la demoiselle ne semble pas avoir si honte qu’elle le déclare, le ton est enjoué l’on pourrait appeler ce morceau un blues salace, si l’on en croit la numismatique et les reproductions graphiques des pièces d’un demi-dollar, les lyrics évoqueraient la sodomie. Pick poor Robin Clean : Geeshie et Elvie s’amusent, chantent ensemble, s’il y a des enfants à l’écoute vous expliquerez que c’est un peu comme notre alouette, je te plumerai la tête, mais là c’est un peu plus bas. Sympathique mais si vous y regadez de plus près, glaçant.
Damie Chad
Nous ne possédons aucun autre enregistrement de Geeshie Wiley et d’Elvie Thomas. Que sont-elles devenues ? Pour Elvie la suite de l’aventure est décevante. En 1933 elles mettent fin à leur relation musicale – rien ne nous autorise à penser qu’elle fut aussi plus intime. La jeunesse passant Elvie - le prénom est la contraction de ses deux initiales L. V - s’assagit, l’on dit qu’elle serait revenue à une vie davantage chrétienne, partageant ainsi le sort de nombreux artistes de blues qui après avoir pactisé avec la musique du diable sont retournés dans le giron de leur communauté religieuse.
Quant à Geeshie… On l’a retrouvée ! Quoi l’éternité ? Non mais un certain John Jeremiah Sullivan reporter du New York Times a entrepris une longue traque, il a remonté la piste, il a publié le 13 avril 2014 un long papier que tout amateur de blues se doit de lire. Tout ce qui suit s’inspire de cet article intitulé The Ballad od Geeshie and Elvie. Ce n’est pas seulement Geeshie et Elvie que nous allons retrouver mais aussi d’autres personnages tout aussi essentiels et singuliers.
Le premier est John Bussard, le plus grand collectionneur de 78 Tours, l’en avait amassé près de 25 000 ( blues, country, jazz). C’est lui qui a dégoté chez un antiquaire de Baltimore ( Edgar Poe y est mort, il n’y a pas de hasard, seulement des vols de corbeaux ) l’un des deux uniques exemplaires de Motherless child blues, nous a quittés ce 26 septembre 2022, il ne stérilisait pas ses découvertes, il envoyait des enregistrements de ses trouvailles à qui lui en faisait la demande, les amateurs de blues et de country lui doivent beaucoup.
Le deuxième est beaucoup plus connu : Allan Lomax. Lorsque le jeune Dylan le rencontrera lors d’une soirée new yorkaise – la scène est rapportée dans ses Chroniques – il a l’impression de se trouver face à une institution humaine avec tout ce que ce mot contient de désagréable… mais dans sa jeunesse Allan qui a accompagné son père lors de ses enregistrements pour La Bibliothèque du Congrès tombera un jour sur un gros stock des disques Paramount, à partir de ce trésor et de la récolte de son paternel il publiera la liste American Folk Songs on Commercial Records, qui circulera, parfois recopiée manuscritement, parmi le milieu des folkloristes et des collectionneurs. La quête graalique est lancée…
Parmi ces pisteurs, Jim McKune du ( ? ) YMCA (mouvement de jeunesse chrétienne international), je n’avais jamais entendu son nom et je rencontre un personnage fascinant. Peut-être né à Baltimore ( tiens-tiens ) en 1915, assassiné en 1971 dans un hôtel, ses dossiers ont disparu, connu dans le milieu des collectionneurs, gentil et survolté, énigmatique, insatisfait, sautant de petits boulots en jobs insatisfaisants – le fait qu’il fût homosexuel n’était peut-être pas étranger à son comportement – l’un des tout premiers à collectionner les disques de Rural Blues, sa collection de 300 disques a été préservée. Il privilégiait la qualité sonore de ses exemplaires et la rareté comme Isiah Nettles surnommé le Mississippi Moaner ou Crying Sam Collins … N’a apparemment pas été en mesure de rédiger un ouvrage qui lui tenait à cœur, dont on ne sait rien…
Le personnage de McKune possède aussi une face plus sombre. L’a fait partie dans les années soixante de ce que l’on a appelé la Maffia Blues. Rien à voir avec la Maffia, simplement un regroupement d’amateurs de blues qui se sont en quelque sorte de par le travail de recherche qu’ils avaient accompli ‘’institutionnalisés’’. Etaient devenus des incontournables du blues un peu comme les mandarins de l’American Folk Center évoqué par Dylan. Certains se sont enrichis après avoir ouvert des cabarets. On leur reproche aussi d’avoir été des mâles blancs, sous-entendu de sales oppresseurs… ce qui est un tantinet grossièrement injuste quand on pense à tout ce qu’ils ont préservé… Dylan (encore un mâle blanc) déclarera que s’il n’avait pas entendu les rééditions de Robert Johnson et de quelques autres il ne serait jamais devenu Bob Dylan…
John Jeremiah Sullivan cite encore l’écrivain Paul Bowles et Harry Smith qui réalisa la toute première anthologie de la musique américaine pour Folkway Records…
Enfin entre en scène Robert McCormick (1930 – 2015). Un esprit curieux de tout. Surtout des phénomènes auxquels personne n’était prêt à accorder une importance quelconque. Tout gamin il commence à copier sur des carnets les réparties des spectacles burlesques (notons que Poe a théorisé et pratiqué l’écriture grotesque ), adolescent amateur de jazz il ravitaille les musiciens en produits illicites. Le doigt dans l’engrenage. Pas celui auquel vous pensez, du Texas à la New Orleans en autostop la distance n’est pas bien grande, il y rencontre Orin Blackstone, journaliste entiché de jazz qui lui demande de farfouiller dans les entrepôts et les brocanteurs du Texas à la recherche de vieux disques de jazz. En 1946 Robert participe activement à la rédaction de l’Index du jazz du Texas… Il se pique au jeu, se fait nommer à Houston et commence à explorer comté par comté toute la région. Il agit progressivement suivant l’ancienne progression de l’esclavage. Il n’en croit ni ses yeux, ni ses oreilles. D’un quartier à l’autre tout change, dans l’un l’on jouait principalement du banjo et dans l’autre du violon. Il en déduit les principes d’une théorie des Clusters qu’il n’aura jamais le temps de mettre au net : tout dépend des individus, si ici se sont retrouvés à l’origine quatre esclaves doués pour le chant la contagion gagnait tout le quartier, de même trois violonistes suscitaient des émules autour d’eux… Pendant des années il accumule des notes, des transcriptions d’interviewes, de chants, il répertorie et il enregistre tout ce qui se présente. Il devient prisonnier de sa passion boulimique, il ne la contrôle plus et ne contrôle plus ses réactions, il déraille quelque peu, le pire c’est que les autres chercheurs le prennent en grippe, dès qu’ils croient avoir trouvé du neuf, Robert a dans ses monceaux de documents des éléments qui apportent bien plus de renseignements que leurs découvertes… McCormick prêta à Peter Guralnick la documentation qu’il avait recueillie sur Robert Johnson… Lui-même devait écrire son propre livre sur Johnson, ce qu’il ne fit pas. Il est curieux de voir que McKune et McCormick, dévorés par une même fièvre de connaissance, ont tous deux été incapables de finaliser leurs ouvrages.
Sans connaître son nom les amateurs de rock ont entendu parler de McCormick : c’est lui qui a tenté de couper le câble électrique qui alimentait le Paul Butterfield Blues Band qu’avait choisi Dylan pour révolutionner le folk au Festival de Newport en 1965. McCormick désirait que Dylan acceptât d’être accompagné par quatre anciens prisonniers noirs qui n’avaient jamais joué ensemble…
Robert McCormick a aussi enquêté sur Wiley Geeshie. Il a retrouvé et interviewé E. V. Thomas (originaire d’ Houston ) dans le Texas. Elle semblait fière d’avoir donné à Lillie Mae Wilay le surnom de Geeshie. Elles auraient commencé à tourner ensemble au tout début des années vingt. Jusqu’en 1933. Toutefois selon John Jeremiah Sullivan, Geeshie ( qui serait née en 1908 en Louisiane ) aurait poignardé son mari Thornton Wiley en 1931. Comment se fait-il que malgré son crime elle tourne encore avec Elvie en 1933. Elvie aurait quitté Geeshie à Chico, Oklaoma. Elle ne l’aurait jamais revue depuis. C’est en l’Oklaoma que McCormick aurait vers 1950 retrouvé la famille et la maison de Geeshie. Quand Geeshie est-elle morte en 1938 / 39 ou accidentellement en 1950 selon Caitlin Love qui à la fin de son article avoue qu’elle n’a trouvé aucun indice qui apporterait une preuve irréfutable à ses recherches et déductions généalogiques.
La route de Geeshie se perd dans le sable de l’immémoire…
*
Voilà je pense que vous êtes aussi insatisfait que moi de cette fin. A tel point que pour le dernier paragraphe précédent, j’ai bricolé ces lignes en m’aidant de l’article (rédigé en anglais) de Wikipedia. Il y en a un autre qui ne devait pas être content, c’est John Jeremiah Sullivan le rédacteur de Ballad of Geesshie and Elvie. Je suis retourné relire son article. Je me suis débattu un long moment contre le site du New York Times qui ne voulait plus me donner accès à JJS alors que j’avais obtenu une permission au long cours la fois précédente. J’insiste, et surprise la porte est de nouveau ouverte. Je donne ces détails oiseux pour que les esprits curieux qui désireraient aller voir par eux-mêmes ne se découragent pas, parce que cette deuxième fois, surprise, le texte qui s’offre à ma vue est beaucoup plus long.
Non seulement il est beaucoup plus étendu, mais il se lit comme un roman. L’écriture a changé. Dans la première partie Sullivan rapporte des faits. Dans la seconde il devient le personnage principal de l’enquête, pour une raison simple, il mène la traque en personne. Nous fait donc part de ses doutes, de ses réactions, de ses analyses au fur et à mesure qu’il avance dans ses recherches. Il ne raconte pas, il n’évoque plus, il rencontre des gens, le récit dégage une densité littéraire peu commune.

Première démarche : une visite chez Mack ( Robert Mackormick ), l’a plus de quatre-vingt ans, se déplace en fauteuil roulant, il commence la conversation en déclarant qu’il refusera de parler de Robert Johnson, ce qui tombe bien puisque Sullivan n’est pas venu pour ça, et là-dessus Mack se lance dans une espèce de monologue sur Robert Johnson, tout ce que l’on sait sur Robert Johnson est sujet à controverse, l’acte de décès, la photographie , et plus grave, le Robert Johnson que nous nommons Robert Johnson est-il le même que le Robert Johnson qui a enregistré les disques… Mack en sait-il davantage, a-t-il seulement envie de révéler un jour les documents inédits qu’il aurait sur Johnson, en a-t-il seulement, bluffe-t-il, quel jeu joue-t-il ? Le livre sur Johnson qu’il n’a pas écrit ( et qu’il n’écrira pas ) n’est-il pas en lui-même plus fondamental et intrinsèquement supérieur à tout ce qui a été publié. Sullivan fait référence à Borges, pour nous c’est le fantôme du Non-Livre du Livre de Mallarmé qui se profile en filigrane des milliers de pages classées (et déclassées) dans les rayonnages qui recouvrent les murs de l’appartement.
Enfin l’entretien en arrive à Geeshie et Elvie. Oui McCormick a retrouvé Elvie (1960-61) et il lui lance une mince chemise de photocopies de documents et de lettres qu’il lui permet de lire. Sullivan éprouve la sensation d’être traité comme un gamin, un jeune blanc-bec qui se préoccupe de deux petites blueswomen de rien du tout alors que lui Mack possède une vue synthétique de l’Histoire du Blues… Il ressort de l’entretien déçu.
C’est un tenace le Sullivan. L’a été contacté par une jeune étudiante qui a décidé d’arrêter pour une année son école pour enquêter sur Geeshie et Elvie, celle que nous connaissons sous le pseudonyme de Caitling Rose Love, Sullivan réussit à persuader McCormick de la prendre pour l’aider à ranger ses papiers. Le deal ne durera pas. Le (très) vieux garçon n’aime pas que l’on tente de classer le fouillis qu’il a amassé, préfèrerait que la jeune femme s’asseye en face de lui et écoute sans bouger le Maître raconter l’Histoire du Blues… Caitling Rose Love parvient à photographier grâce à son téléphone portable quelques pages inédites d’un dossier de McCormick… Enfin une piste !
Le dossier ‘’ récupéré’’ est une transcription de l’interview d’Elvie par McCormick. Elle est née en 1891 à Acres Homes ( Houston ) elle a commencé à jouer de la guitare, très jeune dans la rue, son père Peter Grant a fait de la prison, très tôt elle rencontre Texas Alexander – à la charnière des songters et du blues - il joue de la guitare, elle chante… elle a trente-huit ans lorsqu’elle enregistre en 1930 les six morceaux avec Geeshie… maintenant elle ne chante plus qu’à l’église de sa congrégation. Un demi-siècle s’est écoulé depuis ses confidences. Catling tilte. Est-ce qu’elle ne pourrait pas retrouver à Acres Homes l’église et des gens qui l’auraient connue…

( ... enfin une photo d'Elvie... )
Elle trouve, elle habitait tout près de l’église, une bicoque sans eau, toujours en pantalon, pas causante, une dure à cuire, une solitaire, parfois elle amenait un petit garçon avec elle à l’église… Le puzzle s’enrichit, le petit garçon sera retrouvé en Californie, bientôt Sullivan et Caitling réunissent les membres de la famille d’Elvie pour leur faire écouter les six morceaux de leur tante qu’ils ne connaissaient pas… et tout s’enchaîne… à une parente éloignée Sullivan suggère avec délicatesse qu’avec son allure… Elvie aurait pu être… oui une lesbienne !
Et donc Geeshie sa compagne. Mais pourquoi Geeshie aurait-elle tué son mari. Parce qu’il les aurait surprises au lit. Pourquoi n’a-t-elle pas été en prison, pourquoi la police l’a-t-elle relâchée, parce qu’à l’époque un nègre mort était le meilleur des nègres et que l’on n’allait pas se fatiguer pour un cas qu’il était si facile de classer en légitime défense. Nous sommes là dans le domaine du possible. Mais la preuve ?
Elle va être apportée par un vieux musicien de quatre-vingt dix ans qui n’a plus toute sa tête. Mais quand sa fille lui annonce la venue de Caitlin qui veut parler avec lui de Geeshie Wiley, il s’exclame : tu veux parler de Slack ?
Si vous voulez comprendre écoutez les six morceaux enregistrés par Geeshie et Elvie, tout est dedans, et si vous ne comprenez pas l’anglais le net vous offrira la traduction des lyrics.
Qu’est devenue Geeshie ? Nul ne le sait. Mais nous aurons fait un beau voyage dans les fantômes et l’essence du blues.
Damie Chad.
ROCKAMBOLESQUES
LES DOSSIERS SECRETS DU SSR
(Services secrets du rock 'n' roll)
Death, Sex and Rock’n’roll !

EPISODE 2 ( ITERATIF ) :
8
Les chiens sont heureux de batifoler en pleine campagne, ils courent à vive allure parmi les herbes hautes. Sortir de Paris n’a pas été facile. Je n’ai rien remarqué de spécial, j’ai tenu compte de l’avertissement du Chef : ‘’ vous serez le chasseur et le gibier’’. J’ai pris mille précautions. Molossito et Molossa n’ont pas été à la fête, contraints de cavaler à une quinzaine de mètres derrière moi dans les couloirs du métro. J’ai même été obligé de précipiter sous une rame un contrôleur qui s’obstinait à vouloir me contrôler malgré le billet de 500 euros que je tentais de lui refiler. ‘’ Un conseil d’ami : l’honnêteté peut tuer’’ lui ai-je murmuré à l’oreille avant de l’expédier sur les rails. Une heureuse initiative, la panique qui a suivi m’a permis de m’éclipser subito abrupto et de retarder tout éventuel poursuivant. J’ai volé une voiture que j’ai abandonnée quinze minutes plus tard non sans avoir aspergé d’essence l’intérieur alors que je m’étais arrêté pour prendre du carburant. L’allumette que j’ai négligemment jetée a provoqué une superbe explosion. N’ayez crainte, les chiens et ma pomme étaient déjà loin lorsque la station s’est enflammée. Ensuite nous avons progressé étape par étape, de voiture volée en voiture volée, prenant soin à chaque changement de véhicule de le précipiter dans la rivière qui bordait mon parcours. Mon âme romantique est comme celle d’Alfred de Vigny, j’aime entendre le son des glou-glou au bord des bois. Je ne vous raconte pas toutes les péripéties, cela deviendrait fastidieux. L’essentiel c’est que maintenant nous nous nous dirigions gaillardement à pied et à pattes vers notre destination.
9
Je suis assez content de moi. Je n’ai jamais visité l’Oise et je m’apprête à parcourir ce département en promeneur solitaire à la manière de Jean-Jacques Rousseau. J’éprouve toutefois un manque. Non ce n’est pas Alice, je l’ai déjà dit un agent du SSR en mission est un loup pour l’homme et un mâle Alpha dédaigneux pour la femelle, non c’est le fumet délicat d’un Coronado du Chef, parfois âpre et irrespirable, je vous l’accorde, mais si rassurant. Tant que nous y sommes, j’ai le regret de vous annoncer que malgré un nombre de plusieurs milliers de lettres que nous avons réceptionnées suite à notre concours de la semaine dernière, aucun de nos lecteurs n’a indiqué la bonne route à suivre. C’était pourtant si facile, ainsi personne n’a établi la relation entre les contes de ma mère l’Oye et l’Oise orthographiée en Oyse au dix-septième siècle. Je sais, ce n’est qu’un mince indice mais rassurez-vous au cours de notre chemin j’apporterai quelques nouveaux arguments à cette assertion pour l’instant d’apparence gratuite et fragile…
10
Il devait être près de quatorze heures quand au détour d’une allée la vaste terrasse ensoleillée s’offrit à mes yeux. Personne aux alentours, je ne résistais pas à tentation de prendre place à une table. Une jolie brunette surgit de l’intérieur.
- Désolée, Monsieur c’est notre jour de relâche. Nous ne recevons pas de client.
Ses yeux s’agrandissent de surprise, elle vient de remarquer Molossa et Molossito :
- Qu’ils sont mignons ! Attendez, je crois qu’il me reste du cuissot de biche, je leur en apporte avec de l’eau, ils ont l’air fatigué, pour vous nous avons une excellente terrine de caille et un gratin de cèpes dont vous me direz des nouvelles.
- Ah Madnoiselle, si vous nous prenez par les sentiments…
- Appelez-moi Sylvaine !
- Moi c’est Damie, Sylvaine suis-je loin de d’Armancourt ?
Ici normalement l’esprit des lecteurs devrait tilter. La première édition des Contes de ma mère l’Oye était signée de Pierre d’Armancour…
- Vous l’avez déjà dépassée, la ville est derrière vous !
- J’ai dû la contourner, je suis passé par les champs.
- Vous aimez la nature Damie, continuez tout droit et vous ne pouvez manquer la forêt,
- Je n’y manquerai pas, je règle l’addition et je pars à la minute.
- Vos chiens se sont endormis sous la table, vous aussi devez être fatigué, venez dans ma chambre pour une sieste réconfortante.
Je ne suis pas une tête brûlée. Je sais reconnaître la sagesse. Je cédais à la proposition de Sylvaine… Mais à dix-neuf heures je mis un terme à nos ébats.
- Sylvaine, il est temps pour moi de te quitter, je ne saurais résister à l’appel de la forêt.
- Damie, je ne vous retiens pas, sachez toutefois qu’une vieille légende raconte qu’elle est hantée. Des billevesées sans doute, mais certains promeneurs ont disparu…
- N’ayez crainte Sylvaine avec Molossa et Molossito j’irai jusqu’au bout du monde !
- Oh, la forêt de Laigue n’est pas la jungle amazonienne, elle ne s’étend que sur une longueur d’une dizaine de kilomètres, elle est très bien entretenue et les sentiers sont larges, avec vos deux molosses vous ne risquez pas de vous perdre. Embrassez-moi une dernière fois et si vous repassez par ici, revenez me voir !
- Je n’y manquerai pas Sylvaine.
Je la tins serrée contre moi durant une longue minute, puis je la quittai brusquement pour prendre en compagnie de mes deux fidèles cabotos la direction que Sylvaine m’avait indiquée.
11
Sylvaine ne devait pas avoir les mêmes notions que moi sur l’entretien des forêts et les distances kilométriques. Si le premier chemin que j’empruntais était large et dégagé, très vite il devint plus étroit, et les arbres se rapprochaient de plus en plus de ses bords. J’avais déjà parcouru une bonne quinzaine de kilomètres lorsque la pénombre m’obligea à m’arrêter. A l’orée d’une petite clairière j’avisai un frêne dont les branches curieusement tombantes formaient comme un tipi indien. Nous nous y faufilâmes, personne ne pouvait nous voir, je déroulais une couverture de survie contre l’humidité du sol et une deuxième sur nous pour nous tenir au chaud. Je n’avais pas froid, les deux chiens collés contre moi s’endormirent aussitôt et je ne tardai pas à les imiter…
12
Il devait être trois heures du matin lorsque Molossa colla son museau contre mon cou. Pas un bruit. Même pas un hululement de chouette effraie. J’avais saisi mon Rafalos, prêt à tirer, mais seul le silence nous entourait. Molossa gardait la tête penchée. Elle entendait quelque chose, mais quoi ? Quel bruit lointain lui parvenait ? Molossito continuait à dormir… Arme au poing je veillai jusqu’à l’apparition des premières pâleurs de l’aube. Pas une seconde Molossa ne relâcha son attention. Le danger était devant nous. Quel était-il ? Au petit matin nous grignotâmes un biscuit à chien et nous faufilant sous les branches basses du frêne nous reprîmes notre route.
13
Un véritable cauchemar. Bientôt il n’y eut plus de sentier. Un rideau quasi-impénétrable d’arbres se dressait devant nous. Des lianes, des épines, des ronces obstruaient le moindre passage. Le moindre mètre nous coûtait des efforts surhumains et surcanidéens. Nous nous coulions dans de minuscules espaces libres mais à midi nous avions tout juste progressé de deux cents mètres. A trois heures de l’après-midi les troncs étaient si serrés qu’il fut impossible d’avancer. Découragé mais pas vaincu, j’avisai entre deux fûts une espèce de fente étroite dans laquelle je parvins à insérer le bras jusqu’au coude. Mes doigts glissèrent sur une surface plane qui ressemblait à de la pierre. Un mur ! Tout proche mais inatteignable. Rien ne saurait arrêter un agent du SSR, avec mon Rafalos je tirais sur un arbre. A intervalles réguliers mes balles percutantes réalisèrent le long de l’aubier une série d’encoches dans lesquelles mes pieds pourraient prendre place.
- Les chiens vous m’attendez, je reviens.
Et hop j’entrepris l’escalade. J’eus tôt fait de dépasser l’arête supérieure du mur.
14
Au premier regard je compris où j’étais. Le château de la Belle au bois dormant ! Avec ses tours, ses toits pointus, ses échauguettes il était presque plus beau que celui de Disneyland-Paris. Des dizaines de gardes et de serviteurs disséminés sur le vaste parvis figés dans la pose dans laquelle le sommeil les avait saisis. Le plus remarquable était ce carrosse tiré par huit chevaux blancs immobiles dans leur galop. Je me laissai choir de la cime de mon arbre et courus comme un fou vers le pont-levis. Personne ne s’opposa (et pour cause) à mon passage, j’entrai sans m’arrêter, le chemin était comme tracé par la foule des domestiques et des courtisans qui formaient une haie d’honneur. Je déboulai dans la grande salle d’apparat, sur une estrade on avait dressé u lit à baldaquin, la princesse était là, je gravis les marches, enfin j’allais savoir si la fameuse princesse était vraiment belle, elle était là, couchée sur un édredon virginal, je poussai un cri, je la connaissais, Alice ! Rien n’aurait pu me retenir, je me baissai et déposai sur la rose de ses lèvres un baiser vaporeux…
15
Au premier regard je compris où j’étais. Chers lecteurs, si vous n’avez pas eu l’intuition que le paragraphe précédent était just a joke, c’est que vous n’êtes pas très pertinents. J’exagère, je ne le compris pas immédiatement mais j’eus une soudaine révélation : je connaissais cet endroit. Mais, oui, bien sûr, le manoir aux toits d’ardoises, les feuilles roses des arbres, les arbres centenaires, le mur de pierre tout concordait j’étais dans la pochette du premier album de Black Sabbath. Tout y était. Tout sauf cette mystérieuse dame noire – les membres du groupe aimaient à raconter qu’elle n’était pas présente lorsque la photo fut prise, mais que sa présence se manifesta au développement – intox, mystification pensez-en ce que vous voulez – un bruit feutré puis la fameuse cloche qui retentit dans le disque se mit à sonner, lugubrement, et Elle apparut, Elle était assez loin, doucement Elle se dirigeait vers moi. La pâleur de son visage, son doux sourire, tout concordait. Elle ne marchait pas. Elle glissait. Lentement. Elle se rapprochait. Son sourire s’épanouit, maintenant il grimaçait, je réalisai que c’était la Mort qui venait à moi. Instinct de survie, je dégainai mon Rafalos et tirai sur Elle. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, la dernière presque à bout portant, les balles l’atteignaient, ne lui faisaient aucun mal, peut-on tuer la mort ?
16
Elle posa la main sur mon cœur, j’étais déjà mort, reverrai-je une dernière fois le visage d’Alice avant de sombrer dans le néant, je ne vis rien, mais je sentis. Une odeur de Cornado. Ma dernière pensée serait donc pour mon frère d’arme… Une main se posa sur mon épaule.
- Agent Chad ne bougez pas, je me charge de la camarade
J’ouvris les yeux au moment où la bastos du Chef lui traversa la tête. Il y eut comme un tintement de verre brisé, des centaines de petits fragments tombèrent à terre et disparurent… Le Chef rengainait son Rafalos.
- Agent Chad, vous avez fait du beau boulot, je vous remercie, il est temps de récupérer les cabots et de rentrer au local. L’aventure ne fait que commencer.
A suivre…