KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 357
A ROCKLIT PRODUCTION
18 / 01 / 2018
|
PINK FAIRIES / CLUB BOMBARDIER THOUSAND WATT BURN / CRASH MIGHTY AMERICAN DOG / ROGER KASPARIAN HUGUES PANASSIé |
Fairies tale
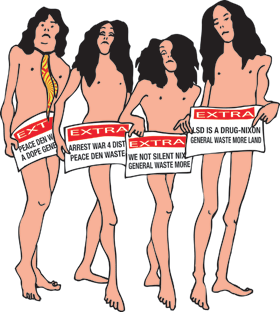
Comme leur nom l’indique, les Pink Fairies sont un conte de fées. Ils incarnent depuis plus de quarante ans la perfection du rock anglais, ce mélange de wasted elegance et de trash-power unique au monde. Avec les Hammersmith Gorillas, l’Edgar Broughton Band et les Pretties, il n’existe pas de groupe plus mythique en Angleterre.

Ce fantastique auteur qu’est Luke Haines résume bien les choses : «The Pink Fairies were born out of chaos : The Pink Fairies Motorcycle Gang And Drinking Club was in 1969 the worst fun you could have (...) Duncan Sunderson, Russell Hunter et Paul Rudolph sont bientôt rejoints par the former Tyrannosaurus Rex lunatic Steve Peregrin Took et l’ex-Tomorrow drummer and professional loose cannon Twink.» Ça sonne comme la description d’une lignée royale, pas vrai ? Quand Haines veut qualifier le Fairy style, il sort ses plus beaux effets : anarchy, smells and badass-as-fuck rock’n’roll. Les Fairies saisissent très vite l’importance vitale d’une double batterie : Russell Hunter et Twink jouent les locos. Pour Haines, «Do It» is stupendoulsly punk rock six years before time. On est en plein dans le proto-punk, les gars.

Ce groupe de vétérans qu’on croyait anéanti par les excès en tous genres est toujours alive and well, comme le révèle Naked Radio, un album/DVD qui vient tout juste de paraître. Dès «Golden Bid», on sent que ça va chauffer. Eh oui, c’est carrément joué aux accords de 1969 all across the USA, une vraie stoogerie. Le secret de leur vitalité, c’est la double batterie, c’est-à-dire Russell Hunter et George Butler. Larry Wallis ne fait plus partie de l’aventure, car il a perdu l’usage de ses mains. Le leadership revient à l’ancien bras droit de Mick Farren, Andy Colqhoun, qui chante et joue de la guitare. On trouve plus loin une autre stoogerie intitulée «Runnin’ Outa Road», montée sur une rythmique de rêve. On sent battre le cœur d’acier des Fairies. Ils tapent aussi dans le vieux jumping blues de Ladbroke Grove avec «The Hills Are Burning». Andy s’y comporte en vieux desperado et il a derrière lui la meilleure rythmique d’Angleterre. Andy sonne bien les cloches d’«I Walk Away», encore un cut battu comme plâtre - Freedom is mine/As I walk away/ In the sunshine - Et ils renouent avec le groove interlope de l’underground londonien dans «You Lied To Me». Duncan Sanderson y joue son dub des bas-fonds. Tiens, encore un cut bardé de son, «Midnite Crisis», véritable groove d’anticipation. Andy se met à jouer comme un diable et il enchaîne avec un autre heavy groove de Grove, «Stopped At The Border». Franchement, les Fairies s’amusent bien à déconner avec les vieux concepts. Andy joue le killer flash-man, il tire ses notes dans des éclairs de sonic attack. N’oublions pas que leur fonds de commerce est le boogie, aussi ne faut-il pas s’étonner de les voir s’embarquer dans «Down To The Wire», mais ils le font avec une extraordinaire énergie. C’est cousu de fil blanc mais joué jusqu’au bout de la nuit. Voilà ce que les Anglais appellent le kiss-ass boogie. Les Fairies rendent aussi hommage à Mick Farren avec «Skeleton Army» - The Ace of Spades is the marching song - On sent immédiatement la morsure de l’énormité à l’anglaise. C’est du stomp - The skeleton army is you and me - Et pouf Andy part en goguette sonique. Puis ils rendent un hommage définitif à Mick Farren dans «Mick» - A white Panther at the NME/ And the message is set us free/ Got a deviant strategy/ Poetry and anarchy/ On the side of you and me/ Old Bailey let us be/ Calling out hypocrisy/ In a world of LSD - Et Dieu créa non pas la femme mais Mick Farren. Pur jus fumant de mythologie.
Quant au DVD qui accompagne l’album, c’est une merveille. On retrouve les Fairies en répétition. Russell Hunter brille par son absence. George Butler bat ça seul. Andy mène le jeu et Sandy grisonne à peine. On voit aussi une promo-vidéo de «Golden Bid», cette fois avec les deux batteurs et Jaki Windmill qui fait désormais partie du groupe. On la voit s’énerver un peu. Le DVD propose aussi des interviews de Sandy, de Jaki et d’Andy. Pour Sandy, les choses n’ont pas changé : c’est toujours sex & drugs & rock’n’roll, the old shamanic hippie void. On retrouve le groupe sur scène au 100 Club pour un concert de rêve. Russel Hunter chante sur le premier cut, mais il revient heureusement derrière son kit pour une fulgurante version de «The Snake». Il semble toujours au bord de l’évanouissement. Les Fairies font une version exemplaire de «Do It» que Sandy prend au chant. Il chante aussi le vieux «Uncle Harry Last Freakout», histoire de boucler ce set magique. Quel drive fantastique ! Les Fairies soukent toujours aussi bien la médina.
La discographie des Fairies n’est pas très volumineuse, mais tout est très intéressant, notamment les trois premiers albums qui fondent leur dimension mythologique.

Never Never Land paraît en 1971 sous une pochette onirique certainement inspirée par l’univers de Tolkien : quatre lutins assis et peints de dos observent le ciel en fumant des spliffs. On a là la formation originale, Sandy, Russell Hunter, Paul Rudolph et Twink. Album infiniment attachant pour deux raisons : «Say You Love Me» et «Teenage Rebel». Paul attaque Say au big riffing de Grove, c’est un allumeur de furnace, un boogieman entreprenant. Les Fairies sortent un son idéal, le gros rock d’Angleterre et certainement le meilleur beat du temps d’avant. C’est sûr qu’en écoutant ça à l’époque, on devenait irrémédiablement élitiste. On appelait ça le London beat. «Teenage Rebel» préfigure aussi tout le rock anglais à venir, Paul y joue la carte du gras double et le London beat étend son empire sur les cervelles. On trouve aussi sur cet album les deux hits des Fairies : «Dot It» (que Sandy chante dans le concert du 100 Club, indétrônable, embarqué par les deux batteries) et «Uncle Harry’s Last Freakout», chanté au petit guttural de Grove, oh yeah. C’est en fait une belle virée de cosmic rock inside off, l’un de ces morceaux longs faits pour tripper. Paul Rudolph y tisse sa trame inter-galactique alors que sourd en des couches subterreanniques le beat de double stand. Voilà un son unique au monde, véritablement booglarized dans l’essence de la prescience. Pourtant, l’album fait flop. Sandy : «As a live act, we were the business, but as a studio act we were shit... no, not shit... we weren’t used to the studio.»

Puis Twink quitte le groupe. Les Fairies flippent : comment va-t-on écrire des chansons ? Ils vont appliquer la vieille théorie scientifique du chaos : du chaos naît la vie. Et Luke Haines ajoute : «What A Bunch Of Sweeties is either a sludged-out clueless Mandrax disaster, or a glorious rock’n’roll mess, the sound of three morons freaking out in a cosmic bin. I’d go for the latter.» (Sweeties est soit un désastre bourbeux occasionné par un bel abus de Mandrax, soit une glorieuse purée de rock enregistrée par trois freaks enfermés dans une poubelle cosmique. Je pencherais pour la glorieuse purée). What A Bunch Of Sweeties paraît l’année suivante avec sa pochette mythique : on y voit un tas de badges, de pilules et de petits objets : pipe à herbe, spliff, carte à jouer, étoile de shérif, etc. On note la présence de Trevor Burton des Move sur l’album (sur «Right On Fight On» et «Portobello Shuffle») (Rich Deakin indique que Burton avait deux problèmes : son ego et l’héro. Il voulait briller sur scène, ce qui ne plaisait pas aux autres et il dut rentrer chez lui à Birmingham - His heroin habit precipitated an early return to his native Birmingham out of concern for his health). Le «Right On Fight On» d’ouverture du bal sonne comme un coup de génie invétéré - Drriiinng ! Drriinng ! I want the Pink Fairies for a gig on Uranus ! - Et le Fairy répond : No way man ! Paul Rudolph embraye avec toute la heavyness du monde, il riffe comme un démon et va placer un peu plus loin l’un de ces solos de glougloutage en raid éclair dont il a le secret. Ils enchaînent avec le heavy shuffle d’un «Portobello Shuffle» violemment troussé au trash de Grove. Et Paul s’en va gicler sur la ligne de crête. Hallucinant spectacle ! Ils restent dans le sans-faute avec «Marylin» - Oh Marylin, won’t you carry in - riffé à la Rudolph et flingué par un solo de batterie. On leur pardonne difficilement ce suicide commercial, même si Paul fait un retour en force au sortir du fucking solo de batterie. On ne peut pas se lasser d’un tel riffeur. La B sonne aussi comme un rêve, et ce dès «Walk Don’t Run/ Middle Run». Paul roule sur un thème cousu de fil blanc, mais il l’enfarine, il ne se refuse aucune extravagance sonique, il bat les accords qu’on retrouvera dans le «Naked Girl» des Cramps et il finit par exploser son cosmos pour nous embarquer dans un spectaculaire délire de mad psyché. Russell Hunter relance indéfiniment, et ils vont droit à la déflagration finale. S’ensuit un «I Went Up I Went Down» digne du White Album, c’est du psychout so far-out d’obédience princière et chanté au gargouillis d’étranglement hallucinatoire, une véritable performance organique. Il y a du génie dans le glorious mess des Fairies, non seulement ça craque bien sous la dent, mais ça monte directement au cerveau. L’apanage des bonnes substances, dirons-nous. Paul revient au heavy riffing pour «X-Ray» et ils terminent l’album avec «I Saw Her Standing There», un fantastique coup de chapeau aux Beatles, version proto-punkoïde qui va rester pour beaucoup de musiciens anglais un véritable modèle. On note l’extraordinaire aisance de la prestance, nous voilà grâce aux Fairies au royaume des cieux, c’est là très exactement que se joue le destin du rock anglais. Il lui faut du gras et de la dégaine, du bordel et de l’intentionnalité, et de quoi altérer les sens qui n’attendent que ça. Ramené de Londres en 1972, What A Bunch Of Sweeties est resté l’un de mes all times favorites.
Paul Rudolph quitte le groupe et Larry Wallis arrive. Tout le monde connaît l’anecdote : Larry demande aux deux autres :
— Alors les gars, on enregistre quoi ?
Les deux autres lui répondent qu’ils n’ont pas de chansons. Et ils ajoutent :
— T’as qu’à en composer !
Larry panique :
— Mais je n’ai jamais composé de chansons !
— Do it !

Alors il do it et ça donne un nouvel album quasi-mythique : Kings Of Oblivion. Le titre est tiré de «The Bewlay Brothers» qu’on trouve sur Hunky Dory. Selon Luke Haines, tous les cuts de Larry Wallis sont punk as fuck - The Lazza-Russ ‘n’ Sandy Fairies line-up was a power trio supreme - Oui, c’est exactement ça, un power-trio suprême, c’est ce qu’on vit au Marquee à l’époque. Après ça, il n’était plus possible de s’intéresser aux groupes français. Les Fairies incarnaient l’essence même du rock. «City Kids» sonne comme un classique entre les classiques, monté sur l’extraordinaire bat russellien, heavy à souhait, bardé de relances, il joue comme une loco, il fonce à travers la nuit. À la limite, c’est lui Russell Hunter qui fait le show. Il double-gutte d’undergut. Alors Larry Wallis peut partir en solo. Ah qui dira la grandeur décadente de Rusell Hunter qu’on voit - sur le triptyque glissé dans la pochette - sous perfusion de bénédictine, avec un visage peint en vert. Cette photo en fit alors fantasmer plus d’un. Encore un hit avec «I Wish I Was A Girl». Cette fois, Sandy fait le show sur son manche de basse, il voyage en mélodie dans la trame d’un cut bâti pour durer. Ils partent à trois comme s’ils partaient à l’aventure et le Wallis part en Futana de solo gargouille. En B, les cuts auraient tendance à retomber comme des soufflés et il faut attendre «Chambermaid» pour renouer avec le cosmic boogie, et «Street Urchin’» pour renouer avec le classicisme. On retrouve l’esprit de «City Kids», le beat avantageux et la clarté du glam. Fantastique ! Ils sonnent comme d’admirables glamsters de baraque foraine. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on les vénère.
Mick Farren admirait Larry Wallis pour son côté trash : «Larry avait des pythons, des cobras et même un rattlesnake dans des gros aquariums, tout ça dans un appart minuscule. Il élevait des rats pour nourrir ses serpents. C’était un fucking nightmare. Quand il était rôti, il jouait avec ses serpents et on était sûrs qu’il allait crever.»
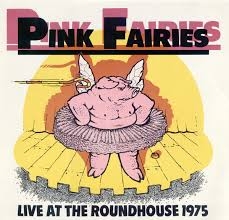
Le Live At The Roundhouse 1975 paru en 1982 est l’un des meilleurs albums live de tous les temps. Double batterie, Twink et Russell Hunter, Sandy sur Rickenbacker et deux killer flash-masters devant, Paul Rudolph et Larry Wallis. En fait, c’est la dernière fois que Paul Rudolph joue dans les Fairies. Et comme Larry Wallis commençait à jouer avec Motörhead, ça sentait la fin des haricots - If the Fairies were going to bow out, they were planning to do it in style (Oui ils comptaient finir en beauté) - Ils roulèrent des centaines de spliffs pour les jeter à la foule. Larry rappelle aussi dans une interview que Sandy, Russell et lui se sont goinfrés de pefedrine avant de monter sur scène - It makes you go mad. So Sandy, Russell and I took as much of that as we could get our hands on (la pefedrine rend fou aussi en ont-ils avalé autant qu’ils ont pu) - Quant à Paul Rudolph, il était arrivé à la Roundhouse en vélo avec une thermos de thé. Ce live saute à la gueule dès «City Kids» que Larry avait composé pour Kings Of Oblivion. Hello alright ? Si on aime le rock anglais, c’est là que ça se passe. Tu prends tout le proto-punk en pleine poire. Tu as là tout l’underground délinquant de Londres. Larry chante et Sandy fait du scooter sur son manche de basse. Ils enchaînent avec une version de «Waiting For The Man» de la pire espèce, claquée par les deux meilleurs trash-punksters d’Angleterre, Larry et Paul. Ils rendent un hommage dément au Velvet. Les Fairies développent une énergie qui leur est propre. Ils sont de toute évidence complètement défoncés. C’est la preuve par neuf qu’il faut jouer défoncé, c’est la clé du rock. S’ils étaient à jeun, ils ne développeraient pas une telle puissance. Ils jouent leur Velvet à outrance, ces mecs jouent à la vie à la mort, c’est saturé de son, au-delà du descriptible. Ils bouclent avec une reprise du «Going Down» de Don Nix, et en font une version heavy qui dépasse toute la démesure du monde. Ça prend des proportions terribles.
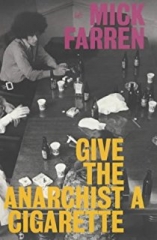
Comme Larry Wallis partageait son temps entre la reformation des Fairies et Motörhead, il se gavait d’amphètes : «I think the longest I ever stayed awake in my life was eleven days at Rockfield, and when you think about it now... God !» Onze jours sans dormir à Rockfield ! Et comme il ne mangeait pas, il avait un sacré look - I looked fantastic, my mother nearly had a nervous breakdown when she got to see me - En le voyant si joliment émacié, sa mère faillit bien s’évanouir. N’oublions pas que Larry est l’un des mecs les plus drôles d’Angleterre. Give The Anarchist A Cigarette grouille d’anecdotes hilarantes.

Big Beat fit paraître en 1984 l’excellent Previously Unreleased, une série de cuts inédits enregistrés par Larry, Sandy et George Butler. On retrouve la niaque épouvantable des Fairies dès «As Long As The Price Is Right». Pas de pire powerhouse que celle-ci. Larry vrille comme un beau diable. Ils restent dans le drive des enfers avec «Waiting For The Lightning To Strike». Ils jouent comme des démons. On ne peut pas faire l’impasse sur cet album. Ils restent dans la puissance des ténèbres pour «No Second Chance», encore un cut battu sans vergogne, battu si fort que les coups rebondissent. C’est extraordinairement bien mixé. Quand on écoute «Talk Of The Devil», on les sait capables de miracles.

Côté singles, il est chaudement recommandé d’écouter «Screwed Up» de Mick Farren, car Larry y screwe le beat à sa façon et le précipite dans le gouffre béant du néant psychédélique. Autre petite merveille fatidique : «Spoiling For A Fight», véritable furiosa del sol, c’est la b-side du single «Between The Lines». On a là du pur jus de combativité boogie. Wow, les Faires cherchent la cogne - Fight ! - Et Larry part en killer solo flash !

On a longtemps pris Kill ‘Em and Eat ‘Em paru en 1987 pour un mauvais album, et chaque fois qu’on le réécoute, ça reste un mauvais album. On y retrouve pourtant la fine fleur de la fine équipe : Larry, Andy, Sandy, Russell et Twink. Sur la pochette, Larry fait le con avec un masque de singe barbu et sa strato rouge. Dans les notes de pochette, Mick Farren raconte qu’un matin de gueule de bois, il est réveillé par un coup de fil qui lui annonce la reformation des Fairies. Oui c’est ça, et Attila revient avec les Huns, hein ? - Yeah and Attila is getting his Huns back together, répond-il - You gotta be kidding - Tu plaisantes, j’espère - And then I remembered, in rock’n’roll, anything is possible - Oui, Mick avait bien raison de dire que tout est possible dans le monde du rock. Et pouf, ils démarrent avec «Broken Statue», un vieux boogie composé par Mick. Larry le joue à la folie et c’est battu comme plâtre par la doublette mythique de Ladbroke Grove. Toute la niaque des Fairies re-surgit de l’eau du lac comme l’épée d’Excalibur. Mais sur cet album, les cuts restent bien ancrés dans le boogie. Larry fait pas mal de ravages, mais il manque l’étincelle qui met le feu aux poudres. «Undercover Of Confusion» sonne comme de la viande de reformation. Pur boogie aussi que ce «Taking LSD». On croirait entendre les Status Quo, ou pire encore, les Dire Straits. Pas plus putassier que ce boogie-ci. Ils font même un «White Girls On Amphetamines» insupportable de médiocrité et de non-présence. On croirait entendre les mauvais groupes français. Larry tente de sauver l’album avec «Seing Double». Il ressort des grosses ficelles, mais au fond, on ne lui demande pas de réinventer la poudre. Il faut rendre à Cesar Wallis ce qui appartient à Cesar Wallis. «Seing Double» est à peu près le seul cut sérieux de cet album.

N’oublions pas que la presse anglaise qualifiait les Fairies de groupe le plus bruyant, le plus chevelu et le plus drogué d’Angleterre. Rich Deakin revient longuement sur le druggy side. Il relate une vieille histoire datant du temps des Deviants : «Il était 6 h 30 du matin et on s’est tous retrouvés à Ladbroke Grove. On est montés dans le van. Il y avait un jukebox à l’intérieur du van. Tout le monde était là, Boss (le père spirituel des Fairies), les Deviants, les copines et toutes les drogues inimaginables. On commençait à rouler et deux flics nous arrêtèrent. Le premier demanda à Tony Wigens de lui présenter son permis et le deuxième alla vers l’arrière du van et ouvrit la portière. Il jeta un coup d’œil à l’intérieur, referma la porte et dit à son collègue : «Come on let’s go. I don’t want to do this !» Rich ajoute que the sight so many freaks freaked the poor copper out. Oh il existe aussi une histoire marrante à base de LSD. Dans son autobio, Mick Farren rappelle qu’au festival de Weeley en 1971, toute la bande avait pris une dose de particulary strong green liquid LSD, fournie par le légendaire dealer John the Bog. Paul Rudolph confirme qu’il a joué tout le set au sol, sur le dos, because the acid was so strong.
C’est un roadie de Canned Heat qui initie les Fairies au crystal meth : «You want some ?» Sandy se souvient qu’après avoir testé la meth, il n’a pas dormi pendant trois jours. Il rappelle aussi qu’à l’époque les roadies faisaient énormément de trafic de dope, sans que les groupes fussent au courant. C’est un miracle qu’un groupe comme les Fairies n’ait pas fini au trou. Rich Deakin indique que dans les années soixante-dix, on consommait énormément de Mandrax à Ladbroke Grove. Les mandies étaient plus accessibles que l’héro, mais pouvaient se révéler dangereux mélangé à de l’alcool (Billy Murcia). Et puis bien sûr l’héro. Russell partagea un appartement avec Took - Took would do awful things in the bathroom, take smack and get pretty disgusting - Dans une interview, Russell Hunter indique qu’il ne put aller au premier festival de Mont-de-Marsan en 1976 à cause d’une infection au genou - The hazard of the junkie profession - et il réussit à décrocher en 1981, grâce à sa girlfriend qui venait de mourir d’une petite overdose.
Dans une interview accordée à John Robb, Captain Sensible rend l’hommage définitif : «They were the only raunchy British act. They were rough and ready, punk as anything at the time.» (Ils furent le seul grand groupe trash anglais, bien plus punk que ne le furent les punks). C’est vrai que les Fairies n’étaient pas du genre à vouloir se calmer. Lors d’une tournée allemande en 1981, ils s’ennuyaient tellement sur les autoroutes qu’ils buvaient comme des trous - Breakfast on the road consisted of Bloody Marys, lunch was apple schnapps and on their day off the band visited the Munich Beer Festival (Bloody Mary au réveil, Schnapps aux repas et fête de la bière pour la journée de relâche) - Et pour rester dans le chaos, la presse anglaise annonçait en 1989 que les ex-membres des Fairies allaient remonter chacun dans leur coin des moutures des Pink Fairies : Twink, Paul Rudoph, Larry Wallis et de leur côté le duo Russell/Sandy. Twink et Paul Rudolph n’allèrent nulle part et c’est bien sûr le duo Russell/Sandy qui continue aujourd’hui de sévir.

Le mot de la fin revient nécessairement à Mick Farren qui écrit, dans la préface de Keep It Together : «Un vers de Bob Dylan décrit cette aventure à la perfection (mais existe-t-il une seule ligne de Dylan qui ne décrive pas tout à la perfection ?) : ‘There was music in the cafés at night and revolution on the stairs.’ Dans un style plus direct, Larry Wallis disait à peu près la même chose : ‘Sleeping single, drinking double’ (dormir seul et boire deux fois plus).» Et comme toujours, la dernière phrase d’un texte de Mick Farren s’en va résonner pour l’éternité dans l’écho du temps : «Comme je l’ai dit, l’histoire que vous allez lire n’est ni celle d’un triomphe ni celle d’une tragédie. Elle s’efforce de raconter ce qui se passe quand on tente de rester dans le réel alors tout devient équivoque. Si on y réfléchit bien et qu’on va vraiment au fond de sa pensée, il devient évident que cet état d’esprit est l’essence même du rock - Which deep down, where the spirit survives, is what the hardest core of rock’n’roll is all about.»
Signé : Cazengler, pink féru
Pink Fairies. Never Never Land. Polydor 1971
Pink Fairies. What A Bunch Of Sweeties. Polydor 1972
Pink Fairies. Kings Of Oblivion. Polydor 1973
Pink Fairies. Live At The Roundhouse 1975. Big Beat 1982
Pink Fairies. Previously Unreleased. Big Beat 1984
Pink Fairies. Kill ‘Em and Eat ‘Em. Demon 1987
Pink Fairies. Naked Radio. Gonzo Music 2017
Rich Deakin. Keep It Together. Cosmic Boogie With The Deviants & The Pink Fairies. Headpress 2007
Luke Haines. I’m Mandies, fly me. Record Collector #456 - August 2016
De gauche à droite sur l’illusse : Paul, Twink, Russell & Sandy
MONTREUIL-SOUS-BOIS / 13 - 01 - 2018
LA COMEDIA
CLUB BOMBARDIER / THOUSAND WATT BURN
CRASH MIGTHTY

Je ne suis pas méchant, pouvez même marcher sur mes chaussures de daim bleu sans que j'éprouve le besoin de sortir ma bate de base-ball de sous le siège de la Teuf-teuf. Mais là, le gars y a mis du vice. L'avait quatre-vingt kilomètres rien que pour lui. Le choix absolu. De l'autoroute, des quatre voies, des aires de stationnements à n'en plus finir, des bateaux à garer des porte-avions... L'a fait exprès de tomber en panne juste sur les vingt mètres où la chaussée se rétrécit. Un vicieux. Une demi-heure d'attente, des centaines de voitures s'efforçant de le contourner sans l'effleurer, et lui pas gêné, ne lui serait même pas venu à l'idée de tenter l'impossible, gesticulait autour de sa chiotte comme si c'était la huitième merveille du monde, l'aurait pu avoir honte, bouter de dépit le feu à sa tire, renoncer à vivre et se suicider en un dernier sursaut d'honneur, je ne sais pas moi, mais au moins tenter de nous faire comprendre qu'il était désolé, qu'il regrettait, qu'il implorait notre pardon, qu'il ne recommencerait jamais, mais non, s'est même lâchement écarté lorsque pour l'aider un peu j'ai essayé de l'écraser sous les roues de la teuf-teuf, rien que pour lui apprendre à vivre et lui montrer que je déteste arriver en retard à un concert. Total quand je suis rentré dans la Comedia, c'était une tragédia, le Club Bombardier avait déjà pris son envol. Pas depuis longtemps certes, mais si vous tronçonnez un bout du reptile, si vous subtilisez la sonnette au serpent, que lui reste-t-il d'intégrité ?
CLUB BOMBARDIER

Sont en plein voyage. Ça bourdonne grave. Vitesse de croisière. Volent tous feux éteints. A basse altitude. Ça ronronne comme une menace. Silence de mort dans la salle. Ecoute aux aguets. Tri-réacteur : basse, batterie, guitare. Du lourd, du doom, son sans altérité, rayon spectral paralysateur. Toile de fond. Décor noir. Tentures feutrées. Plus un chanteur. A la voix hiératique. Evolue sur scène. Bouge avec aisance. En pure perte. Car l'on ne suit que les modulations. Gorge profonde, organe rugissant. Pas de cri. Une lame de fond, issue des profondeurs sous-marines d'une sensibilité exacerbée. La puissance et l'onde de choc. Paralysante. Vous capte et ne vous relâche plus. Vous garde prisionnier-volontaire. Sous le charme. Sous le choc. Lenteur fascinante. Récitatifs infinis. Mais l'avion vire de l'aile. S'extrait de l'engluement nuageux. Mission terminée. Lumière dans la salle. Trois secondes s'écoulent, le temps de passer le sas du retour à la réalité. Les lambeaux pays du rêve s'estompent sous le crépitement des applaudissements. Je n'ai assisté qu'aux quinze dernières minutes d'un set aux confins des ouates stellaires.
THOUSAND WATT BURN

Il y en une qui a tout compris, laisse bosser les boys. Ne sont que deux, les pauvres. Mais au fur et à mesure qu'ils assurent cela devient inquiétant. Le devant de la scène ressemble au tableau de bord d'un vaisseau interplanétaire, des boîtiers de toutes les couleurs et un entremêlement de fils électriques à ligoter un brontosaure, tout ça pour une guitare ! Mais ce n'est rien comparé à l'installation de la batterie, des cymbales comme s'il en pleuvait et un mélange hétéroclite d'objets qui se représente l'évolution technologique des trois derniers millénaires, de l'antique gong himalayen des temples perdus sur les pentes neigeuses escarpées à une espèce de couvercle de boîte à chaussures rouge et plat comme une limande rectangulaire, qui s'obstinera durant dix minutes à se murer dans un silence hostile chaque fois qu'on essaie de le mener à la baguette, et qui enfin condescendra à se transformer en une espèce de vibraphone émetteur d'ondes sonores chargées de vous froisser la membrane tympanique de vos oreilles étonnées. Mais ravies.
Elle nous apprend la patience. Le genre de fille sympathique sans qu'elle ait besoin d'ouvrir la bouche. Une présence. Qui en impose. Tranquille, une madone bienfaisante drapée en toute simplicité dans son ample robe noire. Le fait que le micro ne réponde pas à sa voix ne l'émeut guère. Elle tourne un bouton. La petite lumière verte devient bleue. C'est joli, mais très inefficace. A sa place vous attraperiez une crise de nerf, elle non. Reste plénitude zen. Nous rassure en nous faisant une démonstration de bol tibétin. Pas longtemps. Côté sono, l'on possède une solution pour chaque problème, l'on ouvre des valises de câbles électriques et hop l'on sort la rallonge miracle... N'ont pas encore joué une note, tout le monde est agglutiné autour d'eux, personne ne leur en veut, aucune impatience, à croire que le happening de l'attente fait partie du spectacle, une préparation mentale, un exercice spirituel.
Non, ce ne sont pas les derniers hippies de la mort de retour de Katmandou, la guitare déchire trop. Jamais bien longtemps, vous décortique un riff dynamite, genre attaque au couteau avec égorgement garanti, le temps de laisser la place à l'émulsion drumienne. Brutale. Le chat rit varie la mort des souris qui ne dansent plus même quand il n'est pas là. A eux deux, ils vous installent une ambiance, style Néron faisant rajouter des meubles de bois rares incrustés de gemmes précieuses dans l'incendie de la maison afin de doper le jeu des acteurs, mais il faut l'avouer sans elle ils ne seraient rien. Elle a fait un pas en arrière, elle a porté le micro à ses lèvres et la beauté envoûtante du chant apparaît. Un son bouffé de déformations hertziennes, un organe truffé d'électronique échoïfiante, mais il n'y a plus qu'elle, réverbérante, une voix de prêtresse apocalyptique, elle peut vous annoncer la fin du monde dans les douze secondes qui suivent qu'il vous semble que jamais message de paix aussi suave ne vous fût un jour délivré. Elle vous capte l'esprit. Une époustouflante et détonnante voix d'ulysséenne sirène, alors les deux gars jaloux comme des poux font l'usine. Le drumer balance l'orage, l'ouragan, l'aquilon et le cyclone, le guitar-hero vous scie et vous lamine de dards venimeux de porc-épic psychédélique, font tout ce qu'ils peuvent et même davantage, mais non, c'est elle la Diva, la Callas électrique, la walk-(on the wild side)-yrie wagnerienne de nos rêves les plus fous. N'ont pas dit leurs derniers mots les matelots, profitent d'un instant de calme, le batteur appuie sur une touche et hop retentit une invocation au Prince des Ténèbres, qui vous débite la kyrielle de tous les noms du Diable, de Shitane le bien-aimé à Asmodée le maudit, mais la voix puissante de la prêtresse kashmirique chevauche la tempête, et nous emporte au fin-fond des enfers brûlants. Là où elle ira nous irons, là où elle voudra nous voudrons, là où elle sera nous serons.

On n'en est pas encore revenus. Terminent sous une ovation. Nous ont subjugués. L'on se presse autour d'Elle. Eux ils ont trois tonnes de matériel à dégager. L'on aimerait rapporter de cette goethéenne vision walpurgienne une petite amulette démoniaque, voire un objet d'adoration des plus sulpicéennes, mais non ils n'ont rien à proposer, ni un vinyle, ni un CD, ni un single, ni un maxi à emporter bien au chaud serré sur notre cœur. Juste un quatre titres à écouter sur internet !
CRASH MIGHTY

Douche froide. Changement climatique brutal. Les rocks se suivent et ne se ressemblent pas. A première oreille le Crash Mighty n'opère pas dans la subtilité. Genre de plantigrade mal dégrossi qui ne gêne pas pour laisser des traces partout où il passe. Et fait mal. Droit devant, pas un seul regard en arrière. Trio de base, plus chanteuse. Un peu maigrichonne, pas plantureuse pour un gramme. L'air méchant et peu commode. Aboie dans le micro, à croire qu'elle est la première de la meute à courir après la harde des sangliers. Une tenace. S'accroche au vocal comme la cerise au bocal de moonshine. Les trois guys derrière ne valent guère mieux. Une section rythmique genre peloton d'exécution. Ne prennent même pas le temps de vous attacher au poteau. Vous tirent dessus à bout portant et une fois que vous êtes mort ils vérifient si les fusils étaient chargés. Guillaume est à la basse. Un conquérant. L'a résolu la problématique de la section rythmique. Joue en lead. Avec progression logarythmique. A chaque morceau, plus vite, plus fort, plus compliqué. Spécialisé dans les motifs difficiles. Broderie en 3 D. Vous refile le nom du comparse sur les caisses – genre clouteur de cercueil sans état d'âme – Fred Talbat, le mec qui talbasse les calebasses sérieux, s'amuse à compliquer la donne, vous bâtit des cathédrales sonores avec des clochers de dentelles pierreuses juste pour que Guillaume y entremêle ses guirlandes barbelées, vous vous dites qu'à trois ils font assez de bruit pour réveiller les sept Dormants d'Ephèse, mais non, z'ont un joker, le fameux Framy JB à la lead, trouve sans cesse un coin pour enfoncer un riff à l'endroit où vous n'auriez pas pensé. Crash Mighty, une mécanique implacable. Les brodequins d'acier du destin qui vous piétinent avec méthode, Crash ne recule jamais et Mighty avance toujours. Inéluctable. Sans surprise. Mais au bout de cinq morceaux vous êtes en manque, au bout de dix vous êtes addict, au dernier vous ressentez l'imminente cessation des hostilités comme une insulte personnelle, une injustice démocratique, un affront au genre humain, une décision gouvernementale insupportable, manquerait plus que l'univers cessât d'exister sans préavis, alors exceptionnellement pour que la soirée ne se termine pas en émeute, ils auront droit à un rappel. Et Dinny Sandret reprend le micro et nous azimute ses derniers aboiements sanguinaires de louve sauvage et derrière elle les trois chasseurs de scalps déterrent une fois de plus la hache de guerre du rock'n'roll !
Damie Chad.
( Photos : FB des artistes )
*

-
Wouahh ! T'as rentré du métal ! Tiens, American Dog, ai-je dit, tu connais ?
-
Pas écouté, un lot de plus de quatre cents CD's ! Sont partis vite, il y avait même des truc de Metallica dont j'ignorais l'existence, un collectionneur, un gars méthodique, du tout neuf, enregistrait systématiquement sur bandes pour ne pas abîmer l'objet.
-
Et le gus s'est débarrassé de sa collection, du jour au lendemain !
-
Non, il est mort. C'est un de ses amis qui m'a apporté le tout.
-
Ah, bon... parfois les mots en disent moins que ce que vous ressentez...
J'ai pris le chien américain, un peu comme vous recueillez un chat perdu en vous disant que le maître désolé serait heureux de le savoir à l'abri, au chaud, sur votre canapé. Je l'ai écouté avec cette étrange impression de réceptionner un témoin tendu par la main d'une ombre indistincte là-bas, depuis l'autre rive du fleuve...
SCARS-N-BARS
AMERICAN DOG
( Outlaws Records / 2005 )
Keith Pickens : batterie, choeurs / Steve Theado : guitare, choeurs / Mickael Hannon : chant, basse.

Workin' man : n'ont pas inventé la poudre mais savent s'en servit. Une voix burnée et la musique qui va avec. Un hors d'oeuvre pour présenter les éléments de base. Que du bio, du nature, du hard rock de l'ancien temps comme l'on n'en fait plus. Pardon comme eux en ont gardé la recette. Faded : doivent être pressés de travailler car ils enchaînent comme des forçats. Pour des gars crevés supportent mieux que bien les cicatrices et les blessures de guerre, y rajoutent même comme en filigrane un parfum de mélodie comme pour vous démontrer qu'en mieux ce serait moins bien. Revendication charpentée du maso qui n'échangerait sa place pour rien au monde. Conviction : le genre de morceau qui emporte votre conviction dès la première seconde, une course à la trompe-la-mort comme une harde de mammouths en colère qui vous foncent dessus avec la ferme intention de vous réduire en flaque de sang, une guitare effrénée, un vocal incitateur, une basse pesante et une batterie qui vous emballe le tout avec le rictus démoniaque du boucher qui vous découpe en morceaux. Lucky 13 : bluesy, une guitare qui ratelle les feuilles mortes de votre blues et c'est parti pour la voiture balai, celle qui vous emmène à la décharge municipale. Une voix insidieuse, une guitare qui strille les oreilles, vous vous obstinez sur le 13, vous êtes courageux ! Vous en remettent une couche instrumentale de béton armé pour être sûr que vous ne changerez pas d'avis. Got You by a chain : solo de guitare pour débuter, le genre de poignard qui s'enfonce dans votre cœur lentement. D'accord, vous n'êtes pas pressé mais ça s'accélère méchant, à croire que le gars qui tient le micro est poursuivi par son percepteur, et ensuite c'est la course éperdue. Z'ont vraiment l'habitude de remettre le couvert deux fois. Vous croyez que c'était terminé, mais non ce n'était que le lever du rideau. Another lost weekend : le weekend est sûrement foutu puisqu'ils l'annoncent mais le morceau lui il est drôlement appétissant. Pourvu que mon prochain vendredi soir dégage une même ardeur, ah ces coups de basse qui vous ratiboise l'hypo(po)thalamus, le genre de distraction que vous ne manquerez rien pour rien. She ain't real pretty ( but she's all I've got ) : un riff d'une perfection absolue, minaude à la manière d'une silhouette de gerce qui danse sur fond de soleil couchant. Ça tressaute de tous les côtés, vous trouverez plus fort, plus méchant, plus efficace, plus tout ce que vous voulez, davantage hard, mais pas mieux. La légèreté de l'être. Burnin yesterday : passons aux choses sérieuses. Les pompiers font les meilleurs incendiaires. Une guitare qui file droit, un drumin' qui assomme les piétons sur le bord de la route pour leur éviter de se faire écraser, une basse qui plisse le goudron, et le délire continue sans fin, z'auraient pu marteler durant deux jours entiers que l'on ne s'en serait pas aperçu. Epoustouflant. Sunday buzz : une guitare dont la caisse traîne dans le delta, la voix qui moanise dans le lointain, méfiez-vous même lorsqu'ils se tortillent gentiment devant vous, l'on ne caresse pas le mignonitou petit crotale, la guitare vous pique de ces petits suçons qui se traduisent par des cloques rouges inquiétantes, un harmonica vient de temps en temps mettre le feu au marécage, juste pour vous montrer que le pire est toujours certain. Little Girl : cymbales feutrées et cordes déchirantes. Les filles ont toujours rendu les rockers mauvais – on n'a jamais compris mais dès qu'il y en a une qui pointe le bout de son nez les boys se sentent obligés de faire les cacous - celle-là elle doit avoir du chien, car nos cabots américains lui font le coup des rois de la jungle, la voix pisse sur tous les lampadaires qui passent, et tous trois remuent la queue d'une façon convaincante. Ten til two : cavalcade finale. Devaient avoir un rendez-vous après la prise car ils y vont fort et vite. Bien fait. Ne s'agit pas de salopéger le travail si bien commencé. Juste un petit festival de ce qu'ils savent faire. Ils en rajoutent à la fin, simplement pour vous prouver que les CD devraient avoir deux faces. Comme dans les films d'aventure, ils ont gardé la scène de l'apocalypse pour la fin de la bobine.
Non, ils n'ont pas inventé la poudre mais s'il vous plaît passez-moi la cartouchière. Les chiens américains savent mordre. Autant que ceux de l'enfer. Merci au rocker inconnu.
Damie Chad.
ROGER KASPARIAN
ARCHIVES INEDITES D’UN
PHOTOGRAPHE DES SIXTIES
( Introduction : PHILIPPE MANŒUVRE )
( Editions GRÜND / Septembre 2014 )
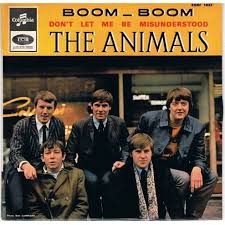
Déjà sorti depuis plus de trois ans. C’est le copain du Gibus qui me le refile sur son camion itinérant. L’a récupéré chez le soldeur - depuis belle lurette les éditeurs ne s’embêtent plus avec les stocks, la rotation rapide de la marchandise favorise la consommation, un des avatars les moins visibles de l’obsolescence programmée, la face obscure de ce qui nous est présenté comme le développement durable par les thuriféraires du marché… Me le faut qu’il m’assure, je le prends pour lui faire plaisir, je ne suis pas un amateur de photographies, je préfère les images. Kasparian, je connais depuis longtemps, c’était une de ses photos qui ornait le super 45 tours français des Animals avec les reprises de Boom-Boom de John Lee Hooker et de Roadrunner de Bo Diddley, une de mes portes d’entrée dans le rock ‘n’ roll à l’époque. In the sixties.

Bref le genre de bouquin qui ne fait pas plaisir. Facile de comprendre pourquoi : suffit de zieuter le portrait de Pete Townshend page 82, cette fragilité, cette gracilité de moineau des rues, le genre de gamin qui prend les jambes à son cou si vous froncez les sourcils dès que vous le voyez tourner autour de votre petite sœur. Remarquez qu’à l’époque j’aurais peut-être couru plus vite. C’est cela qui fait mal, car le Townshend aujourd’hui sur les clichés il a la tronche d’un grand-père. Alors vous vous dites que vous devez lui ressembler un peu…

Mais revenons à Kasparian, l’avait disparu des radars depuis belle lurette. L’a refait surface inopinément sur Rock & Folk voici trois années, un bel article, une expo photos à Paris, et la parution du book, en rafales. Philippe Manœuvre est au guindeau, c’est à lui que la copine d’un stagiaire à la revue montre sur son portable des photos inédites des Rolling Stones. Tout de suite c’est le branle-bas de combat, ça fuse dans la cambuse, ça barde dans la sainte-barbe. D’où les trois bordées des canons. Et une quatrième, Manœuvre devant le coffre au trésor du matelot Kasparian, n’en peut plus, se prend pour Howard Carter qui découvrit la tombe de Toutankhamon. L’en écrit une préface de vingt pages, et met son nom en premier sur la couverture du livre modestement titré en grosses lettres blanches éblouissantes : Philippe Manœuvre - Roger Kasparian.
Faut être juste, le prologue est assez bien mené, colle parfaitement au boulot entrepris par Kasparian durant la décennie prodigieuse, le rock et le yé-yé, les deux mamelles du rock français. Qui ne s’est jamais remis de cette tare congénitale. Muddy Waters qui s’y connaissait déclara que le bâtard du blues s’appelait rock ‘n’ roll, cet adorable fils de pute ne se priva pas pour engendrer à son tour un avorton national qui est autant notre calamité que notre fierté. Simple question de reconnaissance putative.
Kasparian est né en 1938. Sera photographe puisque son père l’est déjà. Possède une boutique à Montreuil. Faudra qu’il reprenne la suite en 1970, finie la folle jeunesse, faut nourrir la femme et le gosse, passera son temps à tirer des portraits de famille et les photos de mariage. Une autre vie. Pas celle de Rimbaud.

Portrait de l’artiste en jeune chien pressé ? Kasparian ne se présente pas en free lance mais en pigiste. Essaie d‘être sur un maximum de coups, suggère, propose, travaille à la commande, l’est connu dans le milieu, mitraille à tous vents, vend quelques clichés, garde le reste chez lui. Plus de dix mille conservés à la maison, entassés dans des boîtes en carton. Un défaut dans l’absence de cuirasse. Un unique sujet de prédilection : le rock ‘n’ roll. Une stratégie foireuse. Il eût fallu s’adjuger une place importante dans une revue de rock ‘n’ roll. N’y en avait pas des centaines. Pas plus de trois, et plutôt moins que plus. Disco-Revue, jeep de combat pour les purs et les durs, Salut Les Copains limousine grand public, Rock & Folk qui cherche ses marques et qui sera l’indétrônable Rolls Royce des seventies. Chacune possédant ses photographes attitrés peu disposés à laisser échapper leur pitance. Kasparian place ses photos un peu partout, certaines sont même retenues pour des pochettes de disques. Mais au total, au moment de franchir l’étroit goulot qui sépare le statut de l’amateur éclairé de celui du professionnel, l’ensemble de ses publications doit sonner un peu dispersé. L’a bien une opportunité. Qu’il refuse. Ne sera pas le photographe officiel de Claude François. Les rockers ricanent dans son dos et lui donnent raison.

Il est vrai que lorsque l’on a photographié les Beatles, les Rolling Stones et Gene Vincent, le recyclage doit s’avérer difficile. Mais la problématique est mal posée. N’importe quel pékin est aujourd’hui capable de tirer, vite fait, mal fait, n’importe quelle star qui passe à portée de son portable. Oui mais ce sont des stars. A l’époque de simples vedettes. Et celles qui ne l’étaient pas en 1960 sont devenues des légendes. L’on retrouve dans les courts commentaires de Kasparian qui présentent ses clichés, les mêmes réflexions que tiennent les participants de l’aventure de Salut Les Copains ( voir KR’TNT 355 du 04 / 01 / 2018 ) : la facilité d’aborder les artistes directement sans passer par le barrage des attachés de presse. Suffit d’aller les cueillir à leur descente du train ou de les attendre dans le hall de l’aéroport. Sont enchantés de rencontrer quelqu’un et acceptent souvent de se laisser piloter dans Paris. Kasparian n’a pas de mal à obtenir des photos de groupe et des portraits individuels. Idem pour les concerts, peut même sans encombre monter sur scène. Wanda Jackson est aux anges, elle pose devant les monuments, elle pourra prouver à ses amis américains qu’elle est bien venue en France…

Kasparian photographie du lourd : Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, The Shirelles, Who, Kinks, Yardbirds, Animals, Them, Manfred Mann et tous les autres… L’a perdu les clichés de Vince Taylor, le guignon du rock ‘n’ roll a dû s’attacher à la personne de Vince dès le premier jour de sa naissance. Une photo de plus ou de moins ne changera pas le monde, elle peut par contre saisir l’image d’un état d’esprit. Dans l’intimité les visages des Beatles trahissent une franche naïveté, sont en demande du photographe, sur scène le groupe a un peu l’aspect de plantes vertes tout heureuses de se trouver là. Quand on pense que ces quatre gugusses vont dans quelques mois devenir à un niveau planétaire les gourous musicaux d’une génération, l’on a du mal à y croire. Les Stones eux quand ils posent devant l’objectif vous prennent l’air condescendant d’un poing fermé, rien que par sa manière de tenir sa cigarette Keith vous apprend l’arrogance, et les photos de Jagger au micro, Jim Morrison a dû chamaniquement s’en imprégner.

Passons rapidement sur les estrangers. Sautez la photo de Dion en cravate de commis-voyageur et celle de Little Eva, cela vous évitera de tomber amoureux. Pour les Yardbirds il manque le son. Manfred Mann à l’aise sur leurs solex. Déboulons sur les frenchies. Tout un chapitre sur Gainsbourg en 1963, laid comme un poux, intelligent comme une tique. Photos de Johnny, Kazparian est fan, avec Joey Greco et Bobbie Clarke ( une seule grosse caisse devant lui ), belle photo de la foule lors d’un concert gratuit à Robinson Village en 1966. Plus les autres, Danyel Gérad submergé par des gosses, un max de photos de Sylvie Vartan ( c’est fou le nombre de photographes qui ont été séduits par cette jeune fille ), un Chris Long comme un jour sans pain, Françoise Hardy qui fait la belle, Moustique très beau, Eddy Mitchell pas en sa meilleure période, Ronnie Bird prêt pour l’envol… plein d’autres, notamment les tableaux vivants savamment mis en scène par Hector et ses Médiators.
A dévorer sans fin. Attention la nostalgie est masturbatoire. Mais à quoi d’autre pourraient servir de belles photos ?
Damie Chad.
DOUZE ANNEES DE JAZZ
( 1927 - 1938 )
HUGUES PANASSIé
( Editions Corrêa / 1946 )
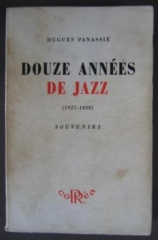
L’introduction du rock en notre douce France n’a pas été facile. Celle du jazz ( et du blues ) qui la précéda encore moins. Hugues Panassié n’en fut pas le pionnier, mais l’un des principaux protagonistes. Son nom fut souvent traîné dans la boue, sur la fin de sa vie l’on ricanait sourdement derrière son dos. L’avait eu le tort de proclamer qu’il n’aimait pas le Be-Bop, crime impardonnable pour ceux qui arrivaient après la bataille… Une de mes copines de fac l’avait bien connu. Elle avait habité près de chez lui. Et ce grand monsieur - c’est ainsi qu’elle l’appelait - lui avait ouvert bien des horizons, lui avait fait lire Proust alors qu’elle n’avait que treize ans. C’est ainsi que l’on grandit plus vite dans sa tête…

C’est en 1927 que tout jeune Hugues Panassié contracta le jazz. N’explique pas comment le microbe s’inocula dans ses veines. Par la petite porte. Celle du jazz blanc de Jack Hilton, l’orchestre à la mode. Une foucade d’adolescent dont il aurait dû se remettre facilement, mais il s’obstina à tel point que lors de ses seize ans son père dut se résoudre à lui offrir un saxophone. Un deuxième microbe celui de la poliomyélyte lui ayant tordu la jambe, la pratique de l’instrument et l’écoute assidue de disques étaient devenues les rares distractions envisageables. Avoir un saxophone c’est bien. En jouer, c’est mieux. Mais plus difficile. Le besoin d’un professeur s’avéra nécessaire. Son père ne mégota pas et dégota un des meilleurs saxophonistes français Dick Wagner. Lui refile les rudiments de base, lui fait connaître l’existence de Fletcher Henderson dont il se procure deux disques ( = quatre morceaux ). Le jeune Panassié est tout heureux, ne jure plus que par la supériorité saxophonéenne de Bix et de l’orchestre de Red Nichols. Les années suivantes le jeune Panassié fréquente les boîtes parisiennes qui présentent la crème des musiciens français, Philippe Brun, Maurice Chaillou, Ray Ventura… les plus aventureux jazzmen français ont entendu deux ou trois disques de Louis Armstrong, sans plus, car tout le monde sait que les meilleurs musiciens de jazz sont blancs.

En 1929, les Chicagoans passent à L’Ermitage Moscovite, pas question de rater ce qui apparaît à Panassié comme le nec le plus ultra du jazz américain. Tous des blancs, bien entendu puisqu’ils sont les meilleurs. Le jeune frenchie ne tarde pas à sympathiser avec un des saxophonistes Milton Mesirow… qui accepte de lui donner quelques leçons de saxophone. Un peu une cause perdue, mais Milton transmet quelque chose de bien plus important qu’une dextérité instrumentale au jeune impétrant impatient, lui permet de mieux comprendre le jazz. Mesirow surnommé Mezz Mezzrow - le lecteur de KR’TNT se rapportera à la livraison 106 du 12 / 07 / 2012 - ne doute pas que le jazz est avant tout une musique noire, il a participé à la naissance du jazz aux Etats-Unis et fut le premier blanc à se joindre aux formations noires, l’a même joué avec Louis Armstrong… Mesirow lui apprend à écouter le jazz, à séparer le bon grain de l’ivraie, se contente d’une moue dubitative silencieuse pour indiquer les mauvais disques, mais cela suffit pour que Panassié en tire les bonnes conclusions : le jazz blanc n’est qu’un ersatz, la hot music est noire.

Panassié pataugera encore quelque temps à entendre du jazz édulcoré, mais il s’affranchit à grand pas des préventions de son milieu. Aiguise son oreille en commandant des disques directement aux USA, ne rate plus aucune des formations noires qui passent par Paris, entre en amitié avec le trompettiste Muggsy Spanier et le violoniste Eddie South. Sait qu’il ne sera jamais un grand ( et même très moyen ) saxophoniste et que sa plume lui sera plus utile pour défendre bec et ongles ses artistes préférés. Du travail en perspective, André Suarès, Lucien Rebatet, Pierre Bost, traitent de très haut ces nègres discordants qui vous écorchent les oreilles. En juin 1930, Stéphane Mougin lance Jazz - Tango dont durant longtemps Panassié sera un des piliers. L’est devenu un connaisseur reconnu, les musiciens américains se refilent son adresse, l’a des entrées dans tous les établissements, ne rate jamais une répétition… Les rencontres se succèdent, Fats Waller, Duke Ellington, Louis Armstrong. Des pages éblouissantes et étonnantes. Scènes cocasses et émouvantes. Panassié entre dans l’intimité des grands hommes. N’oublie pas de les photographier, l’iconographie du bouquin est étonnante, tous les musiciens en costume impeccable, prenant la pose, flattés en leur fort intérieur de cette considération hommagiale que leur accorde les petits blancs. Pas tous, Hugues Panassié tire à boulets rouges sur Canetti qui s’est improvisé manager de la tournée européenne d’Armstrong et qui pense davantage à se remplir les poches qu’à la santé de sa vedette… Des passes virulentes s’en suivront entre le Melody Maker où Canetti, qui vient aussi de s’emparer de Jazz-Tango a ses entrées, et la nouvelle revue de Panassié, Jazz-Hot dont le premier numéro est paru en mars 1935.

C’est qu’entre temps en 1932 Hugues Panassié reçoit la visite de jeunes gens qui avaient fondé à Saint-Cloud le Jazz-Club Universitaire quelque peu déficitaire quant à son rayonnement… Le fragile cercle d’amateurs qui regroupe une douzaine de membres sera transformé en Hot-Club de France. Institution qui bénéficie aujourd’hui d’une aura prestigieuse mais qui ne prit son essor que lentement. Les antennes projetées en province ne dépassèrent jamais la dizaine de membres et il fallut plusieurs mois pour que le club atteignît Le chiffre symbolique de cent adhérents. Il était nécessaire de se lancer dans l‘action directe. Ce fut d‘abord une émission hebdomadaire sur Radio L. L. dont les retombées ne furent pas pharamineuses. L’étape suivante - celle de l’organisation de concerts s’imposait. Ce ne fut pas une sinécure, si le premier dans le sous-sol d’un magasin de disques s’avéra être un succès, la suite fut capricieuse. Le Hot Club présentait des artistes français et américains. Les seconds étaient bien meilleurs mais leurs horaires de travail dans les boîtes mordaient sur les heures de programmation. Devaient partir au plus tôt… ou n’arrivaient que très tard. Au bout de deux ans, ces soirées devinrent courues et il n’y eut plus besoin de jongler avec les heures de passage.

C’est au Boudon que Panassié entendit pour la première fois Django Reinhardt. Le Hot Club entra en ébullition. Enfin un jazzman français de la trempe des noirs américains. L’on ne pouvait rêver mieux ! Fallait organiser un concert – comprenez : pas une apparition dans un dancing - avec un public assis en situation d’écoute et non en train de danser - ce qui donnerait à Django une assise d’estime et de sérieux qui lui ouvrirait les portes d’un studio d’enregistrement. Le concert eu lieu le 2 décembre 1934 - comme par hasard la formation, avec Grapelly ( orthographe panassienne ) au violon, prit le nom de Quintette du Hot-Club de France - et Ultraphone enregistra quelques faces de Django. C’est en cette occasion que Django grava Dinah. Une première expérience studio qui intéressa vivement Hugues Panassié. Son influence grandissait. La parution de son livre Le Jazz Hot n’y était pas pour rien. Les critiques français lui reprochèrent d’avoir osé qualifier Armstrong de génie. Tout le monde sait qu’un nègre peut certes plus ou moins bien jouer de la trompette mais qu’il lui est ontologiquement impossible d’être génial puisqu’il est noir. En Amérique le livre traduit fut accueilli avec stupéfaction, comment était-il possible que le premier livre écrit sur le jazz l'ait été en France par un français !
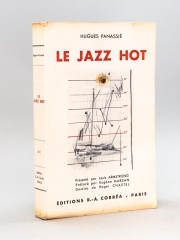
Ironie de l’Histoire : lorsqu’ à la fin des années vingt Panassié s’initie au jazz hot déjà en Amérique le terme hot est remplacé par swing… Très logiquement le terme Swing s’imposera pour le nom de la marque de disques que Panassié décide de fonder. Car Panassié a finement négocié avec Ultraphone qui enregistrera dix-huit titres de Django, plus quatre autres pour Swing.

Hugues décrit quasiment titre par titre toutes les sessions d’enregistrement de Swing. Des ingénieurs du son peu motivés et les tâtonnements expérimentaux pour disposer les micros de telle façon que certains instruments ne couvrent pas les autres et que tous soient audibles. En fait on essaie de tirer les enseignements des ratés précédents… qui n’apparaissent vraiment qu’à la sortie du disque dans le commerce. Les musiciens se mettent rapidement d’accord et l’on enregistre la première cire. Parfois elle se révèlera être la meilleure. Mais si on veut l’écouter, l’exemplaire est totalement saccagé, il faut donc une nouvelle prise. Qui souvent n’est pas aussi bonne. Mais la première étant irrécupérable… Les musiciens improvisent en direct leurs chorus et souvent la fraîcheur du premier jet est supérieure. Une improvisation répétée est une véritable gageure. Pour éviter ce genre de désagrément Panassié prend l’habitude de demander aux musiciens de se lancer dans un blues, ils connaissent d’instinct si parfaitement le terreau de leur musique que souvent il n’est pas besoin de vérifier la qualité de la prise. De grands noms s’inscrivent au catalogue Swing, Coleman Hawkins, Dickie Wells, Sam Allen et bien sûr Django que tous les américains veulent sur leurs disques… Amener Django au studio à huit heures relève de la mission impossible. Le guitariste se couche généralement sur les six heures, le réveiller à sept exige un maximum de délicatesse, si l’on s’y prend en douceur, si le petit crème que l’on va chercher au plus proche café est assez crémeux ( et les croissants croustillants à souhait ) vous tenez le bon bout. Vous êtes à peu près sûr de ramener Django pour dix heures…

Le livre ne s’arrête pas le premier octobre 1938 par hasard. Les menaces de guerre dissuadent de nombreux jazzmen de visiter notre capitale. Puisque la montagne du jazz ne vient plus à lui, Panassié franchit la passerelle du paquebot qui l’emmènera à New York…
Livre passionnant. Deux cent quatre-vingts pages en petits caractères. Chaque folio fourmille de renseignements, pas le temps de s’ennuyer, Hugues Panassié use d’un style alerte qui nous entraîne sur les sentiers oubliés de l’implantation de la musique populaire américaine par chez nous. Pourfend sans vergogne les intellectuels qui à la fin des années trente, venue de la revue du Cotton Club lors de l’exposition Universelle de 1937 aidant, s’emparent du jazz pour l’expliciter en oubliant de le vivre…
Finissons sur une curiosité du 12 novembre 1937, une lecture du poète Pierre Reverdy avec Bill Coleman, Stéphane Grapelly et Joseph Reinhardt en accompagnement… une conjonction jazz-littérature qui se révèlera inaudible. Dommage. Mais qui confirme les littéraires recommandations d’Hugues Panassié quant à Marcel Proust …
Damie Chad.